Régime Et Institutions Politiques Des Années 1960
Articles De La Constitution
Des 111 articles que compte la constitution finalement adoptée, la moitié environ ont gardé le même contenu que le projet initial si l’on fait abstraction de modifications linguistiques, stylistiques ou techniques. Il n’est malheureusement pas possible de reproduire ici les textes tels qu’ils ont évolué au cours du cheminement suivant :
1 : proposition déposée par 37 députés Parmehutu et Aprosoma (« projet Makuza ») (art. 1-48); proposition d’amendements (« projet Kayibanda ») (art. 49-72); proposition d’amendements (« projet de la commission ») (art. 71-111);
2 : vote en première lecture (du 5.10. 1961 au 23.5.1962) ;
3 : vote en deuxième lecture et premier vote global (du 50.7.1962 au 2.8.1962);
4 : vote en dernière lecture et vote global final (du 14.11.1962). Ce dernier texte est en principe celui publié au Journal officiel mis à part cinq légères modifications de style et une modification importante de con tenu.
En comparant les textes phrase par phrase, on constate que relativement peu de modifications importantes sont intervenues au cours de l’évolution du texte. Dans la section suivante quelques commentaires seront offerts sur la modification du contenu de quelques-unes des dispositions les plus importantes.
L’élément ultime de l’évolution du texte est sa publication officielle. La publication d’une loi au Journal officiel a pour objet de la rendre obligataire. Elle crée une présomption légale, puisque « nul n’est censé ignorer la loi ». Cela présuppose évidemment que le texte voté au parlement, sanctionné par le président de la République et publié au Journal officiel soit le même. Etant donné le nombre élevé de lectures et le mode peu systématique de comptes rendus des travaux de l’assemblée constituante, des différences entre le texte voté et le texte publié étaient à craindre. On ne relève cependant que peu de divergences entre le texte de la constitution adoptée par l’Assemblée et celui publié au Journal officiel n° 22bis du 1er décembre 1962. Il faut signaler d’abord quelques modifications mineures de style ou de forme :
– Art. 4, al. 5 : « sera déterminé » (Doc. n° 65, p. 3) devient « est déterminé » (J.O.); – Art. 66, al. 2 : « Les ministres, même non députés » (Doc. n° 68, p. 7) devient « Le vice-président de la République, les ministres même non députés » (J.O.); – Art. 67, al. 2 : « Les fonctions de ministre sont incompatibles » (Doc. n° 10, p. 7) devient « Les fonctions de vice-président de la République et de ministre sont incompatibles » (J.O.);
– Art. 86 : « composant l’Assemblée nationale » (Doc. n° 71, p. 4) devient « composant l’Assemblée » (J.O.).
Voilà pour les modifications mineures de style ou de concordance des textes (en ce qui concerne les références au vice-président de la République). Il y eut également plusieurs modifications purement grammaticales qu’il serait superflu de signaler. La seule modification vraiment pertinente, et inadmissible, fera l’objet de discussions ultérieures. Il s’agit de la réintroduction dans le texte publié de l’art. 90, dont l’Assemblée avait voté le retrait intégral lors de sa séance du 22 novembre 1962. Cet ajout est injustifiable du point de vue de la procédure constitutionnelle. Il s’est avéré impossible de déterminer si ce fut le fait d’une erreur ou d’une intervention délibérée. N’ayant pas eu accès au texte original signé par les députés, nous n’avons pas pu établir si la modification a été apportée à ce texte authentique ou seulement au texte publié au Journal officiel.
Quelle est la conséquence juridique de cette situation ? La promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat authentifie la loi, c’est-à-dire atteste son existence et en tire la conséquence qu’elle doit recevoir exécution. La publication en découle ; elle tend à faire connaître la loi aux citoyens. Quid si le chef de l’Etat sanctionne et promulgue un texte différent de celui approuvé par le parlement, ou – plus grave encore, mais pas fondamentalement différent – non voté par le parlement ? Cette question n’a pas reçu beaucoup d’attention ; de plus, la doctrine et la jurisprudence ne sont pas unanimes. Duguit écrit : « Un texte voté par une seule assemblée (dans l’hypothèse d’un parlement bicaméral – F.R.) n’est pas une loi et par conséquent ne peut être promulgué comme tel. Il en est de même a fortiori d’un texte qui n’aurait pas été voté du tout ».
Il n’y a donc pas loi, mais la question reste de savoir quelle est la conséquence de cette constatation. Les tribunaux pourraient-ils refuser l’application d’un texte promulgué mais non voté ? Duguit répond par l’affirmative, puisque « un texte qui n’a pas été voté par les deux chambres, et qui malgré cela est promulgué, n’existe pas constitutionnellement comme loi. Les tribunaux liés par la constitution ne pas ici, à vrai dire, de savoir si un tribunal doit appliquer une loi, même inconstitutionnelle, mais bien de savoir s’il y a en réalité une loi. Or, il est évident qu’il n’y a pas de loi du tout… »
Le point de vue de Duguit est partagé par la plupart des grands constitutionnalistes, tels Esmein, Jêze, Barthélémy et Giron ; Carré de Malberg et Vedel par contre le rejettent, sur la base du besoin de sécurité juridique. La jurisprudence ne suit cependant pas l’opinion de la majorité de la doctrine. En France, le Conseil d’Etat fit jouer la théorie des actes de gouvernement lorsqu’il estima que « les décrets de promulgation des lois ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’Etat ». En Belgique, un arrêt de la Cour d’appel de Gand, pris sur conclusions conformes du substitut du procureur-général F. Dumon, décida « que la promulgation des lois appartient au Roi qui, gardien de la Constitution, vérifie si les conditions de fond et de forme, requises pour l’élaboration et la rédaction d’un texte légal, ont été respectées; que, la promulgation faite, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le pouvoir judiciaire se substitue ou se superpose à l’exécutif, pour discuter la légalité ou l’authenticité d’un texte promulgué; que les cours et tribunaux sont donc liés par le texte promulgué et publié au Moniteur ». Voilà la position de la doctrine et de la jurisprudence à ce sujet. Bien qu’il y ait des raisons pratiques d’hésiter, nous suivons l’opinion défendue par Duguit parce que c’est la seule qui soit défendable du point de vue de la logique juridique : un texte qui ne peut être une loi parce qu’un élément constitutif lui fait défaut, ne saurait être appliqué. Juridiquement, il n’existe pas. Le cas qui nous préoccupe est évidemment plus grave encore, puisqu’il s’agit d’un article de la constitution. Nous estimons que le même principe s’applique et que l’art. 90 Const. doit dès lors être considéré comme inexistant. Cependant – et ici l’histoire se termine en queue de poisson – cette conclusion n’a aucune incidence pratique, puisque, comme l’avaient remarqué les députés lorsqu’ils décidèrent de ne pas l’inclure dans la constitution, l’art. 90 fait double emploi avec l’art. 57. Son in existence juridique n’enlève donc rien de substantiel au régime du contrôle de la constitutionnalité des lois.
Rupture avec l’ancien régime. Qualification du régime républicain
Plusieurs articles de la constitution font référence au régime que le Rwanda avait connu jusqu’en 1959 et qui fut renversé par la révolution de 1959- 61. L’art. 2 abolit la monarchie qui ne peut être restaurée. Le mwami Kigeri V et toute sa dynastie sont déclarés déchus de leurs prérogatives royales. Cette disposition correspond à l’art. 77 de la « Constitution » de Gitarama et elle confirme constitutionnellement les résultats du référendum sur la monarchie, qui avait déjà trouvé une reconnaissance juridique dans l’art. 1 de l’ordonnance législative n° 02/232 du 1er octobre 1961 (« L’institution du mwami est abolie au Rwanda ») et dans l’art. 1 de l’ordonnance législative n° 02/326 du 9 octobre 1961 (« Le Rwanda est un pays de régime républicain… »).
L’importance de la stratification sociale sous l’ancien régime explique l’accent particulier mis sur le principe de l’égalité et sur l’abolition des privilèges de toute sorte. Plusieurs articles ont trait à l’affirmation de ce principe. Par l’art. 3, la République assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction de race, d’origine, de sexe ou de religion. L’art. 16 réaffirme, inutilement semble-t-il, que « tous les citoyens sont, en droit, égaux devant la loi, sans distinction de race, de clan, de couleur, de sexe ou de religion ». L’art. 17 stipule que « les privilèges de caste sont abolis et ne peuvent être restaurés. Il ne peut en être instauré de nouveaux, de quelque nature que ce soit ». Vu le rôle de l’enseignement dans la protection du monopole politique, social et culturel de l’ethnie tutsi sous l’ancien régime, il est compréhensible que l’égalité en matière éducationnelle soit particulièrement affirmée. L’art. 33 abolit les privilèges en matière d’enseignement et en interdit la restauration. De plus, « la violation de cette interdiction peut entraîner la fermeture de tout établissement scolaire où se pratique de telles discriminations ». Enfin, l’art. 30 réaffirme l’égalité des sexes : « L’homme et la femme sont égaux en droit ». Les dispositions sur l’égalité des citoyens appellent deux observations. La première est qu’un seul article aurait suffi, puisque toutes ces dispositions couvrent le même principe, parfois en l’explicitant ou en l’appliquant à un domaine particulier, tel l’enseignement ; l’égalité des sexes est ainsi garantie à trois reprises (art. 3, 16 et 30). La « Constitution » de Gitarama s’était pourtant limitée à une protection globale de l’égalité en un seul article (art. 9). La deuxième observation a trait à la formulation malheureuse. Non seulement ces articles ne sont-ils pas concordants dans les motifs de discrimination qu’ils entendent réprimer (art. 3 : race, origine, sexe et religion; art. 16: race, clan, couleur, sexe et religion; art. 30: sexe), mais encore pourrait-on croire que ces critères de discrimination sont exhaustifs, ce qui n’est certainement pas le cas. L’insertion du mot « notamment » avant race etc. eût rendu ce point tout à fait clair.
La constitution rejette d’autres vestiges de l’ancien régime : l’art. 25 abolit toute forme d’esclavage et l’art. 40 en fait de même pour le travail forcé extra-pénal. Ces dispositions visent des pratiques de l’ancien régime et du système colonial. Le constituant pensait surtout à l’ubuhake lors du vote de l’art. 25 ; le projet stipulait que « toute forme d’esclavage domestique, tel que le servage pastoral d’ubuhake, est aboli et ne peut être restaurée ». En deuxième lecture le texte fut adopté dans sa version définitive après une intervention d’A. Makuza, rapporteur, annonçant que le texte omettait la référence à l’ubuhake afin de consacrer l’abolition de l’esclavage dans un sens plus général, sans aucune restriction. Nous avons vu dans la troisième partie que l’ubuhake (par l’arrêté du mwami de 1954) et l’ubukonde politique (par l’édit de 1961) avaient déjà été abolis. La constitution ne fait donc que confirmer cette abolition dans une formulation plus générale. L’art. 40 sur le travail forcé extra-pénal traite essentiellement des corvées, qui étaient caractéristiques de l’ancien régime (cfr. ubiretwa) et du système colonial (cfr. akazi). En première lecture, l’Assemblée avait approuvé sans discussion le libellé suivant : « Le travail forcé connu sous le nom de ‘corvées’ est aboli et ne peut être restauré ». Lors de la deuxième lecture, le rapporteur Makuza émit l’avis que le mot « corvées » était trop restrictif. Il proposait de remplacer cette référence par l’ajout « extra-pénal » après « travail forcé », parce que l’Etat peut imposer des travaux forcés aux détenus condamnés. L’article fut voté tel quel et prit ainsi sa place dans le texte définitif. Ces deux dispositions n’avaient pas d’équivalent dans la « Constitution » de Gitarama.
Certains autres articles permettent de qualifier le nouveau régime. La république rwandaise a été justement considérée comme « religieuse, anticommuniste et sociale ». La constitution accorde une place importante à la religion et ne cache pas que ses sources d’inspiration idéologique sont chrétiennes. Ceci n’a rien d’étonnant si l’on prend en considération les appuis et affinités des autorités républicaines. Nous avons vu que les signataires du « Manifeste des Bahutu » s’étaient rencontrés au Grand séminaire de Nyakibanda, que le diocèse de Kabgayi a soutenu la cause de l’émancipation des Hutu à partir du sacre de Mgr. Perraudin et que les petits séminaires avaient constitué, en pratique, la seule possibilité d’enseignement secondaire pour les Hutu. Les dirigeants du Parmehutu au pouvoir ne devaient dès lors pas cacher leur engagement chrétien et leur gratitude envers l’Eglise catholique. C’est ainsi que dans le préambule de la constitution l’assemblée se déclare « confiante en la Toute-Puissance de Dieu ». Les articles 28 et 29 donnent le ton. L’art. 28 reconnaît le mariage monogamique, civil ou religieux. Cette reconnaissance constitutionnelle du mariage religieux au même titre que le mariage civil, qui existait déjà dans l’art. 74 de la « Constitution » de Gitarama, est un élément remarquable de cette constitution. Cette équivalence fut acceptée par certains députés parce que « tous les mariages, religieux ou autres, doivent être enregistrés, c’est-à-dire validés, civilement ». Une autre trace de l’influence chrétienne est la prohibition de la polygamie dans l’art. 29 (et dans l’art. 76 de la « Constitution » de Gitarama). Enfin, le serment, dont la formule est déterminée par l’art. 48, est fait « au nom du Dieu Tout-puissant ».
L’impact crucial de l’inspiration catholique a failli se produire en matière de divorce. En effet, jusqu’à la dernière lecture, le divorce était interdit et seulement la séparation de corps autorisée. L’art. 29 disposait en projet : « Le divorce et la polygamie sont prohibés. Seule la séparation de corps peut être autorisée par les juridictions compétentes ». Ceci était conforme à la « Constitution » de Gitarama, dont l’art. 75 stipulait que « la Constitution de la République Rwandaise condamne le divorce. Seule la séparation de corps peut être prononcée par le tribunal de première instance sur diligence du ministère public ». En première lecture, lors de la séance du 10 octobre 1961, une longue discussion se développa entre les députés favorables à l’autorisation du divorce et ceux qui voulaient admettre tout au plus la séparation de corps. Les amendements tendant à autoriser le divorce furent défaits et le texte du projet fut adopté tel que par 25 voix pour, 2 contre et 8 abstentions. En deuxième lecture un amendement du député Rwagasana comportant la clause « Le divorce civil ou la séparation de corps peuvent être autorisés par les juridictions compétentes » fut défait (1 pour, 25 contre, 8 abstentions), surtout sur base, semble-t-il, du sentiment exprimé ainsi par G. Sentama : « Le divorce étant un mal social redoutable, il convient de l’abolir complètement ». Une nouvelle discussion intervint lors de la dernière lecture. C’est alors qu’A. Munyangaju proposa l’amendement suivant : « La polygamie est prohibée. Le divorce peut être autorisés par les juridictions compétentes dans les formes prévues par la loi. » Un nombre de députés furent apparemment convaincus par l’argument d’I. Sebapolisi que le divorce est pour la société un moindre mal que la séparation de corps, « parce que cette dernière risquant de devenir en pratique définitive peut provoquer un tas de méfaits : adultères, médisances, calomnies, voire assassinats ». Cet argument ainsi que celui du respect des citoyens dont la religion n’interdit pas le divorce finit par convaincre l’assemblée, qui adopta l’amendement de Munyangaju par 17 voix pour, 16 contre et 1 abstention. In extremis, le divorce fut donc, fort heureusement, autorisé par la constitution. La reconnaissance du divorce est le seul élément de la constitution contraire à la doctrine catholique.
L’art. 32 reconnaît également l’enseignement officiel et l’enseignement libre, en pratique généralement assumé par les écoles confessionnelles. Cette égalité entre les deux réseaux est plus qu’une déclaration de principe puisque la constitution stipule que « le coût général de l’élève d’une école subsidiée ne peut être inférieur à celui en vigueur dans une école officielle à même programme » et que « la subsidiation des écoles libres est subordonnée à la proportion numérique des élèves ». La seule limitation est que l’enseignement des écoles libres est soumis aux conventions conclues entre l’Etat rwandais et les représentants légaux des établissements scolaires intéressés, mais cette clause ne fait en fait que garantir la souveraineté de la République en matière scolaire. Cette stimulation de l’enseignement libre est d’autant plus significative quand on se rend compte du fait que, contrairement à l’école primaire, le cycle secondaire était à l’époque un quasi-monopole des communautés religieuses.
Le fait qu’un chapitre spécial soit consacré aux « religions et communautés religieuses » n’est par contre pas spécifique au Rwanda. La constitution sénégalaise contient une section analogue ; elle ne fait que consacrer le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. L’art. 38 permet aux institutions et communautés religieuses de régler et d’administrer leurs affaires de manière autonome, à condition de ne pas empiéter sur les prérogatives de l’Etat ni de s’immiscer dans le domaine « proprement politique ». Deux autres dispositions ayant trait à la religion n’ont également rien de particulier. L’art. 3 assure le respect de toutes les religions non incompatibles avec l’ordre public et la sécurité de l’Etat et l’art. 37 garantit à tous la liberté de conscience, la profession et la pratique libres de la religion, sous réserve du respect de l’ordre public et de la sécurité de l’Etat.
L’interdiction constitutionnelle du communisme, probablement la disposition la plus frappante de la constitution, doit être vue dans cette même orientation chrétienne, bien que cette prohibition était également dirigée contre le parti d’opposition UNAR, tant celui de l’extérieur (dont les liens avec des pays socialistes, notamment la Chine, étaient notoires) que celui – légal – de l’intérieur. Déjà inséré dans la « Constitution » de Gitarama (art. 8), le fameux article 39 de la version définitive, interdisant toute activité et propagande communiste, constituait le deuxième alinéa de l’art. 25 du projet. Il fut décidé de le reporter à l’article ayant trait à la liberté de conscience (art. 37). Lors de l’examen de cet article, la disposition sur le communisme fut cependant perdue de vue. Le texte voté en première lecture ne comprenait de ce fait aucune interdiction dans ce sens. Le libellé « Toute activité et propagande communistes sont interdites » refit surface dans le texte soumis à deuxième lecture, bien qu’il n’ait pas été adopté en première lecture, ce que M. Rwagasana ne manqua pas de faire remarquer.
Si l’assemblée désirait reprendre cette disposition, Rwagasana insistait, « pour mettre en échec toutes mesures arbitraires, de préciser quelles sont au juste les activités et propagande reconnues être communistes et à interdire ». Il proposa en conséquence l’amendement suivant : « Toute activité et propagande communistes, telles qu’elles seront définies par la loi, sont interdites ».
L’UNAR étant souvent accusé de sympathies communistes, les craintes du député Rwagasana étaient compréhensibles. Lorsque G. Gasingwa intervint en affirmant que l’observation de M. Rwagasana était « déjà une manœuvre relevant de la tactique communiste », ce dernier y vit la confirmation de ses craintes : « L’agressive intervention du député Gasingwa confirme à souhait mes appréhensions. Je n’ignore pas que l’on me dit « communisant » ou sympathisant du communisme. C’est là justement qu’est l’arbitraire, tout l’objet de mes craintes ». A. Munyangaju fut le seul député non membre de l’UNAR à soutenir M. Rwagasana ; il proposa la suppression pure et simple de l’art. 39 qu’il considérait comme « superflu, tendancieux et compromettant ». Son point de vue ne l’emporta pas et l’art. 39, unique dans les constitutions africaines, fit son apparition dans le texte définitif. Il ne fait pas de doute que cette disposition constitue une exception à d’autres libertés garanties par la constitution, notamment celles d’opinion, d’association et de formation de groupements politiques.
Le caractère social du régime s’affirme à divers endroits. L’art. 1er déclare que le Rwanda est une république sociale. La Famille, dans ses trois éléments constitutifs, l’homme, la femme et les enfants, est la base primaire de la société rwandaise et il est imposé à l’Etat et aux collectivités publiques le devoir de créer des conditions favorables au développement normal de la famille (art. 26). Le service militaire est « orienté en ordre principal vers la formation physique, morale et civique de la jeunesse » (art. 35). Enfin, l’économie nationale est organisée suivant des plans conformes aux principes de la justice sociale, de la promotion de la famille, du développement de la productivité et du relèvement du standing de vie des individus (art. 44).
Les libertés publiques
Le régime juridique de la protection des droits de l’homme au titre II de la constitution appelle certaines observations. Il faut remarquer tout d’abord qu’il n’est pas toujours aisé de connaître la pensée et les intentions du constituant. L’essentiel des dispositions en cette matière fut en effet approuvé en première lecture sans donner lieu à beaucoup de discussions. Si l’on exclut les trois articles sur le mariage et les six articles sur l’enseignement qui firent l’objet de sérieux débats, la discussion des 24 articles restants représente neuf pages à peine dans les annales parlementaires ; cela revient à une moyenne d’environ un tiers de page par article, ce qui permet tout juste d’imprimer le texte de la disposition et le résultat du vote.
Un amendement du ministre de la Justice A. Makuza avait tendu à introduire en première lecture une disposition inspirée de l’art. 16 de la constitution française de 1958. Le premier alinéa de cet amendement était libellé ainsi: « Lorsque les institutions publiques, la souveraineté nationale et l’intégrité du territoire de la République ou l’exécution de ses engagements sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est ou risque d’être interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du Conseil des ministres et du président de l’Assemblée législative ». Makuza retira son amendement le lendemain, estimant qu’il n’était pas à sa place dans le titre sur les libertés publiques ; il se proposait de le réintroduire lorsqu’il serait question des relations entre le gouvernement et l’assemblée. En réalité cette proposition ne revint cependant plus en discussion et resta ainsi en dehors de la constitution. Ce ne fut qu’une demi-victoire pour la cause des droits de l’homme vu que la possibilité de réglementation par l’Exécutif fut introduite autrement. Le projet débattu en première lecture stipulait en son art. 13 : « Les libertés fondamentales, telles que définies par la Déclaration universelle des droits de l’homme, sont garanties à tous les citoyens, sauf exception à réglementer par la loi. L’exercice des libertés publiques peut toutefois être suspendu en cas d’urgence décrété par le gouvernement ». Lors de la discussion J.B. Rwasibo proposa la suppression du bout de phrase « sauf exception à réglementer par la loi » qui selon lui « prête à équivoque » ; en outre, il affirma être répugné par le mot « suspendu » dans la deuxième phrase. C’est alors que Makuza proposa d’utiliser le terme « régler », ce qui fut adopté. Quant à la seconde phrase, elle devait disparaître. Voulant mieux garantir les libertés publiques, les députés introduisirent paradoxalement le cheval de Troie, en l’occurrence la réglementation des libertés publiques par le pouvoir exécutif. Ils adoptèrent en effet le texte définitif suivant :
« Les libertés fondamentales, telles que définies par la Déclaration universelle des droits de l’homme, sont garanties à tous les citoyens. Leur exercice peut être réglé par les lois et règlements. »
Là où dans le projet la possibilité de réglementation par l’exécutif était exceptionnelle, elle devint donc la règle dans le texte définitif. C’est ironique parce que l’adoption de l’amendement était clairement inspirée par une certaine méfiance envers les pouvoirs d’urgence du gouvernement dans ce domaine. On peut se demander si l’Assemblée se rendait bien compte qu’en admettant une réglementation par l’exécutif elle vidait la garantie constitutionnelle de sa signification essentielle.
Dans une certaine mesure, la réglementation – et partant la limitation – de l’exercice des libertés publiques est donc laissée par le constituant non seulement au législateur mais également au gouvernement. Ce principe formulé en termes généraux dans l’art. 13 se retrouve plus spécifiquement en d’autres endroits. La liberté d’opinion et de sa diffusion ainsi que la liberté d’association peuvent ainsi être limitées par les lois et règlements. De plus, ces deux libertés et celles de conscience, de religion et de grève trouvent leur limitation dans l’ordre public et la sécurité de l’Etat. On pourrait cependant, à propos de l’art. 13, se poser la question de savoir si la règle de la limitation réglementaire s’applique à toutes les libertés du titre II ou uniquement aux droits garantis par la déclaration universelle des droits de l’homme et aux droits pour lesquels cette limitation est explicitement admise par la Constitution. La seconde alternative aurait pour conséquence que la plupart des libertés publiques ne pourraient être réglées que par le législateur. A notre avis, c’est la solution correcte, et ce pour deux raisons. D’abord, le bout de phrase de l’art. 13 « leur exercice peut être réglé par les lois et règlements » renvoie clairement aux « libertés fondamentales, telles que définies par la Déclaration universelle des droits de l’homme ». Ensuite, si une disposition prévoit explicitement la réglementation par la loi uniquement, le règlement ne saurait intervenir. Par exemple, si l’art. 24 stipule que « le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par les autorités désignées par la loi… », l’intervention par voie de règlement est clairement exclue. Les droits garantis par la Déclaration universelle mais non par la constitution peuvent donc faire l’objet de réglementation par l’exécutif ; il en est de même des articles du titre II où cela est explicitement prévu. Dans les autres cas, seul le législateur a le droit de réglementer.
On constate que, comparé à la plupart des autres pays d’Afrique francophone, le titre II de la constitution présente un code assez complet des libertés publiques. En principe, l’applicabilité directe de la Déclaration universelle des droits de l’homme étendit encore cette protection à tous les droits qui y sont garantis. La référence à la Déclaration universelle est cependant quelque peu irréaliste puisque le Rwanda ne peut, faute de moyens budgétaires suffisants, garantir un nombre de droits économiques, sociaux et culturels. On songe notamment aux articles 22 et 25 de la Déclaration qui garantissent le droit à la sécurité sociale et aux allocations de chômage. La constitution de 1978 a dès lors omis cette référence. Pour ce qui est du régime juridique des libertés publiques, le Rwanda a opté en principe pour le système répressif, ce qui permet à tout citoyen d’exercer ses libertés constitutionnelles sans aucune condition préalable, sous réserve de poursuites judiciaires qui peuvent être intentées contre lui, lorsque par un usage fautif de sa liberté il a lésé les droits d’autrui (responsabilité civile) ou violé une loi pénale préexistante (responsabilité pénale). Le système préventif de l’autorisation préalable ne fut retenu que pour certaines libertés publiques s’exerçant sur la voie publique.
Séparation et coopérations des pouvoirs
En guise d’introduction au titre III sur les institutions supérieures de la République, l’art. 45 consacre la séparation et la coopération des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Ces deux éléments doivent être examinés brièvement avant d’entamer l’étude du fonctionnement des trois pouvoirs. Pour caractériser la séparation des pouvoirs il importe de distinguer selon qu’il s’agisse de l’exécutif, du législatif ou du judiciaire. On peut poser comme principe de base que la séparation s’effectue essentiellement au niveau de la désignation des organes du pouvoir en ce qui concerne les branches politiques (législatif et exécutif) et au niveau de l’exercice du pouvoir en ce qui concerne le judiciaire.
En ce qui concerne la désignation du président de la République il y a eu un net progrès vers l’élection directe. Si le projet prévoyait l’élection du chef de l’Etat par l’Assemblée à la majorité des 2/3 des députés présents, le texte adopté en première lecture retint l’élection au suffrage direct par la population. Cette version maintenait cependant l’élection d’un remplaçant par l’Assemblée en cas de décès, de déchéance ou de démission du président de la République. En dernière lecture on aboutit finalement à l’élection directe au suffrage universel du président de la République, même pour pourvoir à une vacance en cours de mandat. Le président de la République est élu dans une circonscription électorale qui couvre le territoire entier de la République. Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct par un scrutin dont la circonscription électorale est la préfecture. Le chef de l’Etat et les députés sont donc élus séparément par des corps électoraux distincts. Ceci est la solution adoptée par la plupart des constitutions africaines après l’indépendance. Le procédé de l’élection au suffrage universel direct donne évidemment une légitimité propre au président de la République ; il offre en principe le soutien populaire qui, dans un régime personnalisé, est vital. C’est ce que Grégoire Kayibanda, anticipant sa désignation comme président de la République, a fort bien compris. Nous venons de voir en effet que le projet de constitution préconisait l’élection du Président par l’Assemblée législative. Le texte d’amendements du titre IV, introduit par Gr. Kayibanda et C. Mulindahabi, proposait par contre l’élection directe, qui fut adoptée par l’Assemblée. La légitimité propre obtenue par le suffrage universel aurait cependant dû mettre le chef de l’Etat à l’abri du jeu de la responsabilité politique envers l’Assemblée. Or, nous verrons qu’il n’en fut rien ; cette contradiction constitue la faute structurelle la plus importante de la constitution de 1962. A. Makuza, partisan de l’élection du président de la République par l’Assemblée législative, ne manqua pas de le faire remarquer : « Si le président de la République est élu au suffrage universel, c’est-à-dire par le peuple, l’Assemblée législative se verra frappée d’incompétence pour formuler, le cas échéant, une motion de censure, puisqu’elle devra requérir l’assentiment explicite du peuple électeur ».
A l’opposé des deux autres pouvoirs, pour la désignation des organes, le pouvoir judiciaire dépend des pouvoirs politiques. Le président et les vice-présidents de la Cour suprême sont nommés par le président de la République sur une liste de candidats présentés par l’Assemblée nationale et le gouvernement réunis en commun. Ils sont révoqués par le président de la République et du gouvernement réunis en commun (art. 56, b et 104). Les autres magistrats sont nommés et révoqués par le président de la République (art. 56, f). A première vue, cette dépendance semble exagérée, surtout à cause du pouvoir de révocation : le statut de la magistrature procure toute fois certaines garanties, notamment par l’instauration d’un Conseil supé rieur de la magistrature. Tout tributaire qu’il est des deux autres pouvoirs pour sa désignation, une fois en place le pouvoir judiciaire est en théorie parfaitement indépendant dans l’exercice de ses attributions. Cette séparation va même plus loin que dans d’autres systèmes, puisque le pouvoir judiciaire s’auto-administre. Par une de ses sections, le département des cours et tribunaux, la Cour suprême « dirige et organise les cours et tribunaux de la République » (art. 102, al. 1). La création du département des cours et tribunaux, innovation que les députés eux-mêmes considéraient comme « révolutionnaire », n’eut toutefois pas pour but principal de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il s’agit en effet d’une mesure ad hominem, dirigée contre le ministre de la Justice de l’époque, A. Makuza. Celui-ci n’avait pas la confiance de plusieurs députés éminents, tels les ministres C. Mulindahabi et C. Cyimana; ceux-ci se rendaient toutefois compte du fait que le gouvernement pouvait difficilement se passer de l’expertise du ministre Makuza dans l’immédiat. Plusieurs députés attirèrent l’attention de l’assemblée sur cette réalité. M. Rwagasana conclut à « une mise en scène très habile devant Byungura, quant à lui, constatait que certains députés-ministres voulaient « parvenir par des moyens subtils, mais sûrs, au renversement du ministère de la Justice et selon toute vraisemblance, à l’éviction du titulaire. » Le ministre Mulindahabi confirma les appréhensions des intervenants lorsqu’il émit l’opinion qu’A. Makuza « est encore manifestement sous le joug du colonialisme belge. » On voit que la confiance des collègues de Makuza n’était pas grande ; c’est notamment dû au fait qu’il avait su pactiser avec les autorités de tutelle, qu’il avait été membre du RADER et que son appartenance ethnique a toujours été l’objet de doutes. Quoi qu’il en soit, c’est ainsi que le « département des cours et tribunaux » trouva sa place dans la constitution. En théorie donc, même pour son administration le pouvoir judiciaire ne dépend pas du ministère de la Justice. Dès lors, une fois en place, « le judiciaire constitue une autorité indépendante du législatif et de l’exécutif » (art. 98), seulement « soumise à l’autorité de la loi » (art. 105).
Au-delà de cette séparation, l’étroite coopération entre les pouvoirs est cependant une caractéristique frappante de l’organisation des rapports institutionnels. Ces rapports sont multiples et constants. Les trois pouvoirs interviennent dans le processus législatif. L’Assemblée nationale vote la loi ordinaire à la majorité simple et la loi organique à la majorité absolue (art. 89). Le texte voté doit être transmis simultanément au président de la République et à la Cour suprême. Si la Cour suprême ne rend pas d’arrêt d’inconstitutionnalité, le président est obligé de signer et de promulguer la loi dans les quinze jours qui suivent sa transmission (art. 57, al. 1 et art.56, al. k). Au cas où le président ne promulguerait pas la loi dans ce délai, le président de l’Assemblée doit en saisir la Cour suprême (art. 57, al. 2). Le président de la République peut également intervenir dans le processus législatif de manière préventive, en usant de son droit de veto suspensif. Il peut renvoyer toute loi votée à l’assemblée pour seconde lecture. Si la loi est votée en seconde lecture et n’est pas déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême elle doit être promulguée. La Cour suprême intervient encore d’une autre façon dans l’élaboration de la loi, cette fois en vertu de la loi du 23 février 1963 portant organisation de la Cour suprême et non sur des bases Strictement constitutionnelles. D’une part, en vertu de l’art. 46 de cette loi, la Cour peut donner un avis préalable au vote de la loi sur saisine par le président de la République. D’autre part, l’art. 47 de la loi attribue à la Cour suprême un droit d’initiative législative indirecte : la Cour constitutionnelle peut, de sa propre initiative, préparer des projets de loi à soumettre au gouvernement pour compétence ou attirer son attention sur l’opportunité d’une réforme ou d’une modification législative réclamée par l’intérêt commun. Il ne s’agit évidemment pas ici d’une initiative législative réelle puisque la Cour n’adresse que des suggestions au gouvernement, qui reste maître de la décision d’introduire des projets de loi à l’Assemblée.
Afin d’instaurer un équilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif, et de promouvoir leur stabilité, les sorts de ces deux pouvoirs sont dans une certaine mesure liés. Si le président de la République peut suspendre les sessions de l’Assemblée nationale pour un délai maximum de quinze jours, il ne peut jamais la dissoudre (art. 56, m). L’art. 97 prévoit les deux seuls cas où l’assemblée peut être dissoute. La dissolution est de droit si plus de deux crises gouvernementales interviennent au cours d’une période de trois ans consécutifs. L’Assemblée peut également être dissoute sur décision du Congrès national, composé du collège des conseillers communaux, de l’Assemblée nationale et du gouvernement. L’institution de ce Congrès ayant une fonction non permanente d’arbitrage est une particularité du régime politique rwandais qui s’explique par des raisons historiques. On se rappelle en effet que la République fut proclamée et la « Constitution » de Gitarama promulguée lors d’un Congrès national de composition analogue. Il n’est pas étonnant que nette institution n’ait jamais eu l’occasion de fonctionner ; bien que l’idée soit attrayante, on ne voit pas très bien comment pareille assemblée de plusieurs milliers de membres pourrait effectivement assumer une fonction d’arbitrage. Nous verrons d’ailleurs plus loin que la concentration du pouvoir empêcha par d’autres moyens la naissance de conflits profonds. La dissolution de l’Assemblée nationale entraîne ipso facto la démission du président de la République et de son gouvernement. L’équilibre est donc réel mais inégal, puisque le président tombe en tout cas avec le parlement, tandis que le parlement n’est dissout qu’à l’occasion de la troisième chute du gouvernement dans une période de trois ans. De plus, si l’Assemblée peut contraindre le président et son gouvernement à la démission, l’Exécutif ne peut jamais dissoudre le parlement. L’équilibre est donc théoriquement en faveur du pouvoir législatif. C’est, en fin de compte, le peuple qui sera l’arbitre de tout conflit institutionnel persistant, soit par voie d’élection présidentielle, soit par voie d’élections présidentielles et législatives simultanées, soit encore par voie de référendum, prévu par l’art. 72 en cas de persistance du désaccord entre les pouvoirs législatif et exécutif.
Le domaine de la loi
La prééminence théorique du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif trouve une autre expression dans la délimitation du domaine de la loi. Celui-ci est en principe illimité : « La loi intervient souverainement en toute matière » (art. 92). Contrairement au régime de l’art. 34 de la constitution française de 1958, repris par la plupart des pays d’Afrique francophone, le pouvoir législatif détient la plénitude et le résidu des compétences normatives. Le pouvoir exécutif ne peut intervenir par son pouvoir réglementaire que si la constitution ou une loi le prévoit explicitement et les matières non attribuées sont du ressort exclusif du pouvoir législatif. Ici, l’inspiration belge est nette ; l’article 7 de la Charte coloniale stipulait déjà que « la loi intervient souverainement en toute matière » et les textes de l’autonomie interne avaient appliqué le même principe. Il faut cependant dire que c’est également le système retenu par la constitution de la Guinée, citée par le ministre Makuza comme une des sources d’inspiration de son texte. La constitution accorde également au législateur un nombre d’attributions propres et réservées, notamment dans le domaine des libertés publiques et des finances. Elle exige en outre des lois organiques, votées à la majorité absolue, pour légiférer dans certaines matières : fixation des conditions et procédure d’application des moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale sur l’action du gouvernement (art.96, al. 31) ; l’organisation, la compétence et la procédure de la Cour suprême (art. 103, al. 2) et en général le fonctionnement de toutes les juridictions (art. 99, al. 3) ; et la procédure suivant laquelle les coutumes seront codifiées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la constitution (art. 109).
Si « le domaine de la loi est illimité » et si « la loi intervient souverainement en toute matière », le législateur est naturellement lié par les prescrits de la constitution. Dans le domaine du contrôle de la constitutionnalité des lois, la constitution a connu une évolution intéressante dans le sens d’un strict constitutionnalisme. Le projet de l’art. 57 avait prévu que le président de la République pouvait saisir la Cour suprême de l’inconstitutionnalité d’une loi votée par l’Assemblée. Lors du débat en première lecture deux positions s’affrontaient : l’une, exprimée notamment par J.B. Rwasibo et C. Mulindahabi, qui voulaient que la Cour suprême ne soit saisie qu’en cas de doute par peur de paralysie du travail législatif ; l’autre exprimée par G. Cyimina et Gr. Kayibanda, qui soutenaient que tout acte législatif devait passer par le contrôle de la Cour suprême. Ces deux préoccupations furent combinées dans l’article voté en première lecture, qui disposait que toute loi votée serait transmise à la Cour suprême, sauf en cas d’urgence. La suppression de l’exception d’urgence, proposée par A. Munyangaju, fut cependant adoptée sans discussion en dernière lecture.
L’art. 57 définitif doit être lu conjointement avec l’art. 90 définitif. Cette liaison n’avait pas été perçue par l’assemblée au début, mais les deux articles ont, au fil des lectures, connu un cheminement convergent, impliquant un certain double emploi. Le projet de ce qui devint l’art. 90 prévoyait que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration de la Cour suprême de leur conformité à la Constitution ». Cet alinéa fut adopté tel quel en première lecture sans que référence ne soit faite à l’art. 57 qui couvrait le même domaine pour les lois ordinaires. Après la première lecture on pouvait dès lors estimer que les lois ordinaires, sauf en cas d’urgence (art. 57), et les lois organiques, dans tous les cas (art. 90), devaient être transmises à la Cour suprême pour contrôle de leur conformité à la constitution. Il y avait clairement parmi les députés un malentendu quant à la portée de cette saisine. Sans être contredits, plusieurs députés déclarèrent en effet qu’ils ne voyaient pas d’objection au vote de cet article puisque « l’avis de la Cour suprême ne lie pas l’Assemblée ». C’était évidemment faux : la Cour suprême devait rendre un arrêt liant l’assemblée, ce qui devint tout à fait clair lorsqu’en même lecture le deuxième alinéa fut libellé comme suit : « En cas de non -conformité à la Constitution, la Cour suprême retourne la loi au président de la République qui la renvoie à l’Assemblée législative pour une seconde lecture ». Ce n’est que lors de la dernière lecture que le rapprochement entre les articles 57 et 90 fut fait. Nous avons vu qu’en dernière lecture l’art. 57 avait déjà été définitivement arrêté ainsi : « Toute loi votée est obligatoirement et simultanément transmise… ». Lors de l’étude de l’art. 90, A. Munyangaju estimait par conséquent « que cet article n’est pas en fait nécessaire, car par ailleurs il est stipulé que toute loi votée à l’Assemblée nationale – la loi organique y comprise – est nécessairement transmise à la Cour suprême qui se prononce sur sa constitutionnalité ». L’Assemblée décida quasiment sans débat le retrait de cet article par 24 voix contre une. Nous avons vu que l’art. 90 figure néanmoins dans le texte publié au Journal officiel : c’est le cas le plus frappant de divergence entre le texte voté et le texte publié. Les conséquences juridiques de cette situation ont fait l’objet d’une discussion sommaire.
L’Exécutif monocéphale et concentré
Comme dans la plupart des régimes républicains d’Afrique francophone les pouvoirs administratifs sont concentrés au Rwanda entre les mains du président de la République, chef de l’Etat et du gouvernement (art. 49, al. 1). L’existence de la fonction de vice-président n’influence guère cette organisation, puisque celui-ci ne détient aucun pouvoir autonome : il assiste le président de la République et le remplace en cas d’absence (art. 52, al. 4), mais il n’a aucune compétence propre. Le cheminement vers l’instauration de cette fonction fut pourtant long. Lors de la première lecture (séance du 18 octobre 1961) Gr. Kayibanda avait proposé d’introduire la fonction de « secrétaire d’Etat à la Présidence » qui assisterait le président de la République et le remplacerait en cas d’absence ou d’empêchement. Evidemment Kayibanda prévoyait déjà qu’il serait élu président de la République le 26 octobre, à peine une semaine après la séance lors de laquelle il formula cette proposition. Pour lui, le « secrétaire d’Etat à la Présidence » serait désigné par le président de la République, qui resterait seul responsable devant l’Assemblée. C’est pour cette raison qu’il rejetait le terme « vice-président ». Il tenta de trouver appui dans le système américain, « où le président nomme lui-même son secrétaire d’Etat dans son propre parti ». Il est clair que ce parallèle était faux, puisque le secrétaire d’Etat est aux Etats-Unis d’Amérique le ministre des affaires étrangères; le vice-président, par contre, y est élu sur le même « ticket » que le président. On peut supposer que l’idée de Kayibanda était d’éviter que son adjoint soit trop fort politiquement et qu’il ait une légitimité propre. Devant l’hostilité de l’assemblée, Kayibanda s’était vu obligé de retirer sa proposition. Il fut décidé qu’en cas d’absence ou d’empêchement le président serait remplacé par un ministre désigné par lui (proposition Bicamumpaka-Mulindahabi). L’idée de la vice-présidence refit cependant surface lors de la dernière lecture. Ce fut cette fois C. Mulindahabi qui proposait de faire assister le président de la République d’un vice-président qui le remplacerait en cas d’absence. Il insista, en réponse à un sous-amendement de M. Rwagasana, sur la liberté du président de choisir son adjoint, tout en admettant que la nomination devait être agréée par l’Assemblée et indiqua que son but était de décharger le chef de l’Etat de certaines obligations de caractère purement administratif ou de politique générale. A. Munyangaju exprima son étonnement devant ce revirement : « Lors de l’élaboration du projet de Constitution et pendant son étude, le principe d’instaurer une vice-présidence avait été préconisé, mais chaque fois rejeté ». Il affirmait ne pas comprendre « dans quel sens l’on veut orienter le régime actuel ». L’amendement Mulindahabi fut cependant adopté par 22 voix pour et 4 abstentions et la fonction de vice-président de la République instaurée. Il faut signaler que le président Kayibanda ne désigna jamais de titulaire à ce poste; la fonction fut d’ailleurs abrogée lors de la révision constitutionnelle de 1973 (voir n » 624-626).
Bien que la constitution stipule que le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République et par ses ministres, le chef de l’Etat est seul détenteur juridique de ce pouvoir. En effet, « les ministres reçoivent délégation du président de la République pour les affaires relevant de leurs départements ministériels. Le président de la République fixe l’étendue de cette délégation » (art. 56, c). Les ministres ne possèdent donc qu’un pouvoir délégué ; ils n’ont qu’un pouvoir consultatif dans l’élaboration de la politique du gouvernement. L’art. 64 énumère les points sur lesquels les ministres sont « entendus et consultés obligatoirement ». Il s’agit notamment des « décisions déterminant la politique générale de l’Etat ». Cette distribution de compétences au sein du pouvoir exécutif trouve son pendant logique dans celle de la responsabilité politique. Seul le président de la République est responsable devant l’Assemblée nationale ; le vice-président et les ministres sont responsables devant lui. En conséquence, seul le président peut, de l’avis du conseil du gouvernement, engager l’existence du gouvernement (art. 68). Bien que les ministres en tant que collège soient solidaires du président, la démission d’un ministre n’affecte pas l’existence du gouvernement (art. 65). C’est pourquoi la disposition que « les ministres (…) contresignent les actes du président de la République quand ils sont chargés de leur exécution » (art. 62) n’a pas de sens, puisque le but du contreseing est normalement d’effectuer un transfert de responsabilité vers l’organe qui contresigne. La prééminence du président de la République, contenue dans son statut et ses pouvoirs, est évidente. Les ministres dépendent complètement de lui, d’autant plus qu’il les nomme et révoque, sous la seule condition d’en in former l’Assemblée nationale. Cette compétence n’est donc pas liée, sauf par l’interdiction de l’art. 67 de nommer un parent ou allié du président de la République jusqu’au deuxième degré au poste de vice-président ou de ministre.
Un régime hybride
Certains auteurs ont, improprement à notre avis, qualifié le régime politique rwandais de présidentiel. Selon une doctrine classique et généralement admise il est question de régime présidentiel si trois caractéristiques se
(i) L’Exécutif est monocéphale, c’est-à-dire non divisé en deux éléments séparés, le chef de l’Etat et le cabinet, lui-même placé sous l’autorité du chef du gouvernement. Le président est à la fois chef de l’Etat et chef du gouvernement, et il exerce ces fonctions effectivement ;
(ii) Le président est élu par la nation entière, au suffrage universel direct ;
(iii) Le président et le parlement sont indépendants l’un de l’autre. Les éléments essentiels de cette séparation sont 1° que le parlement ne peut pas renverser le gouvernement présidentiel par un vote de défiance; 2° que le président ne peut pas dissoudre le parlement.
Au Rwanda, la troisième condition n’est pas remplie. Le président de la République, chef de l’Etat et du gouvernement, est soumis au contrôle politique de l’Assemblée nationale devant laquelle il est responsable, et seul responsable puisque les membres du gouvernement sont responsables devant lui uniquement (art. 68, al. 1). Cette responsabilité peut être mise en œuvre par deux moyens :
(1) Question de confiance : de l’avis du Conseil du gouvernement, le président de la République peut engager devant l’Assemblée l’existence de son gouvernement par une question de confiance, posée sur l’adoption ou le rejet de tout ou partie des dispositions soumises à l’examen du parlement (art. 68, al. 2) ;
(2) Motion de censure : L’Assemblée peut mettre en cause la responsabilité du président de la République et, partant, du gouvernement par le vote d’une motion de censure partant sur la politique générale du gouvernement (art. 69, al. 1). Les possibilités de la mise en œuvre sont cependant limitées : une motion ne peut être déposée qu’après interpellation restée sans effet (art. 69, al. 2) ; elle n’est recevable que si elle est signée par au moins 2/5 des députés (art. 69, al. 4) ; si la motion est rejetée ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même année (art. 69, al. 5) et le vote de méfiance doit obtenir une majorité des 4/5 des députés (art. 70, al. 1). Le refus de confiance ou l’adoption d’une motion de censure entraîne la démission du président de la République et de son gouvernement (art. 70, al. 3).
Si c’est donc erronément que le régime rwandais a été qualifié de présidentiel, il n’est pas non plus parlementaire. La notion classique de régime parlementaire comporte en effet un Exécutif dualiste ou bicéphale, la responsabilité politique du cabinet devant le parlement et le droit de dissolution. Or, au Rwanda, on ne retrouve pas les premier et troisième éléments. Enfin, le régime instauré en 1962 n’est pas davantage semi-présidentiel ou mixte (comme ceux de la République de Weimar, de la France après 1962 et de l’Autriche) puisque pareil régime est caractérisé par l’existence d’un Exécutif bicéphale avec un président politiquement irresponsable. La position du président vis-à-vis du parlement correspond à celle du premier ministre dans les régimes parlementaires comme ceux de la Grande-Bretagne ou de la Belgique. Dans ce sens le régime tient plus du système parlementaire que du régime présidentiel. Ce qui rend, en fait, le système rwandais si difficile à qualifier, c’est la combinaison de la responsabilité politique du président et son élection au suffrage universel. Nous avons déjà indiqué que ceci introduit une contradiction fondamentale dans le régime, puisque l’élection au suffrage universel fait du chef de l’Etat un représentant du peuple, qui se trouve placé sur le même pied que le parlement, l’un et l’autre émanant directement de la souveraineté populaire. Les constituants, ou du moins certains membres de l’Assemblée constituante, se sont rendus compte de cette caractéristique du régime qu’ils instauraient. En justification de son abstention lors du premier vote global C. Mulindahabi indiqua que « certains articles (…) ne s’adaptent pas au régime présidentiel pour lequel nous avons opté, mais au régime parlementaire que nous avons abandonné… » et que « dans l’ensemble de la constitution, le pouvoir exécutif est trop lié, je dirais paralysé ».
Les sources d’inspiration de la réception constitutionnelle
La genèse de la constitution rwandaise constitue un cas intéressant de réception de droit constitutionnel. Contrairement à celle de la plupart des autres pays africains, la loi fondamentale rwandaise n’est pas une « constitution de juristes ». Le texte en fut longuement débattu par l’Assemblée constituante, qui y apporta de nombreuses modifications dont quelques-unes d’envergure. Ce procédé a l’avantage du débat public : nous pouvons retrouver les idées du constituant aux annales parlementaires, dont près de 400 pages sont consacrées aux travaux constitutionnels. Nous n’avons donc pas à nous plaindre comme le fit Gonidec pour les constitutions des Etats de la communauté française au sujet desquelles « on en est réduit aux hypothèses du fait que les travaux préparatoires n’ont pas été publiés, ce qui est regrettable ». D’autre part, un caractère parfois hybride et des solutions originales mais pas toujours cohérentes résultent de ce procédé. Les travaux préparatoires ne nous aident cependant que pour les débats de la constituante, mais pas pour la recherche des sources d’inspiration du texte qui lui fut soumis. La proposition de constitution, déposée par 37 députés, ne fut en effet pas assortie d’un exposé des motifs. On se rappelle qu’un des rédacteurs principaux de cette proposition, le ministre de la Justice A. Makuza, avait indiqué comme sources principales la constitution française de 1958, les constitutions de certains Etats de la Communauté française (Haute-Volta, Madagascar, Mauritanie et Sénégal) et la constitution de la Guinée. En l’absence de plus amples précisions ce n’est que par une analyse comparative de textes que nous avons pu établir la parenté de la proposition de constitution. Il faut clairement souligner que notre recherche comparative a porté sur cette proposition et non sur la constitution définitivement adoptée ; c’est important puisque nous avons vu que certaines dispositions ont connu un cheminement parfois considérable avant d’être définitivement fixées.
En ce qui concerne les grandes lignes du régime politique instauré par la constitution rwandaise, regardons d’abord les éléments où la parenté avec le système « français » se révèle. Comme dans les Etats de la Communauté française avant leur indépendance, l’équilibre entre les pouvoirs est du type parlementaire. Alors que dans les pays de la Communauté le parlementarisme est toutefois rationalisé, au Rwanda il ne l’est quasiment pas. On retrouve les deux éléments du régime parlementaire : la responsabilité politique du gouvernement et le pouvoir de dissolution. Au Rwanda, ce dernier est pourtant fort limité, ce qui nous a permis de conclure à la prédominance théorique du parlement. Le Rwanda a adopté le système de certains pays de la Communauté et notamment le Sénégal et le Gabon. En effet, d’une part, le président est lui-même politiquement responsable devant le parlement ; il n’y a aucune trace d’orléanisme comme celui prévu par l’art. 49 de la Constitution française. D’autre part, le pouvoir de dissolution n’est pas aussi discrétionnaire que dans les systèmes belge et français : l’art. 24 de la constitution sénégalaise, par exemple, prévoyait que la dissolution n’était possible que « si au cours d’une période de trente-six mois consécutifs, deux crises ministérielles surviennent ». L’art. 96 de la proposition rwandaise (art. 97 du texte définitif) lui fait écho : « Si au cours d’une période de trois ans consécutifs interviennent plus de deux crises ministérielles (…) l’Assemblée législative est dissoute de plein droit. » Si dans les formulations la source est évidente, il faut tout de même signaler que le régime parlementaire est également celui de la Belgique et que le Rwanda avait déjà connu, sous l’autonomie interne, une expérience relativement courte de parlementarisme ; ainsi, l’art. 33 de l’ord. lég. n° R/93/29 du 10 mai 1962, le dernier texte sur l’organisation politique avant l’indépendance, stipulait qu’en cas de vote d’une motion de censure concernant l’ensemble du gouvernement, « le président de la République et les ministres remettent leur démission à l’Assemblée ».
Si, en France, l’exécutif est bicéphale, le monocéphalisme exécutif fut introduit dans les pays de la Communauté pour des raisons d’économie budgétaire et de concentration du pouvoir. C’est également la solution adoptée par le Rwanda, bien que le régime instauré par la « Constitution » de Gitarama fût bicéphale (président de la République et premier ministre). On remarque également que, contrairement à ce qui existe en France, il n’y a pas, dans les pays de la Communauté et au Rwanda, d’incompatibilité entre la fonction de ministre et celle de député. Quant à l’élection du président de la République, la proposition de constitution avait retenu le système de la plupart des pays de la Communauté, c’est-à-dire l’élection indirecte par l’Assemblée législative. Nous avons vu que ce n’est qu’au cours des débats que l’Assemblée constituante adopta l’élection directe pour le Rwanda, et qu’elle introduisit par ce fait même une incohérence structurelle dans le système.
En troisième lieu, les libertés publiques sont garanties au Rwanda de manière assez complète. On sait que la constitution française de 1958 ne protège pas les droits de l’homme dans le corps du texte. Dans le préambule, « le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ». Certains pays d’Afrique francophone ont suivi cet exemple. Le plus souvent les libertés publiques sont cependant mentionnées dans le préambule et reprises par quelques dispositions dans le corps du texte. Dans quelques rares cas, la constitution comporte une protection plus détaillée ; parmi ceux-ci figure la constitution du 24 janvier 1959 du Sénégal, qui a très fortement inspiré les rédacteurs de la constitution rwandaise. Une quinzaine d’articles du texte rwandais reprennent presque mot pour mot les dispositions correspondantes de la constitution sénégalaise, dont la structure du titre sur les libertés publiques (personne humaine, mariage et famille, éducation, religions et communautés religieuses, travail) fut également imitée.
Voilà pour les grandes lignes du régime politique. Dans d’autres domaines, plus particuliers, l’inspiration des constitutions de la Communauté française fut également très marquée: système monocaméral avec une chambre élue directement au suffrage universel, organisation du pouvoir judiciaire (p. ex. une Cour suprême avec plusieurs sections spécialisées, Conseil supérieur de la magistrature…), contrôle préalable de la constitutionnalité des lois, octroi au président de la République d’un pouvoir spécial de législation par ordonnance (-loi) en cas d’urgence. Il y a, par contre, un domaine où la rupture avec le système « français » est nette. En effet, le domaine de la loi est illimité. L’art. 34 de la constitution française et, dans son sillage, les constitutions des Etats de la Communauté ont adopté un partage de la fonction normative où le domaine de la loi est délimité par rapport à celui du règlement. Au Rwanda, le principe belge, repris dans la Charte coloniale, que « la loi intervient souverainement en toute matière » fut suivi. Il faut toutefois noter que la constitution de la Guinée, citée par A. Makuza comme source d’inspiration de son travail de rédaction, a adopté le même système : l’art. 9 de la Constitution guinéenne du 10 novembre 1958 stipule en son deuxième alinéa que « le domaine de la loi est illimité ».
Nous n’avons parcouru ici que les grandes lignes du régime politique proposé par le texte introduit par le ministre Makuza. Ces grands traits, à part le mode d’élection du président de la République, sont également ceux de la constitution définitivement adoptée. Cette analyse comparative permet de cerner l’importance relative des différentes sources d’inspiration. Il est clair que le texte utilisé en premier lieu est la constitution sénégalaise, et donc également la constitution française qui en est la constitution-mère. Là où les textes français et sénégalais diffèrent, la solution sénégalaise a généralement été préférée. En outre, pour certaines dispositions spécifiques les constitutions mauritanienne et guinéenne ont été utilisées. Exceptionnellement, à quelques rares endroits, la tradition belge se fait également ressentir. Quelques dispositions viennent enfin de la « Constitution » de Gitarama, qui ne s’appuyait pas de façon évidente sur des sources étrangères. Dans son ensemble, la constitution est donc d’inspiration « française ». Pour expliquer ce choix de sources d’inspiration on devrait savoir de quel les informations les rédacteurs de la proposition constitutionnelle disposaient. Pour une simple raison de date de publication, nous pouvons avancer une hypothèse. L’ouvrage de P.F. Gonidec, Constitutions des Etats de la Communauté, date de 1959 ; la collection de D.G. Lavroff et G. Peiser, Les constitutions africaines, ne parut que vers la fin de 1961 et les rédacteurs rwandais n’ont donc pas pu consulter les textes des constitutions de ces Etats.
Elle est cependant confirmée par l’analyse des textes, puisqu’il y a une différence indéniable entre les constitutions des Etats de la Communauté et les premières constitutions de ces mêmes Etats devenus complètement indépendants. Ce qui est certain, information prise auprès des juristes belges présents à l’époque, c’est que les textes ont été rédigés par les politiciens rwandais eux-mêmes, sans aide substantielle de conseillers belges. Le contraire aurait d’ailleurs probablement provoqué une influence plus pesante du système constitutionnel belge au détriment du choix français, qui maintenant est incontestable.
Cette préférence pour la France s’explique aisément lorsqu’on regarde la genèse du régime rwandais. Les idées maîtresses et la rhétorique des révolutionnaires trouvaient leur inspiration dans la révolution française. Les membres du congrès de Gitarama voulaient « assurer à nous-mêmes et nos générations futures la prospérité et les bienfaits de la liberté » (préambule de la « Constitution » de Gitarama) ; ils instituèrent un régime républicain basé sur la justice sociale. Pour eux, l’idée républicaine était française, tandis que l’héritage constitutionnel belge était assimilé au régime monarchique. Cette constatation est confirmée à contrario par une comparaison avec la constitution burundaise du 13 octobre 1962 : les Barundi en sauvegardant le régime monarchique adoptèrent la structure, le contenu et les équilibres de la constitution belge, même si, contrairement aux Rwandais, leur relation avec la Belgique était plutôt mauvaise. Beaucoup de détails sont significatifs dans ce contexte ; on pourrait ainsi opposer l’intitulé « République Rwandaise » (République française) à « Royaume du Burundi » (Royaume de Belgique); au Burundi, les subdivisions territoriales sont appelées « provinces » comme en Belgique, tandis qu’au Rwanda il est question de « préfectures » comme en France.
https://amateka.org/regime-et-institutions-politiques-des-annees-1960/https://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20200904_174153A.jpghttps://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20200904_174153A-150x140.jpgLes républiquesArticles De La Constitution Des 111 articles que compte la constitution finalement adoptée, la moitié environ ont gardé le même contenu que le projet initial si l'on fait abstraction de modifications linguistiques, stylistiques ou techniques. Il n'est malheureusement pas possible de reproduire ici les textes tels qu'ils ont évolué au...Kaburame Kaburamegrejose2001@yahoo.co.ukAdministratorAmateka y'u Rwanda
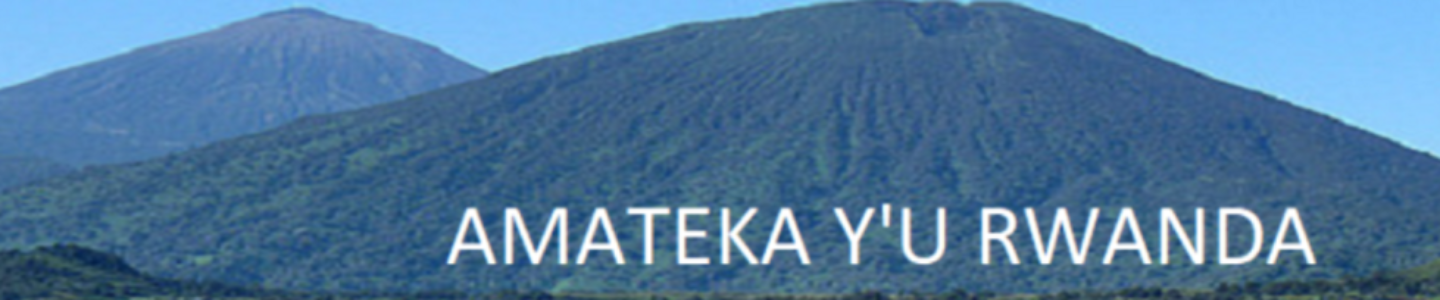



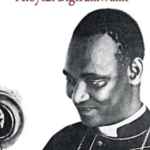






Laisser un commentaire