Le Fonctionnement des institutions De La Première République (III)
La Cour suprême
Généralités
Une des institutions supérieures créées par le Congrès national de Gitarama le 28 janvier 1961 fut la Cour suprême. Le président Dominique Mbonyumutwa désigna Isidore Nzeyimana comme président de cette cour et D. Shamukiga, Cl. Ndahayo, N. Sekerere et Fr. Ackerman comme conseillers. En l’absence’ d’une consécration juridique de cette juridiction par la puissance de tutelle, la cour ne pouvait fonctionner effectivement et elle demeura essentiellement symbolique, tout comme les autres institutions contraires à la législation coloniale. Dans le cadre de l’organisation judiciaire existante, une Cour suprême ne trouvait pas de place utile. Son caractère symbolique fut clairement mis en évidence lorsqu’après les élections législatives, l’Assemblée procéda le 26 octobre 1961 à l’installation des organes du pays. Le président de la République nouvellement élu, Gr. Kayibanda, nomma en effet I. Nzeyimana comme président de la Cour suprême ; en même temps, en vertu de l’ordonnance législative n° 02/336 du 26.10.1961 (qui modifiait l’art. 6 de l’ordonnance législative n° 348141MO du 5 octobre 1943), il désigna D. Mbonyumutwa comme président du tribunal du pays, la seule juridiction supérieure ayant une fonction reconnue par la loi. Le résident général déclara à cette occasion n’admettre que le principe de l’installation d’une Cour suprême. Ce n’est que trois jours avant l’indépendance que l’ordonnance législative n° R/57 du 7 juin 1962 établit formellement une Cour suprême. Pour que celle-ci puisse fonctionner effectivement dans un cadre organisé, il fallut toutefois attendre la loi du 24 août 1962 portant code d’organisation et de compétence judiciaires, un des premiers textes que l’Assemblée nationale se hâta de voter après l’indépendance ; cette loi remplaça l’édit du 20 février 1962 au même sujet qui n’avait pas été mis en pratique. La Constitution du 24 novembre 1962 confirme la position de la Cour suprême au sommet de la structure judiciaire. Cinq sections, dirigée chacune par un vice-président, sont prévues : Cour de cassation, Cour constitutionnelle, Conseil d’Etat, Cour des comptes et Département des cours et tribunaux (art. 103 Const.). la loi organique du 23 février 1963, promulguée en vertu de l’art. 103 Const., porte organisation de la Cour suprême.
Interprétation authentique de la loi (Cour de cassation)
La Cour de Cassation exerce un nombre de fonctions habituelles, notamment : pourvoi de cassation, renvoi pour cause de suspicion légitime, règlement de conflits d’attribution et de contrariétés de jugements et arrêts, jugement au pénal de personnalités jouissant de l’immunité ou du privilège de juridiction… Elle est en outre, et nous nous limiterons à cet élément fort inhabituel, compétente pour donner l’interprétation authentique de la loi. Ce pouvoir appartient normalement au législateur même, parce qu’il est le mieux placé pour déterminer ce qu’il a voulu dire et ensuite parce qu’interpréter authentiquement la loi, c’est faire œuvre législative. Mais s’agit-il vraiment d’une interprétation authentique, c’est-à-dire une interprétation générale et obligatoire, censée avoir toujours fait partie intégrante de la disposition interprétée ? Il semble que ce ne soit pas le cas, puisque l’art. 39 de la loi sur la Cour suprême stipule que cette interprétation dite authentique de la Cour de cassation « s’impose à l’égal d’une jurisprudence constante et unanime ». Or, la valeur d’une telle jurisprudence est limitée dans un pays qui ne connaît pas, comme les pays de la Common Law, le principe du « stare decisis » ou du « binding force of precendent ». La jurisprudence, même constante et unanime, n’a guère qu’une force persuasive et peut donc être renversée à tout moment par toute juridiction, même inférieure ; le législateur lui-même conserve évidemment toutes ses prérogatives, notamment celle de voter une loi infirmant l’interprétation « authentique » de la Cour de cassation. Ceci a amené un auteur à qualifier cette compétence de la cour de supplétive. Les juridictions, l’administration, ni le législateur ne sont donc réellement liés par cette interprétation. Il se peut même que la Cour de cassation se voit elle-même amenée à ne pas appliquer sa propre interprétation authentique dans un cas d’espèce se présentant ultérieurement à son examen.
Ces possibilités peuvent toutes être illustrées par des cas concrets. L’arrêt d’interprétation authentique n° 1/14.01 du 25 octobre 1963 concernait la loi de 1963 sur la Cour suprême, le code d’organisation et de compétence judiciaires, et le code de procédure pénale. A la demande du procureur de la République, la Cour de cassation eut à se prononcer notamment sur le sens de l’expression « arrêts et jugements définitifs » et décida que: « Le pourvoi en cassation peut être formé :
1° contre tout jugement définitif entaché d’un vice de forme ;
2° contre les arrêts de la Cour d’appel entachés d’un vice de fond ou de forme ». Quant au 1°, l’arrêt estimait donc que « définitif » signifie « final » (à l’opposé d’avant dire droit ») et non « rendu en dernière instance ». Cette interprétation implique que le pourvoi direct en cassation contre un jugement de tribunal de canton ou de première instance est recevable. Quant au 2° la Cour décidait qu’un vice de fond peut justifier un recours en cassation, mais uniquement contre un arrêt de la Cour d’appel. Si cette interprétation était critiquable d’un point de vue strictement juridique, elle eut également une conséquence pratique indésirable : il en résulta un afflux de plus en plus considérable de pourvois en cassation pour vice de fond, et donc l’institution d’une nouvelle instance d’appel. Statuant dans le cadre de ses fonctions ordinaires, la Cour se vit obligée de renverser son propre arrêt d’interprétation authentique. Ceci amena deux ans plus tard le vice-président de la Cour de cassation, A. Ntashamaje, suivi par le vice-président du Département des cours et tribunaux, D. Murego, à demander au président de la Cour suprême de modifier formellement la jurisprudence contenue dans cet arrêt d’interprétation authentique. La Cour ne le fit pas, mais elle déclara systématiquement irrecevables les pourvois qui n’étaient pas passés par la procédure ordinaire d’appel. Le même arrêt décidait que les actions contre l’Etat devaient être portées devant le tribunal de première instance de Kigali, « domicile du défendeur » dans l’esprit de la Cour. Cette interprétation ne fut pas observée et, en pratique, tous les tribunaux de première instance se déclarèrent compétents pour connaître de ces actions.
Une autre illustration du problème posé par cette compétence est fournie par l’arrêt d’interprétation authentique n° 5/13.03 du 29 juillet 1967, qui provoqua le grave conflit entre la Cour suprême et l’Assemblée nationale. Cet arrêt interprétait, à la demande du ministre de l’Intérieur et des Affaires judiciaires, les articles 95 et 96 de la loi du 5 juillet 1967 relative au régime électoral, libellés comme suit :
Art. 95 : Le bourgmestre est élu au suffrage direct sur une ou plusieurs listes ne dépassant pas trois candidats par liste.
Art. 96 : L’élection du bourgmestre se fait le même jour que celle des conseillers communaux. Le bourgmestre est le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Il est d’office conseiller communal.
Considérant que la volonté du législateur était de séparer l’élection du bourgmestre de celle des conseillers communaux et de dégager l’autorité du bourgmestre des rivalités politiques, la Cour décida que les candidats bourgmestres ne pouvaient être inscrits en même temps sur les listes électorales des candidats conseillers communaux.
L’Assemblée nationale prit connaissance de cet arrêt lors d’une session extraordinaire convoquée à cet effet le 6 septembre 1967. Dans son introduction au débat, le président de l’Assemblée estimait que « l’interprétation prétendue authentique fut une erreur énorme » et que « si vous n’approuvez pas la Cour de cassation, nous rectifierons ledit arrêt en précisant la volonté du législateur ». Le ministre de l’Intérieur et des Affaires judiciaires Harelimana fut vivement pris à partie parce que « nous nous demandons ce qui a poussé le ministre (…) à réclamer dar-dar l’interprétation des articles à l’adoption desquels il a contribué largement ». Retenons ici que l’Assemblée vota une loi de cinq articles qui annulait en fait l’arrêt d’interprétation authentique de la Cour suprême, puisque l’art. 1, al. 2 stipulait : « Les candidats-bourgmestres peuvent néanmoins se présenter à la fois sur la liste de bourgmestre et celle de conseillers communaux ». De plus, l’Assemblée vota une résolution dont le premier point était libellé ainsi :
« 1° Désapprouve publiquement le peu de sérieux des magistrats de la Cour Suprême ayant rendu ledit arrêt ;
Regrette que ces magistrats éminents ne mettent pas à profit leur compétence;
Exige qu’en matière d’interprétation de la loi, ils étudient à fond les documents de l’Assemblée nationale et consultent celle-ci ».
Le fait que la dernière séance de cette session extraordinaire dura jusqu’à 3h35 heures du matin – fait unique dans les annales parlementaires du Rwanda – est la mesure de l’importance que les députés attachaient au conflit causé par l’arrêt en question. Il va de soi que pareil incident est un risque inhérent à ce type d’ordonnancement de l’interprétation authentique des lois: un autre organe que celui qui l’a adopté est censé interpréter la pensée de l’auteur.
La loi est muette quant à la procédure à suivre en matière d’interprétation authentique. Puisqu’est permis ce que la loi n’interdit pas, il semble qu’une application très large soit indiquée. Ainsi, la question de savoir qui peut saisir la Cour de cassation a-t-elle été réglée de façon extensive. La saisine a été effectuée deux fois par une Cour d’appel, deux fois par un ministre, une fois par le procureur de la République, une fois par le directeur-général d’un Office public et une fois par la Cour de cassation elle-même « pour besoins du service ». On constate que non seulement la Cour de cassation peut rendre un tel arrêt d’office, mais qu’également les juridictions peuvent s’adresser à la Cour par voie de question préjudicielle, que le parquet et l’administration peuvent poser la question et que – c’est ce qu’affirment les auteurs – un simple citoyen peut, en dehors de tout litige, demander l’interprétation d’une règle. L’intérêt qu’ont les particuliers à défendre la loi serait suffisant comme intérêt d’agir en justice. La portée pratique de l’interprétation authentique sous la Constitution de 1962 fut limitée : il y eut en tout et pour tout sept arrêts de ce genre, le dernier en date du 18 août 1976. Le dernier arrêt sous la première République date cependant de 1967.
Contrôle de la constitutionnalité des lois (Cour constitutionnelle)
Nous avons vu plus haut comment la procédure du contrôle de la constitutionnalité des lois par la Cour constitutionnelle se présente en termes généraux. L’art. 57 Const. prévoit que toute loi votée doit être transmise à la Cour suprême (section Cour constitutionnelle) pour que celle-ci se prononce sur sa constitutionnalité. Cette saisine se fait après le vote global du texte en dernière lecture et avant la promulgation par le président de la République. La loi ne peut être promulguée – ainsi le veut l’art. 90 Const. – qu’après la déclaration de la Cour suprême de sa conformité à la Constitution. Si la Cour constitutionnelle déclare la loi non conforme à la Constitution, elle la retourne au président de la République pour renvoi à l’Assemblée nationale en deuxième lecture. La Constitution ne décrit pas la suite de cette procédure, mais il est évident que le parlement doit amender le texte dans le sens indiqué afin de ne pas se heurter à une nouvelle censure de la Cour, puisque le texte doit, après la deuxième lecture, être retourné à celle-ci pour qu’elle rende un arrêt de conformité à la Constitution, sans lequel la promulgation ne peut être effectuée. Les articles 44 et 45 de la loi de 1963 sur la Cour suprême reprennent et étendent ces prescrits constitutionnels en ajoutant aux lois les ordonnances, les ordonnances-lois et les décrets lois. Il faut remarquer, en ce qui concerne les « ordonnances », qu’on peut se demander à quels instruments cette expression a trait, puisqu’elles sont inconnues de la Constitution et inexistantes dans la pratique constitutionnelle. Le dernier alinéa de l’art. 44 ne mentionne que les lois organiques et omet de faire état des lois. Lu ainsi, ce texte serait inconstitutionnel puisque l’art. 57 Const. stipule que toute loi votée doit être transmise à la Cour constitutionnelle. Sans doute ne s’agit-il que d’une erreur matérielle dans le texte français puisque le texte en kinyarwanda fait état d’amategeho (lois) sans mentionner le terme amategeko-ngenga (lois organiques). La pratique confirme cette opinion: toutes les lois votées au parlement ont été déférées à la Cour constitutionnelle pour contrôle.
Un auteur a exprimé une crainte analogue à celle, bien connue, du « gouvernement des juges ». « Ainsi la Cour suprême dispose d’une arme redoutable. Elle peut bloquer purement et simplement, puisqu’elle peut déclarer inconstitutionnels, lois, règlements et engagements internationaux. C’est lui confier un très grand pouvoir et risquer une dictature de la Cour suprême, capable de paralyser l’action des autres pouvoirs ». Cette crainte ne s’est cependant pas matérialisée puisqu’entre le 24 novembre 1962, date de l’entrée en vigueur de la Constitution, et le 5 juillet 1973, date de la suspension des dispositions relatives au contrôle de la constitutionnalité des lois par la Proclamation du Haut-Commandement de la Garde nationale, l’impact pratique de la Cour constitutionnelle a été réduit. Sur environ 160 saisines, la Cour n’a été amenée à notre connaissance à prononcer d’arrêt d’inconstitutionnalité qu’à quatre reprises.
Il peut être utile de s’arrêter ici plus particulièrement à l’un de ces arrêts, celui du 26 avril 1966, qui a provoqué une friction considérable entre la Cour suprême et l’Assemblée nationale. Cet arrêt avait trait au projet de loi sur l’éducation nationale voté le 21 avril 1966. La Cour constitutionnelle y relève plusieurs motifs d’inconstitutionnalité. Ainsi, l’art. 4 stipulait que « l’école primaire est gratuite et obligatoire pour tous les enfants domiciliés sur le territoire rwandais sans distinction de race, de clan, de couleur, de sexe ou de religion ». Etant donné que l’art. 34 Const. stipule que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants « dans les conditions à fixer par la loi », la Cour estimait que l’art. 4 du projet voté ne faisait pas suffisamment état de ces conditions et « qu’en particulier la loi ne fait pas ressortir la possibilité d’un enseignement primaire obligatoire et gratuit en prescrivant au gouvernement de doter le pays d’un nombre d’écoles permettant de recevoir tous les enfants en âge de scolarité ». Il est clair que la Cour a confondu ici le caractère de droit subjectif impératif, opposable et susceptible de recours en justice des droits civils et politiques, et le caractère programmatique des droits économiques, sociaux et culturels dont fait partie au Rwanda l’obligation de construire des écoles en nombre suffisant si les possibilités budgétaires le permettent. La Cour critiquait également l’art. 19 du projet voté dont le litt. b prévoyait que « sont établissements publics (…) les établissements scolaires construits avant la promulgation de la présente loi avec une intervention financière de l’Etat (…). Cette disposition était considérée par la Cour comme une atteinte à l’art. 23 Const. qui protège la propriété privée.
La Cour estimait que « les écoles ainsi construites sont la propriété des associations religieuses » et que « la mainmise de l’Etat sur ces écoles ne pourrait s’effectuer que dans le cadre d’une expropriation justifiée par l’intérêt public et moyennant une juste et préalable indemnisation ». Cette critique était sans doute justifiée.
La Cour relevait également que le projet stipulait que le personnel laïc de l’enseignement libre serait nommé et révoqué par le ministre de l’Education nationale et qu’il serait soumis au statut des fonctionnaires de l’Administration centrale. Elle en déduisait que « les responsables de l’enseignement privé n’ont ainsi aucun droit de se choisir et de proposer au ministre des collaborateurs qu’ils jugent les plus aptes à assurer l’éducation qu’ils entendent légitimement dispenser » et concluait que ce procédé constituait la négation du principe constitutionnel de la liberté d’enseignement. On peut signaler enfin que l’art. 58 du projet fixait le traitement des enseignants-religieux à 80% de l’échelle légale pour le personnel laïc de même rang et compétence. La Cour, invoquant l’art. 16 Const. sur l’égalité jugeait que la différence de traitement basée sur le seul critère de l’état religieux constituait une discrimination. L’arrêt décidait en conclusion que la loi sur l’éducation nationale ne pouvait être promulguée qu’après révision des articles 4, 19, 36, 37, 55, 58 et 61. Ce fut fait en deuxième lecture et la loi fut promulguée le 27 août 1966. Il n’est pas certain que le texte voté en deuxième lecture ait été préalablement retourné à la Cour constitutionnelle ; toujours est-il que le texte finalement adopté et promulgué ne rencontre que partiellement les observations de la Cour constitutionnelle, mais il se peut que la Cour ait préféré ne pas insister lors de la deuxième saisine, si elle eut lieu.
L’Assemblée nationale n’était pas près d’oublier cet arrêt. Plus d’un an plus tard, lors de la discussion de l’arrêt d’interprétation authentique de la loi électorale dont -il a été question plus haut, le député A. Rutabagisha rappelait à ses collègues que « ce n’est pas pour la première fois. La Cour suprême a écouté favorablement les Evêques (et) c’est pour cela que la loi scolaire fut taxée d’inconstitutionnalité ». Un autre député, A. Munyarugerero, s’attaquait aux conseillers mêmes composant la Cour :
« Le personnel ne sert pas de tout cœur le parti. Voyez des gens comme Munyangaju Aloys, c’est un ancien de l’Aprosoma. Il n’est pas un Parmehutu convaincu. Ntashamaje, c’est un mututsi ; Apollinaire Nsengiyumva également. Ce n’est pas étonnant que la Cour suprême ne semble pas montrer tout son sérieux ». A part la question de savoir si un bon magistrat doit être « Parmehutu convaincu » ou Hutu tout court, on ne peut manquer de remarquer que les trois conseillers cités de cette façon, Munyangaju, Ntashamaje et Nsengiyumva, étaient précisément ceux qui avaient rendu l’arrêt d’inconstitutionnalité de la loi sur l’éducation nationale… Ce fut le dernier arrêt d’inconstitutionnalité rendu sous la Constitution de 1962. L’affirmation d’indépendance de la Cour suprême évolua donc de façon parallèle à celle de l’Assemblée nationale, dont la critique s’estompa après 1968. Déclarer inconstitutionnelle une loi revenait à critiquer le gouvernement, puisque celui-ci fut à l’origine de quasiment toute la législation. L’autre hypothèse, celle de la conformité de toute la législation à la Constitution depuis 1967, est peu probable; nous aurions pu étudier cette législation et tenter d’y relever des inconstitutionnalités, mais cela nous aurait mené trop loin. On peut cependant constater qu’il serait étonnant qu’il y ait eu quatre cas d’inconstitutionnalité entre 1962 et 1966, et plus aucun au cours des sept années suivantes. On est dès lors en droit de supposer que la Cour devint de plus en plus inhibée dans l’exercice de son activité ; cela se situe d’ailleurs bien dans la ligne de l’évolution politique de cette période, marquée par un autoritarisme croissant.
Juridiction administrative (Conseil d’Etat)
En vertu de l’art. 102 Const. et des articles 48 à 55 de la loi de 1963 sur la Cour suprême, les fonctions du Conseil d’Etat sont multiples et variées:
(a) trancher les différends d’importance entre l’Etat et les particuliers ;
(b) trancher les conflits institutionnels opposant les différents organes de l’Etat ;
(c) trancher les conflits d’attribution entre autorités administratives et judiciaires ou entre plusieurs sections de la Cour suprême ;
(d) veiller à la régularité des élections et autres consultations populaires ;
(e) statuer sur les recours en annulation contre les actes du pouvoir exécutif ; (f) connaître des pourvois en cassation contre les décisions des juridictions et autorités administratives ;
(g) exercer un droit d’initiative réglementaire indirecte ;
(h) donner des avis sur les requêtes en obtention de la nationalité rwandaise.
Le Conseil d’Etat de la Cour suprême « tranche les conflits institutionnels opposant les différents organes de l’Etat » (art. 102, e Const. et art. 48, loi de 1963). On pourrait notamment s’imaginer un désaccord permanent entre le gouvernement et le parlement, si par exemple ce dernier refusait systématiquement de voter les projets de loi introduits par le gouvernement, sans pour autant provoquer les deux crises gouvernementales en trois ans qui -en vertu de l’art. 97 Const. – aboutissent à la dissolution de l’Assemblée nationale. Dans ce cas le blocage du fonctionnement des institutions serait évident, bien que le pouvoir exécutif aurait toujours l’ordonnance-loi sous la main. Telle était d’ailleurs peut-être l’hypothèse de l’art. 72 Const. qui prévoit plus explicitement que « tout désaccord institutionnel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, non réglé par la présente constitution, est soumis à l’avis consultatif de la Cour suprême ». En l’absence de pratique ou de jurisprudence en la matière on ne voit pas très bien quelle pourrait être la nature de cette saisine du Conseil d’Etat, ni sa procédure, ni par qui et comment elle pourrait être introduite, ni la nature et l’effet de l’avis donné.
Il semble dès lors que cette procédure ne pourrait en pratique être utilisée et on conçoit d’ailleurs assez mal l’arbitrage du Conseil d’Etat entre les pouvoirs législatif et exécutif, étant donnée surtout la « répugnance de l’exécutif à remettre au pouvoir judiciaire, fût-ce en sa formation suprême, le soin de rendre un arbitrage qui s’impose aux deux autres pouvoirs ». Pareille intervention risquerait de mener à un engagement délicat du Conseil d’Etat dans des querelles politiques qu’il devrait en fin de compte appartenir à l’électorat de résoudre. Au cours de cette procédure inhabituelle, « le différend est réglé par voie de référendum » (art. 72 Const.) en cas de persistance du désaccord. Ici encore, on est en droit de se demander comment une solution pourrait être atteinte de cette façon, étant donné notamment les difficultés de formulation d’une question à soumettre à la population lors du référendum. Le jeu parlementaire normal eût semblé plus indiqué, c’est-à-dire que l’Assemblée oblige le président et son gouvernement à démissionner. La population arbitrerait alors par voie d’élection présidentielle ou, dans le cas prévu par l’art. 97 Const., par voie d’élections présidentielle et législatives simultanées. Bien qu’elle soit difficilement applicable et que les conflits qu’elle entendait régler ne se produisirent pas, cette procédure était une expression de la volonté du constituant rwandais de 1962 de permettre le plus possible à la population de s’exprimer directement. Il ne faut pas oublier que c’est un référendum qui légalisa la révolution dont est issu le régime.
« Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, est le juge suprême de droit commun en matière administrative. Il statue souverainement sur les recours en annulation pour violation des règles de fond et de procédure, pour incompétence ou pour excès de pouvoir, formés contre les décisions prises en dernier ressort par les pouvoirs publics et les autorités administratives ou juridictionnelles ». Cet énoncé de l’art. 53 de la loi de 1963 sur la Cour suprême formule le pouvoir d’annulation de façon vaste, vague et ambiguë. Il semble grouper notamment le contentieux de l’annulation et le recours en cassation en matière administrative. En l’absence de juridictions administratives, il ne peut s’agir en pratique que du contentieux de l’annulation. Le nombre d’arrêts rendus par le Conseil d’Etat dans le cadre du contentieux de l’annulation fut extrêmement réduit ; de 1962 à 1973, il n’y eut que 36 arrêts. La grande majorité de ces affaires ont une portée limitée (nominations, promotions, révocations, mesures disciplinaires, etc.). De ces 36 arrêts onze seulement portent annulation totale ou partielle. Huit arrêts relèvent du contentieux de la fonction publique ; les trois autres annulent des décisions en matière d’allocations familiales, d’assignation à résidence surveillée et de vente aux enchères d’une maison abandonnée par un réfugié. On admettra qu’onze arrêts d’annulation dans la période de douze ans que couvre la première République, c’est vraiment peu, surtout si l’on se rappelle le nombre élevé d’instances d’arbitraire administratif relevées par les commissions parlementaires d’enquête de 1964 et 1968.
La rareté de jurisprudence administrative s’explique en partie par la réticence des justiciables à saisir le Conseil d’Etat ; celle-ci est due au fait qu’ils n’osent pas s’opposer à l’Etat. Ils estiment que mieux vaut subir une illégalité que de se comporter en « ennemi de l’Etat ». Il faut dire également que le pouvoir ne stimulait pas les justiciables à faire usage de leur droit de saisir les juridictions, bien au contraire. Le rapport de la commission parlementaire de 1968 signale que la circulaire ministérielle n° 253/Just. du 22 mars 1967 exige que toute plainte contre une autorité publique soit d’abord soumise au conseil communal et au ministère de l’Intérieur ; on ne saurait trouver de base légale à cette mesure, et on comprend bien qu’elle devait servir à inhiber davantage les justiciables dans l’introduction d’actions contre les autorités publiques.
L’ambiguïté de l’art. 53 de la loi sur la Cour suprême a permis au Conseil d’Etat de se déclarer également compétent pour connaître des recours en cassation contre des jugements et arrêts de droit commun chaque fois que l’Etat était en cause. Supposons que l’Etat soit assigné en matière de responsabilité civile devant un tribunal de première instance ; l’appel contre le jugement rendu par ce tribunal était correctement porté devant la Cour d’appel ; mais en cas de recours en cassation la procédure bifurquait : au lieu de la Cour de cassation on saisissait le Conseil d’Etat qui se déclarait compétent. Cette confusion, qui résultait de la détermination du forum sur base de la qualité d’une des parties en cause et non sur base du type de litige (droit commun ou administratif), subsista jusqu’à l’adoption de la Constitution de 1978.
Indépendance des magistrats
La Constitution est laconique: l’art. 45 énonce le principe de la séparation des trois pouvoirs, l’art. 98 affirme que « le judiciaire constitue une autorité indépendante du législatif et de l’exécutif » et l’art. 105 soumet la Cour suprême, et implicitement toutes les juridictions, à l’autorité de la loi seulement. Aucune garantie d’application de ces principes ne se trouve inscrite dans la Constitution. Il faut remarquer d’abord que l’indépendance des magistrats est affirmée sans que soit offerte la garantie qui en est un symbole important et un élément essentiel : l’inamovibilité ; celle-ci se révèle pourtant essentielle surtout en période de crise quand les intérêts des particuliers et de l’Etat sont souvent en contradiction. Pour Verhelst, cette situation, fréquente en Afrique francophone surtout, s’explique « en partie par le refus de conférer un statut définitif à des magistrats nommés au lendemain de l’indépendance et ne disposant pas de toute la formation professionnelle requise. On veut de la sorte éviter que de jeunes candidats parfaitement formés se voient refuser tout débouché dans la magistrature aussi longtemps que les juges nommés avant eux n’arrivent à l’âge de la retraite ». Au Rwanda, cette raison était applicable par excellence : au moment de l’indépendance, aucun Rwandais ne possédait de doctorat ou de licence en Droit. Après l’éviction entre 1959 et 1961 des juges tutsi et le départ précipité des magistrats belges au moment de l’indépendance, il avait bien fallu nommer un grand nombre de magistrats sans formation académique ni expérience judiciaire. Ce n’est qu’avec la nomination de Fulgence Seminega comme président de la Cour suprême en septembre 1963 que le premier diplômé en droit fut affecté dans la magistrature. La situation ne s’améliora que fort peu jusqu’en 1977, année de la première promotion de licenciés en droit de l’Université nationale du Rwanda. Donat Murego, docteur en droit de l’U.C.L., fut vice-président de la Cour suprême de 1965 à 1970 ; Juvénal Muganga (U.L. B.) fut conseiller juridique à la Cour de 1970 à 1973; Apollinaire Nsengiyumva (Institut des Hautes Etudes d’Outre-Mer, Paris) fut vice-président de 1965 à 1974; enfin A. Ntashamaje (U.C.L.) occupa la même fonction de 1965 à 1976. Ce fut tout pour l’entièreté de la magistrature, tant assise que de bout, sous la première République. On comprend mieux maintenant que la garantie de l’inamovibilité ne pouvait être accordée.
En l’absence de cette garantie, une certaine indépendance est procurée par l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature (C.S.M.), qui n’est pas prévu par la Constitution mais par la loi du 25 mars 1963 portant statut de la magistrature. Après une nomination à titre provisoire pour une période de quatre ans, les magistrats peuvent être nommés à titre définitif. Ces nominations, aussi bien à titre provisoire qu’à titre définitif, sont faites par le président de la République sur une liste de candidats dressée par le C.S.M. Les magistrats à titre définitif sont nommés pour trente ans de service effectif, mais ce terme peut être prolongé par le président de la République, de l’avis conforme du C.S.M. La limite d’âge est en tout cas fixée à 70 ans. Le président de la République ne peut mettre fin d’office à la carrière d’un magistrat nommé à titre définitif que sur l’avis conforme du C.S.M. et sur constat que sa conduite, son travail ou ses aptitudes ont cessé de répondre aux obligations de sa charge. Ces règles souffrent une exception : en vertu de l’art. 104, al. 3 Const. le président et les vice-présidents de la Cour suprême sont révoqués par le président de la République après avis conforme de l’Assemblée nationale et du gouvernement réunis ensemble.
L’intervention du C.S.M. par voie d’avis conforme pour la révocation des magistrats nommés à titre définitif offre certaines garanties pour l’indépendance de la magistrature. Institué pour cette raison, la participation du pouvoir exécutif à ce conseil est extrêmement réduite. En sont membres : le président de la Cour suprême, qui préside, le ministre de la Justice, les vice-présidents de la Cour suprême, les présidents des Cours d’appel, deux présidents de tribunal de première instance et cinq juges-présidents de tribunal de canton. Le pouvoir exécutif est donc largement minoritaire. Il faut cependant noter que les membres du C.S.M., sauf ceux de droit, sont nommés par le président de la République pour quatre ans renouvelables ; ils dépendent donc dans une certaine mesure de l’Exécutif.
Un deuxième élément visant à accroître l’autonomie du pouvoir judiciaire constitue une caractéristique originale de la Constitution de 1962. En partie le pouvoir judiciaire s’auto-administre en effet par le biais d’une des sections de la Cour suprême, le département des cours et tribunaux, dans quelles conditions il fut inséré dans la Constitution. Cette section, gui n’a pas de fonctions judiciaires, exerce envers les juridictions des fonctions administratives qui sont normalement exercées par le ministère de la Justice. Elle a des compétences en matière de sélection des candidats magistrats, d’administration du personnel, de direction et de contrôle général des cours et tribunaux, mais elle ne gère pas le budget de la justice ; cette dernière attribution revient au ministère de l’Intérieur et des Affaires judiciaires. Le département des cours et tribunaux peut également informer les juridictions inférieures sur un point de droit matériel ou de compétence. Un exemple de la mise en pratique de cette attribution est donné par Verhelst : une circulaire du vice-président du département informa les tribunaux de canton qu’il leur était interdit de connaître des affaires de divorce et de séparation de corps. La loi interdit cependant d’enjoindre ou d’interdire à une juridiction inférieure régulièrement saisie de juger dans un sens déterminé ou d’intervenir d’une façon quelconque qui soit incompatible avec l’indépendance des magistrats du siège.
Qu’en est-il dans la pratique de l’indépendance des magistrats? L’image n’est guère encourageante. Il y a d’abord le phénomène d’une politisation progressive du pouvoir judiciaire, de la Cour suprême surtout. Une personnalité d’une certaine importance de la deuxième République, Th. Lizinde, note :
« Ce système (…) n’a fait que politiser tout l’appareil judiciaire, en introduisant dans ses rangs des critères politiques (…). Les insignifiantes garanties accordées aux magistrats, leur mutation inconsidérée, leur traitement minime enlisèrent le magistrat et le portèrent à soutenir à coup d’intrigues et de prébendes (…). La Cour suprême, créée pour garantir la discipline des magistrats et la coordination de la légalité, s’est perdue dans les intrigues de la ‘cour royale’, laissant littéralement le juge faire ce qui lui plait ».
Bien que l’auteur de ces lignes ait contribué au renversement du régime qu’il critique dans ces propos, ce qui incite à une certaine réserve, cette analyse est correcte. Pour illustrer l’état de la Cour suprême, nous reprenons à présent quelques incidents, connus comme des « affaires de la Cour suprême », provoquées par cette politisation et des conflits d’ordre purement personnel.
Nous avons déjà vu que plusieurs conflits opposèrent la Cour suprême à l’Assemblée nationale à l’occasion de litiges particuliers. Ces conflits concrets étaient coiffés jusque fin 1965 par « l’affaire de la Cour suprême », la perception d’un malaise persistant au sein de cette haute juridiction. Il y eut en fait deux « affaires de la Cour suprême ». Nous relaterons la première plus loin. C’est la révocation, suite notamment à l’affaire NZERUKA, de I. Nzeyimana comme président de la Cour suprême et le litige opposant les ministres Mulindahabi et Rwasibo au sujet de la succession de Nzeyimana. Au lieu d’être remplacé par le vice-président Cl. Ndahayo, il le fut par un nouveau venu, F. Seminega. Ce dernier « fut parachuté en quelque sorte dans un marais dont il ignorait la profondeur et la température ». En septembre 1964, le rapport de visite parlementaire signalait encore que la Cour suprême « est divisée à un degré extrême. Cette division, caractérisée par une complexité et des interférences inextricables, engendre des conflits irréductibles à l’intérieur même de la Cour suprême et se prolonge jusqu’au parquet ».
La deuxième « affaire de la Cour suprême » vint sur le tapis à l’Assemblée nationale le 8 juillet 1965, suite à une lettre adressée à l’Assemblée par Cl. Ndahayo, vice-président du département des cours et tribunaux. Vu que la possibilité de la révocation d’un ou plusieurs vice-présidents de la Cour existait, l’Assemblée décida en vertu de l’art. 104 Const. de se réunir en session commune avec le gouvernement. Les quatre vice-présidents étaient mis en cause. Il y eut un antagonisme prononcé entre les vice-présidents J. Hakizimana (Conseil d’Etat) et J.B. Sagahutu (Cour de cassation) d’une part et les autres membres de la Cour de l’autre. Au niveau individuel, le vice-président N. Sekerere (Cour des comptes) était accusé, notamment par le président Seminega, d’incapacité professionnelle et de menus détournements, et Cl. Ndahayo était traité d’ubunyenzi. Ces accusations furent ouvertement présentées à l’Assemblée. L’imbroglio était donc complet et tout travail intègre et compétent devenu impossible. En avril 1965, le président de la Cour suprême convoqua, à la demande du président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci décida de suspendre Sekerere de ses fonctions sans traitement. En juin, Ndahayo fut également suspendu avec retenue de 40% de son traitement. Deux tendances se dégagèrent lors du débat sur cette affaire à l’assemblée nationale. La première voulait prendre tout de suite les mesures qui s’imposaient à l’encontre des vice-présidents mis en cause. La seconde proposait la création d’une commission spéciale. Cette dernière tendance l’emporta, puisque l’Assemblée décida de créer une commission spéciale ; la tâche de faire rapport fut confiée aux députés B. Bicamumpaka, J.B. Rwasibo, A. Rugira, C. Habamenshi, A. Munyangaju et W. Banzi. Il ne semble cependant pas que cette commission ait fait rapport à l’Assemblée. Il ne fut en tout cas plus question de cette affaire aux annales parlementaires.
Cela n’empêcha pas le président de la République de démettre les vice-présidents Ndahayo, Sagahutu, Hakizimana et Sekerere par arrêté présidentiel n° 126/13 du 17.7.1965. Ils furent remplacés par D. Murego, A. Ntashamaje, A. Nsengiyumva, S.Kamali et A. Munyangaju, nommés par les arrêtés présidentiels n° 121/13 à 125/13 datés du 21.7.1965. Le président de la République tenta ainsi de régler le problème en faisant table rase, exception faite pour le président Seminega qui resta en fonction. Ces révocations et nouvelles nominations étaient clairement inconstitutionnelles, puisque, comme nous l’avons vu, la révocation des vice-présidents de la Cour suprême ne pouvait se faire que sur avis conforme de l’Assemblée nationale et du gouvernement réunis en commun ; les nominations, quant à elles, auraient dû être faites sur une liste de candidats présentés par l’Assemblée nationale et le gouvernement. Ce n’est pas la première fois que nous devons constater que l’Assemblée ne s’opposa pas à cet empiètement sur ses prérogatives. Un produit secondaire de cette opération fut une professionnalisation accrue de la Cour suprême. Si aucun des anciens vice-présidents n’était juriste, trois diplômés universitaires en droit y firent leur entrée : Murego, Ntashamaje et Nsengiyumva. La situation à la Cour suprême restait cependant fondamentalement la même et le malaise ne disparut pas pour autant. Le rapport de la commission parlementaire d’enquête de 1968 n’eut que peu d’éloges pour la juridiction suprême. Le président de la Cour F. Seminega avait refusé toute collaboration en invoquant la séparation des pouvoirs, ce qui fit dire au président de l’Assemblée que « c’est un tour qu’elle (la Cour suprême) voulait nous jouer ». Bien que la commission n’ait pu enquêter directement, elle s’était fait informer par d’autres sur « ce qui se fait à Nyabisindu, Nyanza dans le temps, foyer du féodalisme et des intrigues qui vont avec ce féodalisme, qui y subsiste encore… ». Le rapport critiquait la mésentente entre le président et les vice-présidents de la Cour, le fait que le président s’occupait plus de politique que de ses fonctions judiciaires, les abus et les gaspillages, le retard dans le traitement des dossiers. La commission suggéra l’envoi d’une commission spéciale pour effectuer une enquête sur la Cour suprême. Vu le sort réservé au rapport de la commission d’enquête il n’est pas étonnant que pareille commission spéciale ne fut jamais constituée.
Conclusions
L’impact de la Cour suprême, troisième « institution supérieure » de la République (art. 46 Const.), fut réduit. Nous avons vu que son activité fut limitée entre 1962 et 1973: il y eut, au cours de ces onze années, en tout et pour tout cinq arrêts d’interprétation authentique, quatre arrêts d’inconstitutionnalité et onze arrêts d’annulation d’actes du pouvoir exécutif, soit une moyenne de moins de deux interventions « politiques » par an; la dernière date de 1968 ce qui évoque spontanément le parallèle avec l’Assemblée nationale dont les activités de contrôle de l’action gouvernementale prirent également fin en 1968. Les activités de la Cour ne furent pas seulement quantitativement réduites, mais également qualitativement. Les arrêts d’interprétation authentique eurent trait à des points de droit relativement peu importants et leur impact fut négligeable puisqu’ils furent annulés par le législateur, renversés par le juge ordinaire ou inappliqués en pratique. Quant aux arrêts d’inconstitutionnalité, à part le dernier ils ne traitent d’aucune question importante ; le dernier arrêt, concernant la loi de 1966 sur l’éducation nationale, ne fut que partiellement suivi en deuxième lecture et à plusieurs endroits la loi finalement promulguée ne tient pas compte des objections formulées par la Cour. Les arrêts d’annulation du Conseil d’Etat enfin ont trait à des litiges administratifs sans incidence politique réelle. C’est dire qu’il n’y eut pour ainsi dire pas de jurisprudence constitutionnelle au Rwanda.
Ce manque d’activité constitutionnelle n’a pas permis à la Cour suprême de concentrer ses efforts sur sa fonction judiciaire ordinaire. En 1973 il y avait 18.000 litiges en suspens devant les cours et tribunaux, dont presque 2.000 devant la seule Cour de cassation ; plus de 80.000 affaires étaient en souffrance aux parquets ; plus de 400 millions de Frws. étaient à récupérer. Les rapports des commissions parlementaires d’enquête de 1964 et 1968 nous apprennent que cet état de fait ne résultait pas seulement d’un manque de personnel et de moyens matériels, mais également et surtout d’une productivité judiciaire décourageante ; le rapport de 1964 calcule ainsi une moyenne de seize jugements seulement par mois et par tribunal de première instance. Le rapport de la commission d’enquête de 1968, la dernière source plus ou moins indépendante dont nous disposons, donne une image désolante de la Cour suprême: mésentente profonde entre le président et ses vice-présidents, immixtion dans les affaires du parquet et de la deuxième chambre de la Cour d’appel, refus de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature, activités politiques du président et d’un vice-président, délais injustifiés dans le traitement des affaires et notamment celles revenant à la Cour de cassation élargie. Le rapport conclut : « C’est pourquoi partout dans le pays les gens se plaignent de ce qu’il n’y a pas de justice ; personne ne nie que nous vivons le règne de la contrainte. Les mauvais exemples sont particulièrement néfastes, surtout lorsqu’ils viennent d’en haut ».
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de choses. Il y a d’abord le manque de professionnalisation ; nous avons indiqué qu’il n’y eut à aucun moment sous la première République plus de cinq magistrats détenteurs d’un diplôme universitaire de droit ; ces juristes étaient tous affectés à la Cour suprême. La formation insuffisante de l’ensemble de la magistrature, tant assise que debout, comporte non seulement les risques d’une justice techniquement inadéquate, mais cause également chez les magistrats un manque de confiance préjudiciable à leur indépendance. Il a été question plus haut d’un deuxième élément : l’absence d’inamovibilité. Admettant que cette garantie ne pouvait être offerte, il faut néanmoins constater que les révocations de magistrats furent nombreuses et donnaient parfois une impression d’arbitraire ; les nominations à titre définitif après quatre ans d’essai se firent attendre, ce qui n’était pas pour inspirer confiance aux magistrats. Il y a, sur un plan général, beaucoup d’exemples de non-respect des garanties constitutionnelles et légales, ce qui laissait les magistrats à la merci du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire ne disposant pas des moyens d’imposer le respect de la légalité, c’est le parlement qui est en cause ; l’Assemblée aurait dû veiller plus jalousement à ses prérogatives constitutionnelles. Troisième élément : la politisation. Les présidents Nzeyimana et Seminega, les vice-présidents Ndahayo, Hakizimana et Murego ont joué un rôle politique actif. F. Seminega se porta même candidat à la présidence du Parmehutu en 1965, bien qu’il soit président de la Cour suprême. Des conflits interminables entre membres de la Cour, et entre ceux -ci et d’autres autorités publiques, découlèrent de cet engagement politique. Le régionalisme fut un autre aspect de cette politisation. On le voit : l’image globale est déconcertante. A aucun moment, la Cour suprême ne fut en mesure de réaliser son rôle de troisième pouvoir, à la fois arbitrant les deux autres et protégeant les citoyens et la constitutionnalité.
https://amateka.org/le-fonctionnement-des-institutions-de-la-premiere-republique-iii/https://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20231128_091232.pnghttps://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20231128_091232-112x150.pngLes républiquesLa Cour suprême Généralités Une des institutions supérieures créées par le Congrès national de Gitarama le 28 janvier 1961 fut la Cour suprême. Le président Dominique Mbonyumutwa désigna Isidore Nzeyimana comme président de cette cour et D. Shamukiga, Cl. Ndahayo, N. Sekerere et Fr. Ackerman comme conseillers. En l'absence' d'une...Kaburame Kaburamegrejose2001@yahoo.co.ukAdministratorAmateka y'u Rwanda
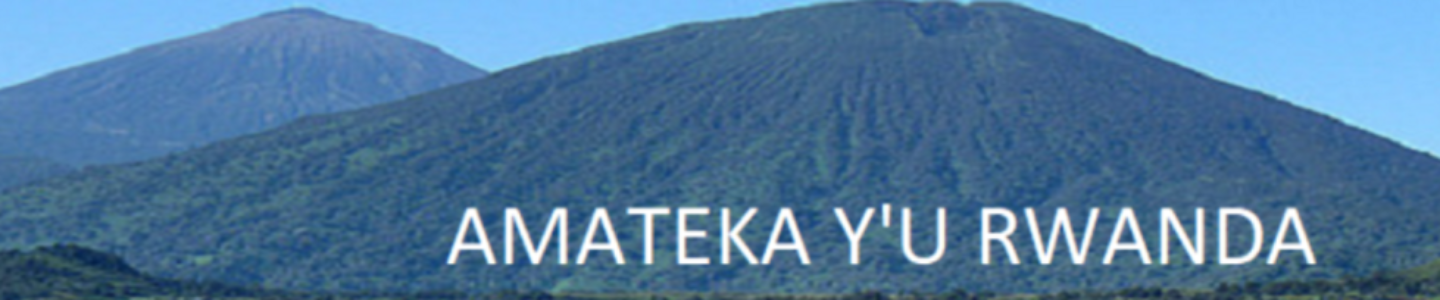



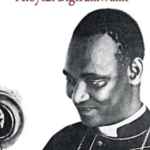






Laisser un commentaire