Le Fonctionnement des institutions De La Première République (II)
Le président de la République
Élection
Au début de chaque législature, le président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité simple des suffrages (art. 52 Const.). On se rappelle que Gr. Kayibanda avait été élu président de la République, non pas au suffrage universel, mais par l’Assemblée législative le 26 octobre 1961 en vertu des ordonnances législatives n° 02/322 du 1.10. 1961 et n° 02/334 du 22.10.1961. Après la promulgation de la constitution du 24 novembre 1962 la position du président Kayibanda n’était dès lors pas conforme à la légalité constitutionnelle. Par une lettre qu’il adressa le 7 juin 1963 au président de l’Assemblée nationale, Kayibanda présenta sa démission comme chef de l’Etat et du gouvernement. Invoquant l’art. 57 Const. il expliqua que « si j’ai attendu – à mon corps défendant – de venir présenter ma démission, c’est que pour le bien du pays, il fallait que toutes les conditions soient réunies pour procéder aux élections, notamment la législation sur le régime électoral (…). Les lois sont des moyens, mais quand on les a, il faut les appliquer. Procédons donc à l’élection d’un président de la République suivant notre Constitution (…). Nous ne pouvons choisir meilleur moment. Les dispositions matérielles pour les élections communales prévues cette année pourront servir également à l’élection présidentielle ». Des rumeurs voulaient que le président de la République envisageait son départ pour se consacrer à la réorganisation de son parti. Comme J. Nyerere, Gr. Kayibanda se retirerait pour le reste de son mandat afin de revitaliser le parti pendant ces deux années et revenir à la tête d’un parti organisé et Fort. Il est plus probable, cependant, que le président voulait démissionner par souci de légalité constitutionnelle et qu’il entendait se faire élire au suffrage universel, ce qui augmenterait sa légitimité et partant son prestige personnel.
Il y avait deux solutions possibles pour résoudre cette « crise ». L’Assemblée nationale pouvait soit accepter la démission et procéder à une élection présidentielle en même temps que les élections communales prévues pour le 18 août 1963, soit amender la constitution et mettre le président en exercice à l’abri des formalités de l’art. 52 par une disposition transitoire. La première solution comportait deux inconvénients considérables. Elle pouvait, d’une part, mettre en cause la validité de tous les actes posés par le président depuis la promulgation de la constitution puisqu’on admettrait implicitement l’irrégularité de sa position depuis cette date ; elle aurait, d’autre part, pour conséquence des mandats présidentiel et législatif non parallèles dans le temps, puisqu’un nouveau parlement devait être élu en 1965, deux ans après le début du mandat présidentiel de quatre ans dans l’hypothèse d’une élection présidentielle en 1963. La majorité de l’assemblée ne voulait pas de cette hypothèse d’autant plus qu’elle entendait s’assurer du maintien de Kayibanda comme chef de l’Etat. La révision constitutionnelle, quant à elle, n’était pas non plus sans poser quelques problèmes. L’art. 107 Const. prévoyait que toute proposition de révision émanant des députés devait être signée par les deux tiers au moins de ceux-ci et que la révision devait être votée par 4/5 au moins des députés composant l’Assemblée. Or le Parmehutu avait 34 députés sur 44 après le départ de V. Kalima. Le parti pouvait donc réunir à lui seul les 30 signatures nécessaires au dépôt d’une proposition de révision, mais pas les 36 voix requises pour le vote de la révision. Il fallait donc s’assurer de la collaboration de l’opposition. Les deux voix de l’Aprosoma pouvaient en principe suffire, mais le président de l’Assemblée contacta l’Aprosoma et l’UNAR qui l’assurèrent de leur soutien à la proposition.
Trente députés du Parmehutu déposèrent une proposition tendant à la révision de la Constitution. L’exposé des motifs considérait notamment que « les travaux préparatoires de la Constitution du 24 novembre 1962 démontrent sans la moindre équivoque que la Constituante de l’époque légiférait pour l’avenir sans aucune intention de remettre en cause le mandat du président alors en exercice; que la présente démission répond à la lettre et non à l’esprit de la Constitution, qui doit cependant être appliquée aussi bien dans sa lettre que dans son esprit; (…) que l’acceptation de cette démission risque de faire peser un doute grave sur la légalité des actes posés par le président en fonction depuis la promulgation de la Constitution, du fait qu’ils seraient considérés comme entachés de nullité parce qu’émanant d’un président désigné inconstitutionnellement ».
A l’unanimité (40 députés votants) l’Assemblée ajouta les deuxième et troisième alinéas suivants à l’art. 108 Const.: « Le président de la République en exercice lors de la promulgation de la Constitution est confirmé dans son mandat qui débute avec la première législature. Les dispositions de l’art. 52 relatives à l’élection du président de la République au suffrage universel direct ne lui sont pas applicables. Le présent amendement sort ses effets en même temps que la Constitution du 24 novembre 1962 ».
Grégoire Kayibanda dut cependant se soumettre au scrutin à partir de 1965. Le congrès national du M.D.R.-Parmehutu le désigna le 27 juin 1965 comme candidat avec 99,8% des voix. Les autres partis ne présentant pas de candidats, Kayibanda fut élu président de la République avec 98,03% des voix. Le pourcentage le moins élevé fut celui des préfectures de Gikongoro, Kigali et Ruhengeri (96%) et le plus élevé celui de Butare (99,9%). Lors des élections du 28 septembre 1969, Gr. Kayibanda était à nouveau le seul candidat à la présidence. Il obtint 99,6% des voix, et plus de 99% dans chacune des préfectures. Ce sont des pourcentages auxquels on s’est habitué en Afrique et qui illustrent la « dynamique des élections sans risque ». En principe, le mandat 1969-1973 aurait dû être le dernier du président Kayibanda, puisque l’art. 53 Const. prévoyait un maximum de trois mandats successifs. On sait que pareille limitation est difficile à maintenir dans la réalité politique africaine. Dans toutes les constitutions africaines de l’époque, sauf celles du Togo (deux mandats), du Rwanda et de la Tunisie (trois mandats), aucune limitation n’était prévue. Une révision dans ce sens avait déjà été suggérée après les élections de 1969 : « il s’agira peut-être de la relève, car c’est le dernier mandat de Gr. Kayibanda. A moins que dans l’entre-temps un amendement de la Constitution n’intervienne, mais il n’est pas encore tard pour y penser ». Et encore : « Sauf révision de la Constitution, il ne pourrait donc plus être réélu en 1973. Il est toutefois fort probable qu’une telle révision soit adoptée ».
Lors d’une grande révision constitutionnelle du 18 mai 1973, l’art. 53 fut en effet amendé dans le sens de la suppression de la limitation du nombre de mandats. Les annales parlementaires de 1973 ne sont malheureusement pas disponibles, mais il semble que cette révision fut acquise à l’unanimité moins l’abstention de J. Gitera Habyarimana, qui estimait que la révision réinstaurait en fait un régime monarchique que la révolution avait voulu abolir. Non obstat cette révision de la Constitution, le troisième mandat du président Kayibanda sera le dernier. Il sera destitué de ses fonctions par la Proclamation du 5 juillet 1973, à peine deux mois avant les élections.
Fonctions et attributions
Les articles 56 et 59 délimitent les pouvoirs du président de la République. Cette délimitation est restrictive : le président n’a d’autres pouvoirs que ceux accordés explicitement par la Constitution ou par la loi. Nous avons vu que le domaine de la loi est en principe illimité et que le pouvoir législatif détient la plénitude et le résidu des compétences normatives. En vertu de l’art. 56 Const. le président de la République, en tant que chef de l’Exécutif, a un pouvoir de nomination (al. a, b, f, g), d’organisation de L’Exécutif (al. c), de gestion de la potitique générale du gouvenement (al. d, e), de gestion des relations extérieures (al. g, h, i, o), de message (al. 1), d’exécution de lois, (al. j, k), de suspension des sessions de L’Assemblée Nationale (al. m), de grâce (al. p), de frappe de la monnaie (al. q) et de prise de mesures d’urgence (al. n). Le président de la République en sa qualité de chef de l’Exécutif est également « chef suprême de l’Armée » (art. 59) et il déclare la guerre et signe l’armistice. (art. 56, al. o). Rappelons qu’en tant que seconde branche du pouvoir législatif, le président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les députés (art. 56, al. j), signe les lois (al. k) et dispose du droit de veto suspensif (al. r). Toutes ces attributions doivent en principe être exercées par voie d’arrêté présidentiel (art. 49, al. 2 Const.).
Comme pour les lois et les ordonnances-lois, on constate une baisse relativement constante du nombre d’arrêtés présidentiels, des pointes en 1967 et 1972 mises à part. Nous ne croyons pas être en mesure de formuler une hypothèse valable pour ces courts regains d’activité ; on peut seulement constater qu’ils correspondent plus ou moins à des phénomènes parallèles dans l’activité législative. Globalement l’activité normative fort réduite du président de la République est frappante ; elle est à peine plus élevée que celle du pouvoir législatif. C’est à première vue une constatation étonnante puisque la réglementation joue un rôle de plus en plus prépondérant au fur et à mesure que l’intervention étatique s’intensifie. La loi, ne pouvant tout prévoir, se limite à l’édiction de normes générales et laisse au pouvoir exécutif ce qui est appelé l’exécution’, qui en réalité comporte fort souvent une spécification normative. L’activité normative réduite du président de la République est plus remarquable encore si on la compare à celle des ministres.
Quel est le domaine d’intervention normative du président de la République ? Y a-t-il dépassement de ses pouvoirs de réglementation ? La question qui doit être posée pour chaque arrêté présidentiel est de savoir si une disposition constitutionnelle ou légale donne compétence explicite au président de la République de légiférer dans le domaine concerné. La réponse peut se trouver dans le préambule de l’arrêté (p. ex.: Vu l’art. x, al. y de la Constitution, ou: Vu la loi du…, spécialement en son art. x), mais en l’absence de pareille référence elle doit parfois être recherchée de manière plus spéculative. Même en adoptant une attitude très clémente et une interprétation très large des textes d’attribution de compétences, on est obligé de constater un grand nombre de dépassements du pouvoir normatif du président de la République. Nous avons relevé, du 1er juillet 1962 au 5 juillet 1973, 25 arrêtés présidentiels de portée générale qui semblent être pris en dehors du domaine attribué au président par la Constitution ou par la loi. Ce nombre est considérable sur un total de 89 arrêtés de ce genre, puisqu’il en représente plus d’un quart. Nous n’avons même pas inclus dans ce chiffre des arrêtés modifiant des ordonnances du gouverneur-général, même si le domaine couvert n’était plus du ressort de l’Exécutif. C’est là un des problèmes de la continuité juridique formelle dans un pays accédant à l’indépendance. Une seule solution s’impose pourtant, la même que celle résultant d’une révision constitutionnelle : la nouvelle règle doit être intégralement appliquée dès son entrée en vigueur, même si elle a trait à une modification de normes auxquelles d’autres règles d’élaboration étaient applicables avant la révision. Après le 24 novembre 1962, le président de la République ne pouvait donc pas estimer qu’une ordonnance devait automatiquement être modifiée ou remplacée par un arrêté présidentiel. L’exception logique à ce principe est évidemment le cas où un acte législatif datant d’avant l’indépendance autorise le gouverneur général – et donc le président de la République – à prendre des mesures d’exécution, à condition que cette délégation ne soit pas implicitement ou explicitement contraire à la constitution.
Nous avons, par contre, inclus des arrêtés présidentiels modifiant des arrêtés présidentiels de la période de l’autonomie interne. Ainsi, l’A.P. n° 37/int. du 28.12.1961 portant statut des fonctionnaires de l’Administration centrale fut modifié par des A.P. du 29.4.1963, du 29.7.1963 et du 17.4.1968, mais il est clair qu’aucune attribution de compétence au président de la République ne pouvait être trouvé en matière de statut organique de la fonction publique. Après 1973, cette matière fut d’ailleurs correctement réglée par acte législatif. Le président de la République ne faisait parfois aucun effort de justification de son intervention : le préambule le plus laconique est celui de l’A.P. n° 135/11 du 16.8.1965 instituant le Fonds d’aide à la construction des écoles du Rwanda (FACER) : « vu l’accord du Conseil des ministres ». Le dépassement des compétences peut parfois même être déduit du texte du préambule. Celui de l’A.P. n° 39/07 du 15.6.1963 fixant les taxes d’embarquement aux aérodromes publics porte : « Revu l’ordonnance législative n ° R/120/51 du 22.6.1962 ». Or, une ordonnance législative est un acte législatif, qui trouve son équivalent dans l’ordonnance-loi. Ainsi également, l’A.P. n° 168/03 du 20.2.1971 portant création de l’Académie rwandaise de culture fait-il référence au décret du 28 décembre 1888 sur les associations scientifiques, religieuses, philanthropiques, etc. Or, ce décret stipule que les institutions en question sont établies par décret, c’est-à-dire par acte législatif.
On pourrait multiplier les exemples, mais il serait fastidieux de s’arrêter à tous ces cas. On retiendra seulement qu’un nombre considérable d’arrêtés présidentiels à portée générale (lois dans le sens matériel du mot) règlent des domaines qui étaient incontestablement du ressort de la loi ou, en cas d’urgence, de l’ordonnance-loi. Ces interventions du président de la République ne sauraient être basées sur la théorie dite de la « compétence réglementaire autonome », à supposer que le droit public rwandais la connaisse. Vivement contesté par une doctrine imposante, ce principe, basé de façon indirecte et vague sur l’art. 67 de la constitution, est admis en Belgique depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 1922 et la loi du 5 juin 1934, qui reconnaît indirectement la réalité du pouvoir réglementaire général de police qui ne se fonde sur aucune loi. Même si cette théorie était admise au Rwanda, elle ne saurait justifier l’intervention du président de la République dans les domaines que nous avons illustrés par quelques exemples ; la théorie ne s’applique en effet qu’au domaine particulier de la police ; or il va de soi que le Fonds d’aide à la construction des écoles, pour ne citer que cet exemple, ne peut être considéré comme une matière de police. Voilà un domaine où l’Assemblée nationale, si elle avait correctement assumé sa fonction de contrôle, aurait au moins dû poser des questions, puisque c’est au dépens de ses prérogatives que ces interventions se faisaient ; or, aucune observation ne fut formulée à ce propos. De même ces arrêtés auraient pu faire l’objet de recours en annulation devant le Conseil d’Etat ou d’exceptions devant les cours et tribunaux, qui en vertu d’une lecture conjointe des articles 92 et 105 Const. ne peuvent appliquer des règlements illégaux ou inconstitutionnels.
Bien que le pouvoir législatif s’exerce normalement par voie de loi, la Constitution prévoit également deux modes exceptionnels d’exercice du pouvoir législatif par le seul président de la République. Le président peut prendre des décrets-lois, délibérés en conseil des ministres, lorsque l’Assemblée nationale se trouve dans l’impossibilité de siéger (art. 75, al. 2 Const.). Le décret-loi a une durée d’application illimitée et ne doit pas être soumis à l’Assemblée pour confirmation. Le parlement n’ayant jamais été dans l’impossibilité de siéger, le président de la République n’a pas été amené à légiférer par décret-loi sous la première République. Après le coup d’Etat du 5 juillet 1973 il y eut bien un exercice du pouvoir législatif par voie de décret-loi, mais celui-ci ne cadrait pas avec le contexte juridique de l’art. 75, al. 2 Const., ne fût-ce que parce que cet article fut parmi ceux « provisoirement suspendus » suite au coup d’Etat. L’art. 75, al. 3 prévoit qu’en cas d’urgence, le président de la République peut exercer le pouvoir législatif par voie d’ordonnance-loi, valable pour six mois seulement, sauf si elle est confirmée par une loi. Le président est en tout cas tenu d’en référer à l’assemblée dans les deux mois. Il était prévisible que, dans un Etat neuf accédant à la souveraineté, il soit fait usage de cette procédure d’urgence.
La baisse du nombre d’ordonnances-lois prises au fil des années semble indiquer qu’un usage correct a été fait de ce procédé qui aurait alors servi à régler d’urgence certains domaines essentiels pour un pays qui vient d’accéder à l’indépendance. Toute cette activité législative ne peut être réalisée par le pouvoir législatif ordinaire pour plusieurs raisons : le processus parlementaire n’est pas particulièrement rapide, le parlement n’est pas toujours en session et, même s’il est en session, son ordre du jour peut empêcher l’examen de tel ou de tel texte, puisque « tout est urgent ». Lorsqu’on examine les domaines dans lesquels des ordonnances-lois sont intervenues durant les premières années, on relève certaines questions urgentes et nécessaires dans un Etat neuf : la prorogation de la législation en vigueur, les passeports, l’immigration, l’immatriculation des étrangers, le contrôle des banques, le recensement et la carte d’identité, l’organisation communale, le contrôle des changes et des prix… D’autres questions auraient, semble-t-il, pu attendre la disponibilité du législateur ordinaire : le Fonds routier, la redevance radio, les immunités diplomatiques, les mines et carrières, la capitale, les douanes, surtout si l’on se rend compte du fait que certains de ces textes ne furent promulgués que plusieurs années après l’indépendance.
On constate une diminution considérable du nombre d’ordonnances-lois à partir de 1966, certainement si l’on exclut les reconductions d’ordonnances-lois prises antérieurement. Cette constatation infirme l’opinion de Verhelst qu’à voir l’ampleur qu’a prise l’ordonnance-loi, on serait tenté d’affirmer qu’il existe réellement une tendance vers l’augmentation du pouvoir présidentiel ». Il est clair que si cette tendance existe c’est pour d’autres raisons et que l’ordonnance-loi est restée une forme exceptionnelle d’exercice du pouvoir législatif. Plus loin, Verhelst lui-même l’admet, disant que « l’efflorescence de l’ordonnance-loi apparaîtra aux yeux de l’historien du droit rwandais comme un phénomène passager, et peu significatif, lié aux premiers pas du pays comme Etat souverain et indépendant » et que « l’usage si fréquent qui a été fait de l’ordonnance-loi de 1962 à 1966 est dû en grande partie aux besoins extraordinairement urgents qui assaillaient le pays peu après l’obtention de sa souveraineté nationale ».
Une véritable coutume constitutionnelle s’est installée dans ce cadre : celle de la reconduction. Certaines ordonnances-lois ont été reconduites de six mois en six mois avant d’être finalement confirmées par une loi. Cette pratique n’est pas prévue par la constitution, mais elle n’y est vraisemblablement pas contraire, bien que répétée souvent elle laisse planer des doutes sur le caractère « urgent » d’une mesure. Techniquement, une ordonnance-loi reconduisant une ordonnance-loi antérieure peut être considérée simplement comme une nouvelle ordonnance-loi, valable pour six mois à moins d’être confirmée par une loi endéans cette période. On trouve une belle illustration de cette pratique dans la législation sur le contrôle des banques : l’ordonnance-loi du 15.3.1963 fut reconduite après six mois par celle du 15.9.1963, reconduite quant à elle six mois plus tard par celle du 14.3.1964, qui fut finalement confirmée quatre mois plus tard par la loi du 14.7.1964. Si la pratique de la reconduction ne semble pas formellement inconstitutionnelle, les dangers de cette procédure sont évidents. Elle permettrait au président de la République de légiférer indéfiniment sans contrôle réel de l’Assemblée nationale, et même contre la volonté de celle-ci. En effet, si elle avait refusé de confirmer une ordonnance-loi, le président aurait pu prolonger son existence à l’infini par des reconductions successives. Cela n’était certainement pas l’idée du constituant et il faut dire aussi que pareille pratique ne s’est pas développée.
Les délais de reconduction ou de confirmation ne furent souvent pas respectés. Sur 31 reconductions par ordonnance-loi ou confirmations par loi, 15 seulement l’ont été endéans les six mois. Les délais de dépassement sont parfois importants ; à l’extrême ils sont de plus de deux ans pour la loi du 23.1.1971 confirmant l’ordonnance-loi du 23.11.1966 sur le registre de commerce, pour la loi du 17.7.1968 confirmant l’ordonnance-loi du 28.10.1965 sur les douanes et pour la loi du 23.1.1971 confirmant l’ordonnance-loi du 1.3.1968 sur l’organisation territoriale. L’ordonnance-loi du 19.5.1969 sur les régies agricoles, des eaux et forêts et d’élevage ne fut jamais ni reconduite ni confirmée par loi, tandis que l’ordonnance-loi du 18.6.1973 portant création de l’O.R.T.P.N. ne fut confirmée qu’après le coup d’Etat du 5 juillet 1973 par un décret-loi du 26.4.1974. En théorie, la conséquence juridique du dépassement de ce délai de six mois est claire : l’ordonnance-loi devient caduque et ne peut plus être appliquée. Il s’ensuit soit un vide juridique, soit la remise en vigueur de la législation remplacée, modifiée ou abrogée par l’ordonnance-loi caduque. Il ne semble cependant pas que cette conséquence ait été appliquée en pratique. A notre connaissance, l’Assemblée nationale n’a jamais soulevé cette irrégularité et les cours et tribunaux n’ont apparemment pas refusé l’application d’ordonnances-lois devenues caduques, probablement parce que les parties dans les litiges n’ont pas soulevé cette défense ou encore parce que des litiges ne se sont pas présentés dans ces domaines. Cette tolérance parlementaire et judiciaire comprenait des risques pour la suprématie de la loi puisqu’une forme temporaire et exceptionnelle de législation par l’Exécutif pouvait ainsi acquérir une certaine permanence. En fin de compte toutes les ordonnances-lois, sauf une, ont cependant fini par être confirmées par une loi, de façon à ce que la situation d’insécurité juridique n’a toujours été que temporaire.
Le gouvernement
Le gouvernement est composé du président de la République, chef de l’Etat et du gouvernement, et d’un vice-président et de ministres nommés par lui. Le vice-président doit être agréé par l’Assemblée nationale, qui doit, par contre, simplement être informée de la nomination des ministres. Comme nous l’avons vu, le rôle constitutionnel du vice-président est limité : il assiste le président et le remplace en cas d’absence (art. 52, al. 4). Il ne s’agit nullement d’une sorte de Premier ministre et même l’intérim des fonctions présidentielles par le vice-président est de courte durée : en cas de décès, de déchéance ou de démission du président, il est procédé à l’élection d’un nouveau président de la République dans les trente jours (art. 52, al. 2). Il est difficile de s’imaginer comment cette fonction se présenterait concrètement, puisque le président Kayibanda ne désigna jamais de vice-président, ce qu’il n’était constitutionnellement d’ailleurs pas obligé de faire puisque, contrairement aux ministres, l’intervention du vice-président dans l’activité gouvernementale n’est requise nulle part de façon institutionnelle. La fonction disparut avec la révision constitutionnelle de mai 1973. C’est que, comme le fait remarquer Roy, dans le tiers monde en général, et en Afrique en particulier, le pouvoir ne se partage pas ; le président refuse d’être doté d’une doublure, prête à le remplacer sur-le-champ.
Le président de la République a un pouvoir quasi discrétionnaire de nomination de ses ministres. Il en informe l’Assemblée nationale, mais celle-ci ne peut qu’en prendre acte ; il n’est pas question d’investiture ou de confiance. La seule limitation à cette discrétion est que les membres du gouvernement ne peuvent être parent ou allié du président de la République jusqu’au deuxième degré. La nomination des membres du gouvernement devrait en principe se faire par arrêté présidentiel, mais il n’en a rien été en pratique. Les ministres ont toujours été désignés par simple décision du président de la République ; celle-ci était simplement communiquée par message à l’Assemblée nationale. Il n’y eut même pas de publication au Journal officiel, ce qui aurait pu poser le problème de l’authenticité et de l’opposabilité de ces nominations.
Huit gouvernements se succédèrent sous la première république. Le premier, formé avant l’indépendance en mai 1962, était un gouvernement de coalition dont faisaient partie, à part le Parmehutu, l’Aprosoma et – suite à l’accord de New York – l’UNAR. Après le remaniement du 6 février 1963, effectué « pour des raisons budgétaires », ces gouvernements devinrent tous homogènes Parmehutu. Huit gouvernements en onze ans, c’est considérable à première vue ; il ne s’agit en réalité très souvent que de légers remaniements et nous verrons plus loin que le personnel politique utilisé fut relativement réduit. Ces remaniements eurent des raisons différentes : le premier (6.2.1963) eut pour but principal d’évincer les partis minoritaires ; le troisième (9.10.1965) et le cinquième (21.10.1969) firent suite aux élections législatives et présidentielles ; les autres (6.1.1964, 12.6.1968, 25.2.1970, 21.2.1972) permirent généralement l’extension du gouvernement. Le nombre de membres fut de treize en 1962 et atteignit dix-sept en 1972 ; le plus petit gouvernement, composé de neuf ministres, fut celui en place du 6.2.1963 au 6.1.1964.
Jusqu’au remaniement du 12.6.1968 les gouvernements ne comprenaient, à côté du président de la République, que des ministres. Par les arrêtés présidentiels n° 26/01 et 27/01 du 17.4.1968 deux secrétariats d’Etat furent créés, l’un à la Fonction publique, l’autre au Plan. Un troisième secrétariat d’Etat, celui à la Jeunesse et aux Sports, créé en février 1972, ne fit l’objet d’aucun texte l’instituant. Les secrétariats d’Etat sont définis comme « des administrations gouvernementales dont le volume et l’importance des charges n’ont pas encore atteint ceux d’un ministère mais (qui) ont acquis un développement tel qu’ils ne peuvent, sans dommage à la bonne marche du gouvernement, conserver le statut de services centralisés ». Il n’est question explicitement que des ministres dans la Constitution ; l’art. 66 fait cependant référence aux secrétaires d’Etat de manière incidente. C’est sur cette référence que la constitutionnalité de la fonction de secrétaire d’Etat a pu être soutenue. Depuis le remaniement du 25.2.1970 il fut également créé deux « super-ministères » délégués à la présidence de la République, l’un chargé de la coordination des affaires politiques et administratives, l’autre de la coordination des affaires économiques, techniques et financières. Il faut signaler enfin la création, par l’arrêté présidentiel n° 135/20 du 4.12.1963, de trois commissions interministérielles chargées respectivement du plan et budget, du personnel et de la législation et du contentieux. Ces commissions, qui regroupaient plusieurs ministres, n’ont fonctionné que pendant deux ans bien qu’elles n’aient jamais été abrogées explicitement. Comme le fait remarquer Verhelst, en ce qui concerne les projets de lois et de règlements qui, en vertu de l’art. 64 Const., doivent être obligatoirement soumis au Conseil des ministres, l’avis de ces commissions était seulement préparatoire et ne dispensait pas d’une consultation de l’ensemble du Conseil du gouvernement.
Le président Kayibanda fit appel pour ses huit gouvernements à un total de 46 personnes, dont une seule femme. Deux ministres, F. Minani et G. Harelimana, servirent dans six gouvernements et deux autres, A. Makuza et P.D. Nkezabera, furent membre de sept équipes ministérielles. Après l’éviction des ministres de l’UNAR en février 1963 plus aucun Tutsi ne fit partie du gouvernement jusqu’en 1973. La composition sociologique du gouvernement connut une évolution considérable dans le sens d’une meilleure formation ; si quatre des treize membres avaient reçu une formation supérieure en 1962, ce nombre avait atteint neuf sur douze en 1969, c’est-à-dire un rapport inversé. A partir de 1969 en particulier, on constate une nette entrée de « techniciens », formés à Lovanium ou dans des universités européennes et sans passé politique. Cela implique en contrepartie la disparition d’une partie de la « vieille garde » qui avait consolidé la révolution avec Gr. Kayibanda on songe à des personnalités comme B. Bicamumpaka, 0. Rusingizandekwe, J.B. Rwasibo, Gaspard. Cyimana, Calliope. Mulindahabi, Calixte Habamenshi et Lasaro. Mpakaniye, tous des anciens ministres de la première heure auxquels le président de la République ne fit plus encore, il en dispose. Depuis 1965, début de l’unipartisme de fait – et même avant cette date étant donnée la position dominante du Parmehutu cela signifie que si le président de la République est théoriquement soumis à l’Assemblée nationale en tant que chef de l’Etat et du gouvernement, il la contrôle en tant que chef du parti. Les conséquences de cette relation, qui porte en elle à la Fois la soumission constitutionnelle et la suprématie politique, sont bien illustrées par l’expulsion de dix-huit députés contestataires après l’affaire de la commission d’enquête de 1968. Formellement, il ne s’est rien passé d’inconstitutionnel lors de cette affaire. Nous verrons plus tard que la force de cette concentration du pouvoir est également sa faiblesse. Cette évolution, qui – on ne saurait le souligner à suffisance – s’est produite sans entorse à la légalité constitutionnelle formelle, est la meilleure illustration possible du caractère irréel de l’étude de textes constitutionnels pris isolément.
Un bref rappel du régime constitutionnel colonial s’impose ici. La position, les prérogatives et les pouvoirs du président Kayibanda n’étaient pas fondamentalement différents de ceux du résident, du gouverneur, du gouverneur général et du roi des Belges chacun à son niveau. Exception faite de l’intervention rarissime du législateur belge, l’Exécutif colonial exerçait le pouvoir sans partage ni contrôle réel. L’assemblée « législative » consultative pour le Territoire du Ruanda-Urundi, le Conseil du vice-gouvernement général d’abord et le Conseil général ensuite, dépendait du gouverneur comme l’Assemblée nationale dépendait du président de la République, puis qu’en grande partie elle était désignée par lui et qu’elle n’avait évidemment aucune emprise politique sur lui. L’autonomie du pouvoir exécutif colonial était plus grande encore du fait qu’il était très peu exposé à des pressions d’ordre ethnique, régional ou autre. Les conceptions du pouvoir qui sont parfois reprochées aux dirigeants africains par la littérature occidentale sont donc en réalité celles que ceux-ci ont hérité du régime politique colonial. Si cette constatation ne saurait excuser les excès com mis par nombre de régimes africains, elle devrait inciter à la modération dans leur condamnation d’appel ; il faut dire que nombre d’entre eux payèrent les frais de l’affaire de 1968. La préfecture de Gitarama, région du président Kayibanda, a toujours été quelque peu surreprésentée dans les gouvernements. Dans le gouvernement d’octobre 1965 trois membres sur treize (le président y inclus) furent originaires de cette préfecture ; les préfectures de Butare, Kibungo et Kibuye n’y étaient par contre pas représentées. De même en 1969 il y en eut trois sur quatorze ; Byumba et Kibungo étaient absents. Dans le dernier gouvernement de la première république, formé le 21.2.1972, il y avait six membres de Gitarama sur dix-huit, ce qui représente un tiers.
Nous avons déjà signalé que les ministres n’avaient aucun pouvoir propre de par la Constitution : leurs compétences étaient des attributions déléguées, puisque le président de la République « fixe les attributions des ministres et détermine la nature et la compétence des services placés sous leur autorité. Les ministres reçoivent délégation du président de la République pour les affaires relevant de leurs départements ministériels. Le président de la République fixe l’étendue de cette délégation » (art. 56, c). Les ministres exercent les attributions qui leur sont dévolues (art. 62) et font exécuter les lois et règlements relatifs à leurs attributions propres (art. 63). Il faut dire que cette dernière compétence (d’exécution) ne nous apprend rien de particulier puisque les ministres n’ont pas d' »attributions propres ». Signalons encore qu’en l’absence de la technique de l’arrêté interministériel, les matières intéressant plusieurs ministères sont réglées par arrêté présidentiel. Si la Constitution n’accorde aucun pouvoir normatif aux ministres, ceux-ci ont réglé un nombre considérable de matières.
Il semble donc que l’attribution directe de compétences d’exécution des lois aux ministres soit contraire à la constitution. Si l’on avait voulu respecter les prescrits constitutionnels, la voie était pourtant toute indiquée : le président de la République aurait pu prendre des mesures générales d’exécution, quitte à confier les détails subordonnés à ses ministres. Dans ce cas, les principes constitutionnels en matière de délégation doivent évidemment être strictement appliqués. Si la théorie constitutionnelle « pure » interdit en effet toute délégation de pouvoir à pouvoir, la doctrine et la jurisprudence ont été amenées à admettre certaines formes de délégation. Par son fameux arrêt du 4 mai 1920 la Cour de cassation belge estima ainsi « que s’il est de principe que les pouvoirs sont inaliénables et intransmissibles, il n’est pas interdit à l’autorité déléguée par la Nation d’établir des autorités secondaires chargées d’agir sous son contrôle en prenant des mesures de détail sous réserve de son approbation expresse ou tacite ; que cette mission toute précaire et toujours révocable (…) n’implique aucune aliénation ou transmission du pouvoir ».
Conclusions
Au Rwanda, comme dans les autres pays d’Afrique, étudier le pouvoir et les fonctions de l’Exécutif revient à étudier le pouvoir du président de la République. Issus de régimes parlementaires, tous ces pays ont évolué vers un présidentialisme de droit ou de fait ; ces régimes furent généralement instaurés immédiatement ou tout au plus quelques années après l’indépendance. Il n’y a qu’une poignée de pays, dont le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone, où la stabilité constitutionnelle formelle fut plus grande et où des révisions dans ce sens n’intervinrent pas endéans les cinq ans de l’indépendance. Le Rwanda fait partie de ce dernier groupe ; nous avons vu, en effet, que jusqu’en 1973 la seule révision constitutionnelle, celle du 12 juin 1963, ne fut qu’une mesure ad hoc sans incidence sur l’aménagement des pouvoirs. Constitutionnellement, la position du pouvoir exécutif n’était donc pas forte: le président de la République était politiquement responsable envers l’Assemblée nationale qui, par le vote d’une motion de censure ou de méfiance, pouvait le contraindre à la démission; le président de la République, quant à lui, ne disposait pas du droit de dissolution, corollaire habituel de la responsabilité politique dans un régime parlementaire; il n’avait pas de pouvoir réglementaire autonome ni de pouvoirs spéciaux comme ceux attribués par l’art. 16 de la constitution française et par d’autres constitutions d’Afrique francophone. Le Chef de l’Etat dominait pourtant toutes les autres institutions du Rwanda ; si l’ordonnancement constitutionnel était donc plutôt parlementaire, la réalité politique nous montre un régime présidentialiste fort inéquilibré en faveur du président de la République. On voit ce dernier à l’origine de quasiment toute la législation ; il est inaccessible à la critique parlementaire, et quand celle-ci devient encombrante il l’élimine ; il démet de leurs fonctions un président et plusieurs vice-présidents de la Cour suprême ; il contribue indirectement à faire remplacer un président de l’Assemblée nationale. En somme il gouverne sans partage.
Cadoux avance deux raisons pour cet état de choses. Il y a d’abord la nature même du pouvoir présidentiel que l’on souhaite à la fois puissant et limité ; lorsque le pouvoir est peu institutionnalisé comme au Rwanda la stabilité du régime dépend de la personnalité qui se trouve à la barre. Ensuite – et ceci constitue le levier principal de son accaparement du pouvoir plus encore, il en dispose. Depuis 1965, début de l’unipartisme de fait – et même avant cette date étant donnée la position dominante du Parmehutu cela signifie que si le président de la République est théoriquement soumis à l’Assemblée nationale en tant que chef de l’Etat et du gouvernement, il la contrôle en tant que chef du parti. Les conséquences de cette relation, qui porte en elle à la fois la soumission constitutionnelle et la suprématie politique, sont bien illustrées par l’expulsion de dix-huit députés contestataires après l’affaire de la commission d’enquête de 1968. Formellement, il ne s’est rien passé d’inconstitutionnel lors de cette affaire.
Cette évolution, qui – on ne saurait le souligner à suffisance – s’est produite sans entorse à la légalité constitutionnelle formelle, est la meilleure illustration possible du caractère irréel de l’étude de textes constitutionnels pris isolément.
Un bref rappel du régime constitutionnel colonial s’impose ici. La position, les prérogatives et les pouvoirs du président Kayibanda n’étaient pas fondamentalement différents de ceux du résident, du gouverneur, du gouverneur général et du roi des Belges chacun à son niveau. Exception faite de l’intervention rarissime du législateur belge, l’Exécutif colonial exerçait le pouvoir sans partage ni contrôle réel. L’assemblée « législative » consultative pour le Territoire du Ruanda-Urundi, le Conseil du vice-gouvernement général d’abord et le Conseil général ensuite, dépendait du gouverneur comme l’Assemblée nationale dépendait du président de la République, puis qu’en grande partie elle était désignée par lui et qu’elle n’avait évidemment aucune emprise politique sur lui. L’autonomie du pouvoir exécutif colonial était plus grande encore du fait qu’il était très peu exposé à des pressions d’ordre ethnique, régional ou autre. Les conceptions du pouvoir qui sont parfois reprochées aux dirigeants africains par la littérature occidentale sont donc en réalité celles que ceux-ci ont hérité du régime politique colonial. Si cette constatation ne saurait excuser les excès commis par nombre de régimes africains, elle devrait inciter à la modération dans leur condamnation.
https://amateka.org/204-2/https://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20211227_105320.jpghttps://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20211227_105320-150x150.jpgLes républiquesLe président de la République Élection Au début de chaque législature, le président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité simple des suffrages (art. 52 Const.). On se rappelle que Gr. Kayibanda avait été élu président de la République, non pas au suffrage universel,...Kaburame Kaburamegrejose2001@yahoo.co.ukAdministratorAmateka y'u Rwanda

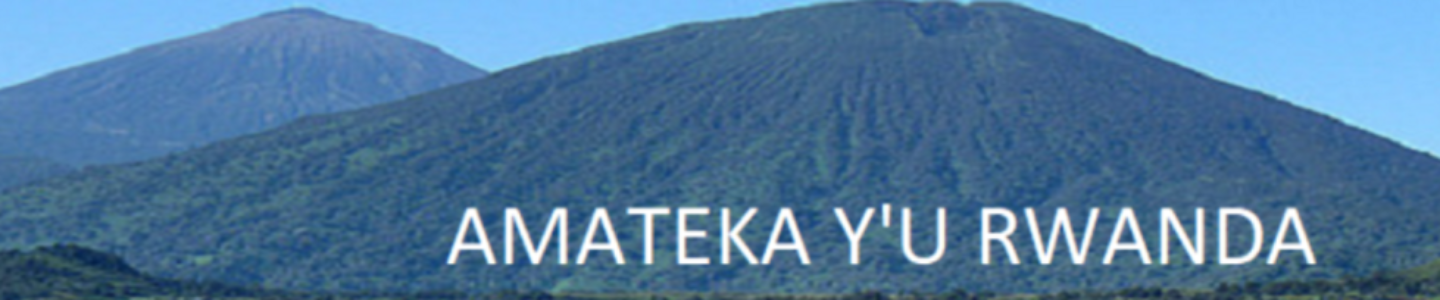



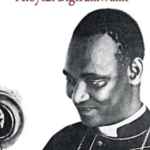






Laisser un commentaire