Le Fonctionnement des institutions De La Première République
Assemblée nationale
- Composition
Jusqu’à la dissolution de l’Assemblée nationale suite au coup d’Etat du 5 juillet 1973, le Rwanda connut trois parlements, élus respectivement en 1961, 1965 et 1969. Nous avons vu que les 44 sièges du premier parlement, issu des élections du 25 septembre 1961, étaient distribués comme suit : 35 M.D.R.-Parmehutu, 7 UNAR et 2 Aprosoma. L’Assemblée issue des élections du 3 octobre 1965 comprenait des députés du Parmehutu uniquement, le seul parti à avoir présenté des candidats. Par la loi du 23 juillet 1965 le nombre de députés avait été porté à 47. Cette modification donna lieu à de longues discussions. G. Ndekezi, soutenu notamment par Ch. Habimana et J. Sebazungu, proposait d’allouer un nombre égal de sièges (quatre) à chaque préfecture, tandis que B. Bicamumpaka voulait remplacer la préfecture par l’Etat comme circonscription électorale (liste nationale). Le but inavoué de Bicamumpoka était évident : l’introduction du scrutin de liste nationale majoritaire à un tour a été largement utilisée en Afrique francophone pour instaurer le parti unique de fait. Introduite par la Guinée en 1958, cette technique fut reprise entre 1960 et 1963 par tous les autres territoires ex-français à l’exception de Madagascar et du Cameroun. Ce système, qui érige le territoire national en une seule circonscription électorale élimine de manière « démocratique toute l’opposition parlementaire, puisque le parti qui remporte la majorité, si minime soit-elle, des suffrages s’adjuge tous les sièges au parlement. La proposition de Bicamumpaka ne fut toutefois pas retenue, bien qu’il n’ait pas été fait référence au cours de débats à la possibilité que nous venons d’évoquer. Afin de rencontrer le souhait des députés de Butare et de Gisenyi, qui s’estimaient sous-représentés, l’Assemblée décida finalement de porter le nombre des députés à 47, au lieu de 45 prévus par le projet du gouvernement et de conserver la représentation proportionnelle par préfecture.
Il n’y a que deux préfectures, Gikongoro et Cyangugu, où le classement établi par le parti fut entériné tel quel par la population. Cette constatation est évidemment la manifestation d’un certain degré de démocratie, aussi limitée soit-elle. Il n’y eut que trois listes individuelles: une à Butare (J. Gitera Habyarimana) et deux à Kibuye (F. Kayibanda et E. Iyamuremye). Aucun de ces candidats individuels ne parvint à s’assurer un siège: Gitera termina 13ème, Kayibanda 9ème et Iyamuremye 15ème. Il apparaît donc que le patronage du parti était essentiel ; ceci est clairement mis en évidence par le fait que, lors des élections de 1969, Gitera fut élu à Butera comme premier sur la liste du Parmehutu où il était pourtant classé sixième. La participation globale aux élections fut de 88,7% ; ce pourcentage élevé est normal étant donné que le vote était obligatoire.
Vingt députés sortants furent réélus, ce qui signifie que quinze membres du Parmehutu perdirent leur siège, soit parce qu’ils ne furent pas retenus comme candidat lors du congrès du parti en mai-juin 1965, soit parce que – tout en s’étant présentés – ils ne furent pas élus en ordre utile dans leur circonscription électorale. Le choix des électeurs fut déterminant puisque 32 des 35 députés Parmehutu sortants s’étaient représentés. 27 des 47 députés étaient dès lors des nouveaux venus au parlement. Ce choix a été possible grâce à la présentation par le Parmehutu de quatre candidats par siège à pourvoir, possibilité offerte par l’art. 109 de la loi électorale du 11 août 1965 qui prévoyait dans son alinéa 3 que « les listes ne peuvent comprendre plus de quatre fois le nombre de sièges à attribuer ». Bien que la présentation de quatre candidats par siège n’était donc pas obligatoire, l’offre de pareille possibilité – un non-sens dans un pluripartisme compétitif – était réaliste dans un régime à parti dominant ; c’était une préfiguration de la réalité du parti unique. C’est en effet, dans un régime à parti unique, le seul moyen légal de garantir un certain choix à l’électorat. En Tanzanie, la commission présidentielle qui prépara la constitution « intérimaire » de 1965 fit remarquer : « One Party governement operating within the context of a constitution intended for two or more parties inevitably results in the disenfranchisement of the voter. So long as the law permits the establishment of alternative parties T.A.N.U. (parti unique de fait jusqu’en 1965; de droit depuis) must continue to right elections, both national and local, on a party basis. This means putting forward a single candidate in each constituency or ward. In Tanganyika in most cases such candidates have been unopposed and the people have, in consequence, the right to vote but no opportunity to do so (…). By a paradox the more support the people have given to T.A.N.U. as a party the more they have reduced their participation in the process of government ».
Avec la Tanzanie depuis 1965 (deux candidats par siège à pourvoir) et la Zambie depuis 1973 (trois candidats), le Rwanda fut un des rares pays d’Afrique à tirer les conclusions de cette constatation.
Suite à la révision du régime électoral par la loi du 19 mai 1969, les listes ne comprenaient plus que le double au maximum du nombre de sièges à attribuer (art. 110). Des 47 députés, 23 furent réélus alors que 30 s’étaient représentés. Au total, plus de la moitié des députés du deuxième parlement perdirent leur siège ; ce fut en grande partie la conséquence d’un important conflit au sein du Parmehutu. En tout, seuls huit députés (W. Banzi, A. Makuza, M. Mpiranya, C. Mulindahabi, V. Munyakazi, L. Nibaseke, A. Nkeramugaba et 0. Rusingizandekwe) firent partie des trois parlements de la première République. Etalée sur douze ans à peine cette évolution est le signe d’une mobilité politique considérable, surtout si l’on se rend compte du fait que ces renouvellements successifs se sont produits essentiellement dans le cadre d’un régime à parti unique.
Un mot doit encore être dit à propos de la composition sociologique de l’Assemblée nationale. Du point de vue de la formation des députés, on constate une légère amélioration du deuxième parlement par rapport au premier, et un progrès plus net du troisième.
Dans les trois parlements, mais les deux premiers, surtout, le groupe le plus important est composé des députés ayant reçu une formation du niveau secondaire ; la majorité parmi eux sont des moniteurs. Dans le troisième parlement, les universitaires prennent une part relativement importante ; ceux qui ont suivi un enseignement supérieur, universitaire ou autre, y représentent presque 40%. Quant à l’Occupation des députés avant leur élection, on remarque une composition presqu’identique des premier et deuxième parlements. Dans le troisième parlement le nombre des fonctionnaires augmente et celui des enseignants diminue. Les députés venant du secteur privé (commerçants et entrepreneurs) représentent toujours moins de 20%. Il n’y a pas d’agriculteurs, éleveurs ou ouvriers et un seul employé du secteur privé.
La diminution du nombre des enseignants du deuxième au troisième parlement correspond plus ou moins à la diminution des députés ayant suivi l’école secondaire puisqu’il s’agit surtout de diplômés ; le fait de n’avoir suivi que l’école primaire correspond en général à une occupation d’indépendant. Il y a eu un maximum de sept députés-ministres dans les premier et deuxième parlements et de onze dans le troisième, ce qui représente pour ce dernier presqu’un quart du total des députés. Si ce chiffre peut paraître élevé il est de loin inférieur aux pourcentages existants dans d’autres pays africains : en 1966 au Kenya, par exemple, 39% des députés faisaient partie du gouvernement. Enfin, aux deuxième et troisième parlements, il n’y eut aucun député tutsi ou twa.
- Statut des députés
Nous voudrions nous limiter ici à l’étude d’un seul élément du statut des députés ayant trait à leur indépendance envers le pouvoir exécutif : l’immunité parlementaire. Le projet de constitution prévoyait, en un seul article, l’irresponsabilité et l’immunité parlementaires. Cet article fut scindé en deux en première lecture : l’art. 86 ayant trait à l’irresponsabilité (« Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions, déclarations ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions »); l’art. 87 prévoyant l’immunité (autorisation de l’assemblée requise pour l’arrestation ou la poursuite de députés).
Ces dispositions furent les seules à faire l’objet de modifications en troisième lecture, à l’occasion de l’étude de la traduction de la constitution en kinyarwanda. Lors de la séance du 2 octobre 1962, M. Rwagasana, soutenu par Ch. Byungura et d’autres députés, demanda que mention explicite soit faite de l’immunité parlementaire dans le texte de l’art. 86. Tout en reconnaissant que l’immunité parlementaire des députés était comprise dans cet article, Rwagasana insistait : « Nous la sentons, il est vrai. Mais nous ne la voyons pas, comme nous voyons celle des ministres dans l’article 66. Il nous la faut textuelle et littérale. Nous ne la voulons pas camouflée ». Sa proposition d’insérer un premier alinéa (« Les députés jouissent de l’immunité parlementaire ») fut adoptée par 20 voix pour, aucune contre et 10 abstentions. La conséquence de cette modification ne devint claire que lors de la dernière lecture. C. Mulindahabi demanda la fusion des anciens articles 86 et 87 (irresponsabilité et immunité) en un seul et, faisant suite à cette proposition, Rwagasana introduisit l’amendement suivant : « Les députés jouissent de l’immunité parlementaire. Celle-ci ne peut être levée que sur mise en accusation votée par l’Assemblée nationale à la majorité des 3/4 des députés composant l’Assemblée nationale et au scrutin secret. Ils sont alors traduits devant la Cour suprême ». Cet amendement fut adopté par 23 voix pour, 1 contre et 6 abstentions. L’opération menée avec succès par M. Rwagasana aboutit à un résultat paradoxal. En voulant introduire explicitement le concept d’immunité parlementaire, l’Assemblée perdit de vue l’irresponsabilité parlementaire qui ne fut plus retenue. Dans l’esprit des députés, les deux termes ont dû se couvrir, mais tel n’est pas le cas : contrairement à l’immunité, l’irresponsabilité s’oppose à toute poursuite, même avec l’accord éventuel de l’Assemblée. Il est remarquable que cette diminution de la protection des parlementaires fut le fait d’un député de l’opposition et même de l’UNAR, parti qui aurait dû prévoir qu’il souffrirait en cas de crise.
Le texte définitif de l’art. 86 soulève encore deux autres questions. La première a trait à l’absence de distinction entre les périodes des sessions parlementaires et celles, considérables au Rwanda, entre deux sessions. Etant donné la formulation large de l’article il parait que le régime des immunités bénéficie aux députés pendant toute la durée de leur mandat. En deuxième lieu, l’exclusion classique du flagrant délit ne figure pas dans l’article, probablement par oubli, vu que ce n’est qu’en dernière lecture, suite au profond remaniement du texte en faveur de l’amendement Rwagasana, que cette exception disparut sans explication ni débat. Nous estimons avec Piérard que, eu égard aux situations immorales qui pourraient résulter de pareille omission, les parlementaires surpris en flagrant délit ne jouiraient pas de l’immunité, et ce en faisant appel aux principes généraux du droit et de l’équité. Ce statut, même limité comme il le fut, ne procura guère de protection aux députés. Nous verrons à diverses occasions qu’il ne put empêcher qu’ils firent l’objet d’arrestations sans autorisation de l’Assemblée, de multiples tracasseries administratives et policières et qu’un député fut même exécuté sommairement sans aucune forme de procès.
- Activité législative
Le pouvoir législatif s’exerce par voie de loi (art. 75, al. 1 Const.), dont l’initiative appartient concurremment aux députés, au président de la République et au gouvernement (art. 93, al. 1). Le Conseil des ministres est entendu et consulté obligatoirement sur les projets de loi émanant de l’Exécutif (art. 64). Les propositions de loi déposées par les députés ne sont pas recevables si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’elles ne soient assorties d’une proposition d’augmentation des recettes ou des économies équivalentes (art. 93, al. 3). A part la Constitution dont nous avons vu qu’elle fut formellement introduite par 37 députés et non par l’Exécutif, les députés n’ont, en pratique, fait usage de leur droit d’initiative que deux fois, pour la loi du 12 juin 1963 portant révision de l’art. 108 Const. et celle du 18 septembre 1967 modifiant deux articles de la loi électorale.
En vertu, non de la Constitution mais de l’art. 46 de la loi du 23 février 1963 sur la Cour suprême, le président de la République peut consulter la Cour constitutionnelle après le dépôt d’une proposition ou d’un projet et avant la délibération en Assemblée. Il ne s’agit pas ici d’un simple avis, puisque l’art. 46 de la loi de 1963 prévoit que celui-ci lie le gouvernement et l’assemblée. En cas d’avis d’inconstitutionnalité, le texte devra donc être revu avant la délibération et le vote. Dans la pratique il n’a cependant pas été fait usage de cette procédure de contrôle préalable au vote. Avant la discussion et le vote en Assemblée plénière les projets et propositions sont examinés en commission. Le dernier règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée, adopté le 20 décembre 1969, prévoyait huit commissions permanentes (art. 10-14) : travaux parlementaires ; affaires politiques, administratives et de sécurité ; législation et planification du développement national ; affaires sociales et éducationnelles ; affaires économiques et financières ; travaux publics et communications; information et tourisme; affaires extérieures. Sur rapport de la commission compétente, le texte est discuté en Assemblée. Une pratique bizarre s’est installée dès le début : en octobre 1962 le ministre Th. Bagaragaza, qui n’était pas député, fut désigné comme rapporteur du projet de loi sur la sécurité sociale. Passant outre aux objections du député A. Munyangaju qui fit remarquer qu’on créait ainsi un précédent fâcheux, l’Assemblée résolut que « le ministre Bagaragaza rapportera lui-même le projet de loi sur la sécurité sociale, avec voix consultative ». Depuis lors, des ministres non-députés ont très souvent été rapporteurs de leurs propres projets.
Bien que la Constitution n’impose pas le vote article par article pour les lois ordinaires, le règlement d’ordre intérieur prévoit que « les projets sont examinés et votés article par article, puis globalement ». L’Assemblée peut toutefois décider de procéder à l’examen et au vote global, à condition que les députés soient en possession du texte au moins sept jours à l’avance et qu’ils soient éclairés sur son économie par un exposé des motifs suffisamment approfondi. La Constitution (art. 83, al. 3) ne prévoit le vote section par section que pour les lois budgétaires. La loi est adoptée à la majorité simple, sauf s’il s’agit de lois organiques qui exigent une majorité absolue (art. 89) ou de projets d’association ou de fédération pour lesquels une majorité qualifiée des 4/5 des députés est nécessaire (art. 110). Après le vote, la Cour constitutionnelle examine la conformité du texte avec la Constitution.
En cas d’arrêt de constitutionnalité, le texte est soumis au président de la République pour signature valant sanction et pour promulgation. Celui-ci peut soit approuver la loi, la signer et promulguer, soit exercer son droit de veto suspensif. Dans ce deuxième cas, il doit renvoyer le texte à l’Assemblée pour une deuxième lecture endéans les quinze jours. Si la loi renvoyée est votée en deuxième lecture et n’est pas déclarée inconstitutionnelle, elle doit être promulguée (art.56, r). Il semble que le président de la République n’ait demandé la deuxième lecture qu’à trois reprises : (1) Loi sur la contribution personnelle minimum, votée en première lecture le 8.1.1963 et en deuxième lecture le 15.3.1963, devenue loi du 18.3.1963; (2) Loi sur la contribution personnelle minimum, votée en première lecture le 16.4.1964 et en deuxième lecture le 25.4.1964, devenue loi du 9.5.1964; (3) Loi sur les maisons de l’Etat, votée en première lecture le 11.9. 1968. Lors de la deuxième lecture l’Assemblée décida de suspendre l’examen de ce projet, qui ne revint plus en discussion. Il fut abandonné par le gouvernement et ne devint jamais loi. En pratique la loi sur la chasse fit également l’objet de cette procédure. Le projet fut voté en première lecture le 30.10.1964, mais le président de la République, qui n’avait pas promulgué la loi, « sans demander ici formellement une deuxième lecture », voulait connaître l’avis de l’Assemblée sur quelques observations qu’il formulait concernant cette loi. Le 8.4.1965 l’Assemblée votait une « révision » après adoption d’un nombre de modifications essentiellement techniques. Ce texte devint la loi du 18.5.1965 portant réglementation de la chasse.
Nous avions déjà constaté que le nombre de lois votées a diminué au fil des années : le deuxième parlement n’a voté que 49% du nombre des lois du premier parlement ; le troisième parlement n’a voté que 20% des lois du premier et 40% du nombre des lois du deuxième. Le recul est donc net. La courbe descendante est interrompue de façon prononcée en 1967 et dans une moindre mesure en 1970 et 1971. Est-ce un hasard que ces années se situent à mi-chemin de législature ? Le parlement était « rodé » et les soucis de la réélection encore loin. Il nous semble qu’en 1967 le facteur du hasard a également joué. Cinq des treize textes portent en effet création d’établissements publics ou de parastataux qui ensemble constituent un seul paquet ; deux autres textes comportent de grands codes (code minier et code du travail) longtemps préparés par des experts dont dépendent les gouvernements pour ce type de législation ; deux textes sur le régime électoral, enfin, s’imposaient en cette année d’élections communales.
Non seulement le nombre de lois mais également le nombre moyen d’articles par loi a diminué. Si cette moyenne était de 50,9 pour le premier parlement, elle était réduite à 41,5 pour le deuxième avant d’atteindre 22,5 sous le troisième. Le troisième parlement n’a voté que 8,6% du nombre d’articles votés par le premier. Ce recul s’explique en grande partie par le fait que le premier parlement a été amené à voter un nombre de grands codes et lois qui s’imposaient d’urgence au Rwanda indépendant (code d’organisation et de compétence judiciaires, code de procédure pénale, loi sur la Cour suprême, statut de la magistrature, code électoral, organisation communale, code de procédure civile, statut de ministère public…). Le premier parlement ayant paré au plus pressé, il ne restait au deuxième que quelques textes de moindre envergure (loi sur l’éducation nationale, code minier, code du travail…). Le troisième parlement, enfin, ne vota qu’un seul code dont l’urgence fut toute relative, vu qu’il s’agit d’une nouvelle version du code minier. D’autres codes importants, tels le code de commerce, le code foncier et le code des personnes et de la famille, demeurèrent dans des tiroirs gouvernementaux et n’aboutirent pas au parlement.
Il n’y a qu’une seule donnée qui augmente proportionnellement à travers les trois législatures : la durée moyenne des discussions par article. Elle était de 0,49 pages d’annales parlementaires sous le premier parlement, monta à 0,63 sous le deuxième, pour atteindre 1,19 pages sous le troisième. On constate donc qu’au fil des trois parlements plus de temps fut en moyenne consacré à la discussion d’une unité : sous le deuxième parlement 22,3% de plus que sous le premier et sous le troisième parlement 47% de plus que sous le deuxième et 59% de plus que sous le premier. On ne peut que formuler des hypothèses pour expliquer ce phénomène. Quelques possibilités nous semblent pouvoir être exclues d’emblée: il n’y a pas de diminution significative du consensus, puisque nous verrons tout de suite qu’il n’y eut quasiment pas de votes négatifs ni même d’abstentions; on ne saurait non plus pour cette même raison et vu l’absence de propositions de loi, conclure à une plus grande affirmation de soi-même de l’Assemblée nationale; le phénomène ne peut non plus être attribué à une plus grande difficulté technique des textes, ce qui est illustré par le fait qu’un texte quasiment identique, le code minier, remplit quatre pages de discussions sous le deuxième parlement et 51 pages sous le troisième. Reste la simple hypothèse que nous retenons : si l’initiative gouvernementale, source essentielle du travail législatif, diminua au fil des législatures, la durée des sessions resta la même ; en l’absence d’un ordre du jour bien garni, les députés ont « rempli » le temps leur imparti.
Sous le premier parlement 17 votes globaux furent acquis à l’unanimité, c’est-à-dire 32,7% ; ce nombre avait atteint 20 ou 83,3% sous le deuxième ; il était de 7 ou 77,7% sous le troisième.
Un projet de loi voté et qui ne fit pas l’objet d’un arrêt d’inconstitutionnalité ne fut apparemment pas promulgué et certainement jamais publié. Il s’agit du projet de loi portant règlement de la comptabilité publique du Rwanda. Ce projet, comprenant un seul article et une annexe (le règlement) de 209 articles, fut examiné et voté le 17 janvier 1963. Nous ignorons pourquoi cette loi, votée à l’unanimité et rapidement à la demande expresse du gouvernement, ne fut jamais promulguée ni publiée. En vertu de l’art. 56, al. k Const. le président de la République était pourtant obligé de signer et de promulguer les lois dans les quinze jours suivant leur transmission, du moins s’il n’exerçait pas son droit de veto prévu par l’art. 56, al. r. Il est tout de même remarquable que l’Assemblée n’ait posé aucune question à ce sujet.
Un nombre de projets introduits au parlement aboutirent difficilement ou pas du tout. Parcourons les cas les plus frappants : -Le président de la République usa de son droit de veto suspensif pour la loi de 1963 sur la contribution personnelle minimum (c.p.m.). En deuxième lecture l’Assemblée maintint le texte voté en première lecture et le président fut obligé de promulguer cette loi telle quelle.
-Un conflit analogue se produisit un an plus tard au sujet de la fixation de la c.p.m. pour l’année 1964. Après l’exercice du droit de veto suspensif par le président de la République suite au vote du 15 avril 1964, le texte revint au parlement en deuxième lecture le 21 du même mois. Cette fois, l’Assemblée rencontra en partie les souhaits du gouvernement.
-Un projet de loi portant statut des sociétés coopératives fut d’abord rejeté et renvoyé en commission le 29 octobre 1964. Lorsque le texte revint en Assemblée plénière le 26 janvier 1965, l’Assemblée vota l’ajournement et le texte fut retourné au gouvernement. Le projet fut finalement adopté presque deux ans plus tard pour devenir la loi du 22 novembre 1966.
-Un projet de loi portant règlement d’administration publique en matière de contrôle sur la gestion des finances publiques fut renvoyé en commission pour étude complémentaire, parce que l’Assemblée s’estimait insuffisamment informée et qu’elle craignait des ramifications politiques (l’affaire de la Cour suprême » se déroulait au même moment. En réalité, ce projet ne revint pas en Assemblée plénière et il fut donc abandonné par le gouvernement qui se proposait de légiférer par ordonnance-loi, ce qu’en fin de compte il ne fit pas. -Un projet de loi portant création et organisation des tribunaux du travail fut à l’unanimité retourné au gouvernement, « parce que l’Assemblée invoque des principes opposés à ceux contenus dans le projet du gouvernement. Il faut qu’il soit repensé à la lumière des principes fondamentaux avancés par l’Assemblée nationale ». Lorsqu’il revint à l’Assemblée presque deux ans plus tard, le parlement – ne pouvant se mettre d’accord sur un point de détail, la rémunération des assesseurs des tribunaux du travail – décida par 21 voix pour et 7 contre d’ajourner sine die l’examen de ce texte. Le projet ne revint plus en Assemblée et fut abandonné par le gouvernement.
– Un projet de loi relatif au statut des agents de la fonction publique fut retourné en commission le 10 novembre 1967 ; le statut existant étant réglé par l’arrêté présidentiel n° 37/Int. du 28.12.1961 la commission avait estimé que cette matière devait être réglée par arrêté présidentiel. Ce point de vue illustre le problème posé par la continuité juridique dans un pays neuf. L’Assemblée décida ensuite le 31 août 1968 de renvoyer le projet au président de la République. Elle demanda au gouvernement d’élaborer un projet de loi-cadre qui régirait tous les fonctionnaires, et non seulement ceux de l’administration centrale. L’arrêté présidentiel de 1961 resta donc en vigueur jusqu’à la promulgation, le 19 mars 1974, d’un décret-loi portant statut général des agents de l’Etat.
– Le sort du projet de loi sur les maisons de l’Etat a déjà été relaté plus haut. La deuxième lecture suite à un veto suspensif ne menant pas à un vote positif, cette loi dut être abandonnée par le gouvernement. Certains textes votés en première lecture revinrent à l’Assemblée suite à des arrêts d’inconstitutionnalité rendus par la Cour constitutionnelle.
- Activité de contrôle
L’art. 96 Const. prévoit les moyens d’information et de contrôle suivants de l’Assemblée nationale à l’égard de l’action gouvernementale: l’interpellation, la question écrite, l’audition par les commissions et les commissions d’enquête. Le même article stipule qu’une loi organique fixerait les conditions et la procédure d’application de ces moyens, mais pareille loi ne vit jamais le jour. Il est relativement difficile d’évaluer concrètement la mise en œuvre de ces moyens de contrôle. En l’absence de normes concrètes d’une loi d’exécution de l’art. 96 Const., ou d’intentions clairement exprimées par les députés, on se demande régulièrement si une initiative parlementaire, par exemple la création d’une commission spéciale, entre dans le cadre du contrôle des actes du pouvoir exécutif tel que prévu à l’art. 96. Des députés adressèrent parfois des critiques au gouvernement, à un ou plusieurs ministres, en particulier, à des pouvoirs subordonnés (surtout les préfets) ou même au pouvoir judiciaire à l’occasion de débats sur d’autres questions, sans qu’il ne fût fait explicitement référence aux procédés prévus par l’art. 96. L’inexistence d’une loi organique d’exécution de l’art. 96 fut certes un handicap, mois les députés auraient pu y porter remède par l’introduction d’une proposition de loi. Ils ne le firent pas et c’est en partie la raison pour laquelle les moyens de contrôle du gouvernement ne purent être mis en œuvre de façon efficace.
Il est remarquable que des quatre moyens d’information et de contrôle prévus par la constitution, un seul, la commission d’enquête, a été effectivement utilisé. A notre connaissance, il n’a été question qu’une seule fois d’interpeller le gouvernement, mais cette proposition ne fut pas retenue. C’était à l’occasion de l’affaire Kalima, que nous examinerons tout de suite ; il est difficile de connaître le déroulement exact de la discussion, puisque la séance en question fut tenue à huis-clos ; nous ne possédons dès lors qu’une note synthétique. Toujours est-il que l’assemblée décida de ne pas interpeller formellement le gouvernement. Ce fut, semble-t-il, le seul moment où la possibilité d’une interpellation fut envisagée sérieusement. Quant à la question écrite, il n’en existe aucune trace dans les annales parlementaires ; il ne semble pas qu’elle ait été posée ou même envisagée une seule fois. Il en est de même de l’audition par les commissions parlementaires permanentes, qui fonctionnèrent pourtant de façon régulière.
- Commissions d’enquête : Vincent Kalima et la situation des députés
Vincent de Paul Kalima, député Parmehutu de Cyangugu, se plaignait en septembre 1962 du traitement que lui avait infligé le préfet de Cyangugu. Il affirma avoir été molesté, arrêté et démis de sa fonction de bourgmestre de Buguzi par le préfet A. Munyaneza, qui était soutenu par un autre député de Cyangugu, J. Iyakagaba. Le troisième député de la préfecture, M. Busunyu et V. Kalima furent « exclus de la préfecture » suite à un accord entre le préfet et quelques leaders locaux des partis Parmehutu et Aprosoma qui formaient un cartel à Cyangugu. Il y avait donc deux camps : d’un côté les députés Kalima et Busunyu, de l’autre le préfet Munyaneza et le député Iyakagaba. D’après la lettre de Kalima ces derniers faisaient régner une véritable terreur. Il résumait la situation ainsi :
« 1) Pas d’habitant qui peut se déplacer d’une commune à l’autre ;
2) Tout le pouvoir est désorganisé ; personne n’est responsable d’un service; 3) Il n’y a plus de justice dans l’administration de Cyangugu à cause des fusils, des bandes de malfaiteurs, et de la propagande qui est en train de se faire et qui dit que le président Kayibanda est l’oncle paternel du préfet, que le préfet Niyonzima est son oncle maternel, que Kagenza, chef de cabinet à la présidence, est son grand frère. L’injustice et le pouvoir absolu sont comparables à celui de Musinga et de Nyirayuhi avec ses abiru ».
L’Assemblée rejeta une proposition d’interpeller le gouvernement, mais décida à huis-clos de constituer une commission spéciale de six membres (quatre Parmehutu, un Aprosoma, un UNAR), chargée d’étudier ce problème. Le rapport que cette commission présenta quelques mois plus tard fut décevant. Elle demanda tout simplement d’être déchargée de sa mission, notamment semble-t-il parce que l’autorité visée en premier lieu, le préfet Munyaneza, venait d’être nommé ambassadeur. Une autre raison exprimée par un des membres de la commission, W. Banzi, est significative : « Pour le moment le Kinyaga n’offre pas assez de sécurité personnelle pour permettre d’y mener une enquête sur place, et si je ne m’abuse, je crois que la faute en est aux députés de la région qui se cherchent noise et s’accusent sournoisement auprès des autorités locales » . L’affaire Kalima fut close le 11 décembre 1962, le président de l’Assemblée indiquant qu’elle ne figurait plus à l’ordre du jour de l’Assemblée. M. Kalima répondit « Merci, Mr. le Président, j’ai compris » et démissionna du Parmehutu. Il resta député indépendant jusqu’aux élections de 1965.
Le problème du député Kalima n’était cependant que le prélude à une discussion plus générale. Lors de la séance du 16 janvier 1963, M. Rwagasana, rapporteur, fit la lecture du rapport d’une commission sur la « situation des députés » créée la veille. On retiendra ici le souhait de W. Banzi « que chaque député soit muni, dans un bref délai, d’une carte d’immunité parlementaire – bien que je doute de son efficacité contre les excès de certains soldats ou policiers – pour éviter des fouilles et des traitements inqualifiables… ». Le manque de confiance dans l’Administration était explicite ; il ressortait de la même manière pendant ce débat lorsqu’il était question de l’incompatibilité entre un poste dans la fonction publique et un mandat de député. G. Sentama ne fut pas contredit quand il affirma que « le gouvernement aura beau jeu quand il voudra se débarrasser d’un député politiquement indésirable. En effet, il lui suffit de lui confier une fonction enviable et enviée et de l’en démettre sous un prétexte quelconque, après le retrait de son mandat (de député) ». La carte d’immunité parlementaire fut donc adoptée et l’Assemblée prit note avec satisfaction d’un avis de la Cour constitutionnelle estimant que le mandat d’un député devenu fonctionnaire serait simplement suspendu et non retiré. Ces petits incidents montraient que l’Assemblée était décidée à affirmer son indépendance et qu’elle entendait contrôler l’Exécutif. Une occasion réelle se présentait un an plus tard.
Mission parlementaire de 1964
A l’occasion de l’examen du projet de loi portant statut du ministère public et du projet de code de procédure civile et commerciale certains députés avaient stigmatisé les injustices qui selon eux se commettaient au Rwanda, spécialement dans les tribunaux et les maisons de détention. Dans sa lettre n° 109/02/08-22 du 11 juillet 1964, accompagnant la transmission de la loi sur le ministère public, le président de l’Assemblée nationale attira l’attention du président de la République sur les lacunes relevées par bon nombre de députés. Il considérait ces lacunes comme « suffisamment graves pour pouvoir, à la longue, engendrer un véritable malaise dans le pays ». Ces irrégularités dans l’exercice de la justice se présentaient notamment « dans l’insuffisance des moyens d’action mis à la disposition des officiers du ministère public en comparaison des facilités, parfois abusives, accordées à certains agents subalternes ; déficiences pouvant servir de prétexte pour justifier les lenteurs excessives dans la procédure judiciaire, spécialement en ce qui concerne l’illégalité de certaines détentions préventives ».
La réaction du président de la République fut favorable. Dans sa lettre n° 1319/03.04 du 25 juillet 1964, il demanda
« de constituer une mission parlementaire, qui fasse une tournée sur l’ensemble du pays avec comme objectif de :
-voir et voir objectivement la marche des divers services tant administratifs que techniques et judiciaires ;
– de découvrir les jugements des populations intéressées ;
– faire savoir à l’Exécutif votre jugement par rapport au développement général du pays et au programme du Parti National ».
On voit que les termes du mandat proposé par le chef de l’Etat dépassent de loin le seul domaine judiciaire. Ce qu’il demande est en réalité un aperçu sur l’état de la Nation » après deux ans d’indépendance. Il demande également de rapporter la situation au programme du Parmehutu, ce qui semble irrégulier étant donné la présence de députés de l’Aprosoma et de l’UNAR dans l’Assemblée.
Les membres de la commission, proposés par le président Kayibanda et agréés par l’Assemblée, furent tous du Parmehutu. Il s’agit de A. Makuza, M. Mpiranya, W. Banzi, A. Rugira, L. Sezirahiga, L. Nibaseke et G. Sentama. La mission prit sa tâche très au sérieux. Pendant un mois (du 6 août au 3 septembre 1964) elle circula dans les préfectures, où elle entendit les autorités locales, reçut des pétitions écrites ou verbales lors de ses audiences, effectua des visites-éclair dans des « communes-échantillon » et dans les juridictions… Du 4 au 19 septembre elle s’installa à Kigali pour la confrontation des impressions recueillies et pour la rédaction du rapport.
La structure du rapport est simple. La première partie décrit par préfecture la situation dans les divers domaines : politique et administratif, judiciaire, social, économique, vitalité du parti national, comportement des députés. Cette partie comprend également des observations sur le centre judiciaire de Nyabisindu (Cour suprême et parquet central). La deuxième partie comprend des recommandations, d’abord celles particulières à chaque préfecture, puis des recommandations générales dans les domaines administratif, judiciaire, politique, social, économique et législatif. Ce rapport de 84 pages et des annexes donne une image informative mais assez sombre de la situation administrative et judiciaire du pays.
Dans le domaine judiciaire on constate que le ministère public méconnaît trop souvent les dispositions légales en matière de détention préventive. Au moment de la rédaction du rapport il y avait 1522 détenus prévenus contre 436 condamnés. A peine 20% des détenus étaient donc jugés et les prévenus étaient en général détenus sans titre et pendant de longues périodes, parfois plus de trois ans. La Commission était vivement impressionnée par le nombre inquiétant de litiges figurant aux registres des juridictions visitées, c’est-à-dire les dix tribunaux de première instance et les deux chambres de la Cour d’Appel. Ce nombre s’élevait à 6.128 litiges inscrits contre 1.534 affaires jugées. Cela veut dire que 20% seulement des affaires étaient jugées à raison d’une moyenne globale de seize jugements par mois et par juridiction. La situation alimentaire, vestimentaire et sanitaire dans les prisons est considérée comme alarmante. La commission reproche à la Cour suprême d’être préoccupée par la réforme du parquet plutôt que de s’occuper de son propre domaine et de sortir ses différentes sections de la léthargie. Le personnel de la Cour « entretient un foyer d’intrigues caractéristiques de la cour féodale ».
Dans le domaine administratif la situation n’était guère meilleure. Selon le rapport, l’administration préfectorale souffre de politisation, de régionalisme (et dans le nord de clanisme) et de manque de capacités réelles. La méfiance entre collaborateurs paralyse les services. « Dans la presque totalité des préfectures, les préfets, sous-préfets et fonctionnaires s’épient et se contrôlent mutuellement au lieu de conjuguer leurs efforts pour l’efficacité du service (…). On a l’impression qu’au départ en nommant un préfet ou autre chef de service, son chef hiérarchique s’est ingénié à lui coller un collaborateur chargé de le surveiller et de handicaper toutes ses initiatives. Les administrations communales sont souvent paralysées par des conflits d’intérêts ou de personnalité, par le gaspillage des fonds communaux et par des abus de pouvoir. La police nationale est incompétente et tyrannise la population. La commission a l’impression « que notre Police tant communale que préfectorale n’a hérité de ses maîtres belges que la brutalité, l’arbitraire et le manque de fair-play ». Pour ce qui est du corps des fonctionnaires le rapport note le favoritisme dans le système des commissionnements, la violation des contrats de vente-location des maisons de l’Etat, des abus dans le système de recours et du signalement et dans l’emploi des véhicules de l’Etat. Seule la Garde nationale s’en sort fort honorablement. La commission a pu « admirer partout sa discipline, son dévouement et sa renommée de vaillance et d’intrépidité pour la défense de la patrie. La Garde nationale a acquis une réputation immaculée d’être un corps d’élite ».
Dans le domaine politique une plainte souvent émise est que le Parmehutu manque d’organisation interne adéquate et de démocratisation suffisante de ses organes de direction. Ces organes « sont constitués de la base au sommet d’une oligarchie qui s’embourgeoise de jour en jour en cumulant tous les postes de commandement du Parti et de l’Administration, transposant ainsi à un autre plan les fonctions du chef d’antan à la fois administrateur, juge et législateur suprême ». La mission estime fort à propos que « la pérennité et la vitalité d’un parti unique de jure ou de facto dépendent en ordre principal de son autocritique conditionnée par la garantie d’une liberté totale d’expression en son sein ». Le rapport regrette les luttes confessionnelles, le favoritisme et le clanisme, les calomnies et les rivalités au sein du parti.
Quelques exceptions mises à part la mission se limite essentiellement à relever les problèmes rencontrés sans faire beaucoup de recommandations, sauf pour quelques situations particulières à une préfecture, une commune, un service ou un individu. Si l’analyse de la commission est dure, elle donne probablement une image correcte des craintes, conflits et abus qui se produisaient dans le pays. La mission souligne dans sa conclusion que les milieux gouvernés « souhaitent de semblables visites pour avoir l’occasion d’informer le chef de l’Etat sur leurs véritables aspirations et les carences éventuelles de ses représentants. Ceux-ci, à leur tour, aux échelons inférieurs souhaitent également la fréquence de semblables visites dans un double but : constater sur le terrain les difficultés concrètes auxquelles ils sont confrontés d’abord ; les aider à les résoudre efficacement ensuite ». La mission évoque dès lors l’opportunité d’envoyer à l’avenir des missions semblables, gouvernementales cette fois, dotées d’un véritable pouvoir de contrôle et de décision. Elle formule enfin l’espoir que ses observations et recommandations seront prises en considération. Ce souhait ne fut malheureusement pas exaucé. Le rapport de la mission de visite- fut transmis au président de la République, qui ne le remit pas à l’Assemblée nationale. Celle-ci fut ainsi mise dans l’impossibilité de mener un débat à ce sujet. L’affaire était enterrée et ce remarquable exercice en démocratie n’eut que peu de suites pratiques, mais il s’était au moins avéré possible de formuler ces constatations sans risque de représailles. Nous verrons tout de suite que ce ne sera plus possible quatre ans plus tard.
Commission d’enquête de 1968
En 1968, le mécontentement des députés atteignit un niveau sans précédent. La méfiance envers le gouvernement était énorme. La demande de priorité à l’ordre du jour pour le projet de loi instituant le budget de développement pour l’exercice 1968 fut pour bon nombre de parlementaires l’occasion de formuler leurs doléances ayant trait à pratiquement tous les aspects de la vie publique. A. Munyarugerero regrettait que le président de la République soit rendu inaccessible par son entourage, ce qui mettait selon lui les députés dans une situation inextricable : « Quand vous demandez une audience on vous soupçonne de conspirer contre la vie de tel ou de tel, ou bien on vous accorde une audience pour le jour qu’on sait très bien qu’il (le président) est absent. Si vous, vous êtes craintifs, laissez au moins les « bakiga » oser lui dire la vérité (…). Etre député, c’est accepter de dire toujours la vérité. Il ne faudrait autrement pas se porter candidat, et si on s’abstient de se porter candidat aux élections de son parti, on sera soupçonné de vouloir former un nouveau parti! Vous êtes sans issu ». Eu égard au grand nombre de problèmes, notamment mais pas uniquement quant aux réalisations du budget de développement, l’Assemblée décida de créer une commission d’enquête de six membres, à qui un mandat très large fut donné. Lorsqu’un des membres désignés, J.B. Rwasibo, hésita à accepter son mandat, les rapports de méfiance vis-à-vis du gouvernement furent bien illustrés par la façon dont A. Rugira tâchait de donner courage à son collègue : « Vous pouvez peut-être avoir tous vos cousins en prison et craindre le même sort, mais ce ne sera pas parce que vous avez fait votre devoir. Vous n’avez qu’à répondre à l’Assemblée. Quand l’Assemblée a fait sienne des faits ou des pensées, un député ne peut individuellement en être tenu pour responsable ; ce serait un mépris et une insulte à l’Assemblée nationale ». Cette commission d’enquête eut pour objet d’étudier « tout ce dont peut souffrir le pays » ; sa mission était « de nous renseigner sur l’état du pays, de son développement économico-social (…), voir si toutes les directives sont mises à exécution ».
C’est tout un programme, ressemblant d’ailleurs fortement à celui de la mission parlementaire de 1964. Il y a cependant une différence importante entre les deux commissions : si la mission de 1964 avait été suggérée par le président de la République, qui en avait proposé la composition et à qui le rapport avait été adressé, celle de 1968 était une commission parlementaire d’enquête, créée à l’initiative de l’Assemblée et désignée par elle. Son rapport était destiné à l’Assemblée et on pouvait anticiper qu’il serait bien plus difficile de l’enterrer qu’en 1964. L’ordre de mission du 4 juillet 1968, émanant du président de l’Assemblée explicitait le mandat donné ; la commission devait faire rapport sur les questions suivantes : administration et politique, justice tant debout qu’assise, tenue et gestion des prisons, état des caisses intercommunales, exécution du budget de développement. Dans une lettre de la même date, B. Bicamumpaka demandait au président de la République de « prendre toutes mesures utiles pour que les différents services collaborent à la réalisation de cette mission, tout en lui facilitant sa tâche délicate ». Le 8 juillet le président Kayibanda assura le président de l’Assemblée que « la commission aura de la part de tous les services les meilleures facilités ».
La commission se heurta toutefois dès le début à des obstacles dans certains services. Ainsi le directeur du service pénitentiaire envoya aux directeurs des prisons le télégramme suivant : « Vous signale interdiction formelle fournir pièces dans archives ou permettre accès dans prisons aux étrangers sans autorisation mininter ». Dans une note du 22 juillet 1968 le président de la Cour suprême, se basant sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur les articles 73, al. 2, 96, al. 2 et 98 de la constitution, indiqua que le pouvoir législatif n’est doté d’un pouvoir de contrôle qu’à l’égard du seul pouvoir exécutif. Il tenait à rappeler ce « principe sacré de l’indépendance du pouvoir judiciaire (…) dans le souci du respect de la loi comme celui d’éviter des conflits éventuels toujours regrettables… ». De son côté, le procureur de la République opposait, en ce qui concerne le parquet, que le ministre n’avait rien signalé. Nonobstant ces obstructions, la commission put mener ses enquêtes à bien et rédiger un fort intéressant rapport de 107 pages et de dizaines de pages d’annexes.
Après un titre introductif, le rapport contient deux parties. La première (p. 3-96) a trait à la situation dans chaque préfecture ; la deuxième (p. 97-107) contient des observations générales. Dans les rapports préfectoraux, le rapport étudie successivement la situation administrative et politique, le fonctionnement des tribunaux et des parquets, et la gestion de la caisse intercommunale. La mission ne put enquêter sur la tenue et la gestion des prisons suite au refus du ministre concerné d’autoriser l’accès aux institutions et autorités pénitentiaires. Les sections sur les préfectures se terminent par des recommandations concrètes. La partie générale contient des observations sur l’administration, la politique, la justice, les caisses intercommunales, le budget de développement et des matières diverses. Dans la partie consacrée aux préfectures, la commission souligne un nombre impressionnant de faits et d’opinions qu’il serait trop long d’énumérer ici. Il suffira de remarquer qu’un nombre de personnalités politiques, dont certaines très influentes, furent attaquées soit dans le rapport soit dans ses annexes. Dans une annexe au rapport sur la préfecture de Gitarama, le président Kayibanda était lui-même accusé d’avoir utilisé du bois communal pour chauffer ses fours à briques, destinés à la prison de Gitarama en construction.
Dans ses observations générales « la commission est en mesure d’affirmer que les idéaux du régime hutu se relâchent de plus en plus ». Si la victoire hutu lors de la révolution de 1959-61 avait satisfait la population, actuellement
« la discorde sévit parmi la population, provoquée ou encouragée par les autorités elles-mêmes. Les bourgmestres, les préfets, les ministres et certains députés ne jouissent pas de la confiance de la population, parce qu’ils se sont mêlés aux intrigues soit d’ordre commercial, soit d’ordre politique ou bien parce qu’ils sont préoccupés par leurs affaires et se détournent des affaires d’intérêt public dont ils ont la charge. Aussi au lieu d’être la lumière parmi la population, ils sont les premiers à cultiver des haines, à se débrouiller chacun pour soi, à ne pas observer la loi, à négliger le travail d’intérêt commun, pratique qui a fait partout tache d’huile ».
La commission stigmatise le favoritisme, l’intimidation, la politisation et l’impunité qui caractérisent la vie publique du pays. Elle propose quelques remèdes de nature à redresser la situation :
- création d’une « commission permanente d’enquête » de l’assemblée nationale, ayant pour mission de contrôler les actes des pouvoirs publics; une loi, prise en vertu de l’art. 96 Const., déterminerait les fonctions et moyens de cette commission de contrôle;
- création d’un organe consultatif au sein du parti, afin de conseiller le président de la République dans la nomination de certaines autorités ;
- instauration de la responsabilité ministérielle devant le parlement ; le président resterait responsable pour la politique générale du gouvernement, mais les ministres le seraient pour la gestion de leur département;
- élaboration d’un statut légal pour les préfectures ;
- respect pour et renforcement de l’autonomie communale.
Quant au M.D.R.-Parmehutu, le parti « donne lieu à beaucoup de plaintes dans tous les coins du pays ».
« L’unité, la concorde, l’entraide, la confiance, la collaboration, le patriotisme ont perdu leur valeur et n’existent plus. A leur place, c’est le dénigrement, les haines, l’égoïsme, les antagonismes, la malhonnêteté, la course à l’argent, la zizanie et le régionalisme. Les masses populaires se plaignent de ce que les leaders les ont trompées en leur disant que leur révolution de 1959 allait les libérer de l’injustice. Elles constatent maintenant que c’était une façon de se tailler des places; une fois celles-ci acquises, l’injustice est pire qu’avant. Elles n’ont pas peur de dire que l’ancien régime d’investir des chefs est préférable à l’actuel système électoral, parce qu’avec ce dernier, ceux qui méritent d’être élus sont écartés et ceux qui ne le méritent pas sont désignés comme candidats ».
Ce sont là des constatations d’une gravité extrême. La commission propose en conséquence :
- de démocratiser toutes les élections ;
- de donner aux élus le temps nécessaire pour faire preuve de leurs capacités;
- d’organiser toutes les élections (présidentielle, législatives, communales et du parti) la même année et d’étendre les mandats à une durée de six ans;
- de ne pas admettre les fonctionnaires à la direction du parti;
- de suspendre l’interdiction de polygamie pour les candidats, parce qu’elle n’est pas respectée.
En ce qui concerne la justice, la commission se plaît à souligner qu’un nombre de magistrats, surtout dans les tribunaux de première instance, font du bon travail. Plusieurs déficiences font cependant obstacle à une bonne justice : retard dans les jugements et leur exécution, pratique des pots-de vin, emprisonnements arbitraires et mépris répétés des droits de l’homme, insuffisance des salaires des magistrats, absence d’un ministère séparé de la Justice et usage abusif du droit de veto et d’injonction à l’encontre des parquets. Afin de remédier à cette situation, la commission recommande:
- de créer un ministère séparé pour la Justice;
- de revoir le statut de la magistrature;
- de supprimer le droit de veto et d’injonction;
- de poursuivre avec vigueur l’exécution des jugements et arrêts ;
- de créer une commission spéciale pour contrôler la Cour suprême dont « la situation est inquiétante ».
On comprend aisément que la publication de ce rapport provoqua un véritable tollé. Le texte fut lu à l’Assemblée en séance publique du 20 au 22 novembre 1968. Un ajournement pour étude du rapport fut voté et son examen repris le 4 décembre. Au début de cette séance le député Mulindahabi introduisit une motion signée par vingt députés, tendant à rejeter le rapport sans examen. Il expliqua que « le vœu des signataires (de la motion) est de désavouer publiquement ce rapport et son dégoutant contenu d’insultes aux valeurs les plus respectées de notre pays (et) de bannir ce rapport de tous les documents et annales de l’Assemblée nationale ». Ch. Byungura « ne peut s’étonner de cette motion et de ceux qui l’ont signée si l’on sait la pression qui s’est exercée sur les députés signataires ». Il est certain que le groupe du secrétariat national du parti et la présidence avaient, les jours et surtout les nuits avant le début du débat, tenté le tout pour le tout afin de noyauter le plus grand nombre possible de députés. De fortes pressions avaient été exercées à l’appui de cette action qui devait éviter tout débat sur le rapport. Toujours est-il qu’au début du débat, il n’y eut que vingt antagonistes qui s’étaient déclarés, c’est à-dire moins que la moitié de l’Assemblée. Plusieurs initiateurs de la motion de rejet étant mis en cause par le rapport, le président de l’Assemblée fit remarquer qu’il n’était « personnellement pas étonné de cette motion. Parmi les signataires, il y a des députés qui doivent n’y avoir rien compris, et d’autres plus malins, dont les agissements sont découverts par le Rapport et qui craignent une étude encore plus approfondie lors de débats (…). Ils demandent d’étouffer la réalité désagréablement dévoilée par le Rapport d’enquête, de brûler celui-ci ». Il faut dire que le président de l’Assemblée oubliait ici quelque peu l’obligation de réserve imposée par sa fonction.
Les reproches des signataires de la motion à l’encontre du rapport peuvent se résumer comme suit.
(1) Le rapport attaque le président de la République et plusieurs grands du régime ; il est donc subversif et ses promoteurs sont devenus de facto un parti d’opposition en déviant de la « ligne du parti »; le rapport, en faisant de la propagande anti-gouvernementale, détruit l’unité du pays et sape les bases des institutions;
(2) Le rapport contient des mensonges, surtout dans ses annexes, composées surtout de lettres, certaines anonymes, où la population dénonçait des abus inqualifiables. Les signataires de la motion n’hésitaient pas à suggérer que certaines de ces annexes aurait été fabriquées de toutes pièces par la commission ;
(3) La commission n’a pas de base juridique pour mener son enquête parce que la loi organique prévue par l’art. 96 de la Constitution sur le contrôle de l’Exécutif fait encore défaut ;
(4) La commission a dépassé les termes de son mandat en étudiant tout ce qui est critiquable dans le pays ;
(5) Le rapport ne peut être examiné en séance de l’Assemblée afin d’éviter qu’il ne devienne un document officiel. La motion mettait enfin en cause le président de l’Assemblée et le bureau – qui auraient inventé l’ordre de mission – et la commission – qui aurait volé ou détourné des biens de l’Etat.
Le débat sur la motion de rejet dura cinq jours, sans que le contenu du rapport proprement dit fit l’objet de discussions. Les signataires de la motion purent éviter le débat sur le fond de l’affaire avec succès. Le président de l’Assemblée avait pourtant essayé de faire procéder à cet examen : « Pourquoi ne dites-vous pas d’abord de lire ce document pour contredire ce qu’il contient de faux et de fictif, pour donner l’occasion de se justifier à ceux-là sur qui tombent des accusations. Quant à rejeter sans examen, sans raison montrée, un travail d’une commission que vous aviez vous-mêmes créée, c’est vouloir camoufler des choses qui n’en seront pas guéries pour autant ; après tout l’histoire est là et saura nous juger ». G. Sentama avait tiré un parallèle évocateur : « Quant à ce rejet et refus de connaître la vérité, les Tutsi des années 1955 et 1956 n’agissaient pas autrement ; ça ne les a pas longuement protégés ». Ce fut peine perdue. Le 6 décembre sept nouveaux députés ajoutaient leur signature en bas de la motion de rejet, ce qui portait le nombre des signataires à 27, c’est-à-dire une majorité confortable. En fin de compte, la motion de rejet l’emporta avec 30 voix pour, 0 contre et 11 abstentions. Le rapport ne fit dès lors pas l’objet de discussions, ce qui ne l’empêcha cependant pas d’être connu, puisqu’il avait été lu en séance publique devant une galerie comble de spectateurs. Les onze députés qui s’abstinrent le firent surtout pour pouvoir, dans la justification de leur abstention, défendre le rapport et attaquer son rejet.
Les suites de ce grave incident, qui dévoilait une scission profonde dans le parti, furent énormes. Quatorze députés au moins furent victime du plus grand « massacre » politique depuis la révolution : les députés Bicamumpaka, Byungura, Cyimana, Iyakagaba, Mbonyumutwa, Nzeyimana, Rwasibo, Ubalijoro, Sentama et Habamenshi qui s’abstinrent; les députés Kanyandekwe et Sebazungu qui étaient absents lors du vote mais qui avaient signé le rapport; et les députés Rugira et Sezirahiga, également absents lors du vote mais qui s’étaient exprimés en faveur du rapport lors des débats. Cette liste est impressionnante : il s’y trouve notamment un ancien président de la République, quatre anciens ministres, l’actuel et un ancien président de l’Assemblée nationale et deux signataires du « Manifeste des Bahutu ». Il y a dans ce groupe également quatre des dix ministres Parmehutu du premier gouvernement d’octobre 1961. Il s’agit donc réellement des premiers collaborateurs du président Kayibanda, qui avaient assis la révolution avec lui. Le secrétariat national du Parmehutu, uni autour du président Kayibanda et son allié C. Mulindahabi, prit soin d’éloigner tous ces députés « opposants » de la vie politique. Ils furent soit exclus du parti, soit refusés comme candidat aux élections législatives de 1969. Dans la préfecture de Butare, par exemple, le congrès régional du Parmehutu décida à l’unanimité d’exclure I. Nzeyimana, sur proposition du secrétariat régional et du comité local de la commune de Kibayi. Certains avaient même demandé le retrait de son mandat parlementaire et quelques-uns auraient souhaité voir Nzeyimana assigné à résidence surveillée. C’est en réalité ce qui se produisit, puisqu’il fut gardé pendant une semaine chez lui par un peloton de la Garde nationale. Quelques mois plus tard A. Rugira fut également définitivement exclu à l’unanimité par décision du secrétariat régional. Dans les autres préfectures, le même sort fut réservé aux « apposants » et les députés qui ne furent pas exclus ne furent pas repris sur les listes des candidats pour les élections de 1969. Le seul abstentionniste qui n’ait été frappé d’une mesure d’exclusion fut 0. Rusingizandekwe. Il avait justifié son abstention en soulignant que certaines choses figurant dans le rapport méritaient une étude sérieuse, mais que « les insultes et calomnies », surtout celles portées contre le président de la République, étaient intolérables. Les conséquences de cet épisode furent cruciales dans l’histoire politique du Rwanda indépendant : après les expulsions, le président Kayibanda sera de plus en plus isolé et confisqué par un petit groupe de Gitarama, dirigé par C. Mulindahabi d’abord et par A. Mbarubukeye à partir de 1971. De plus, le troisième parlement (1969-1973) sera complètement à la solde de l’Exécutif. Nous verrons qu’avec d’autres événements survenus en 1968-69, ces incidents constituent le début de la fin de la première République.
Autres formes de contrôle
Les députés eurent, à part l’exercice formel du droit de contrôle envers l’action gouvernementale dans le cadre de l’art. 96 Const., quelques autres occasions de s’en prendre – parfois violemment – au pouvoir exécutif. Nous avons relevé trois incidents importants que nous estimons utiles de relater parce qu’ils mettent, tout comme les travaux des commissions d’enquête, en lumière les conflits opposant l’Assemblée nationale au gouvernement.
La loi sur les sociétés coopératives et la TRAFIPRO
En 1954, des moniteurs de Kabgayi contribuent à mettre sur pied une cantine dans un bâtiment qui leur est cédé par la mission ; ils y déjeunent et on peut y acheter quelques articles. En 1955, le père L. Pien pousse les membres de la cantine à fonder une véritable coopérative. Le 20 novembre 1955 une lettre est adressée au résident pour obtenir son agréation. Le 16 décembre 1956 la coopérative Trafipro (Travail-Fidélité-Progrès) est juridiquement constituée avec Gr. Kayibanda en qualité de président du Conseil de gestion et le père Pien comme conseiller et animateur. Selon ses premiers statuts, la coopérative a pour objet « de promouvoir, par la mise en œuvre des principes de la coopération, les intérêts économiques et sociaux de ses membres, et plus particulièrement
1) de réunir des fonds par l’émission de parts sociales, 2) de procurer à ses membres, aux meilleures conditions de qualité et de prix, des articles d’usage courant et des denrées, et 3) d’effectuer toutes opérations concernant la production, le transport, la conservation, la vente des produits provenant de l’activité de ses membres ». Il s’agit donc d’une coopérative de production et de consommation. Au départ, sa zone d’action comprend le seul territoire de Nyanza ; la Trafipro a trois magasins et moins de mille coopérateurs. Dix ans plus tard, fin 1966, la Trafipro gère 27 magasins et 70 postes d’achat de café, reliés par les 18 poids lourds qu’elle possède. Il y a plus de 70.000 coopérateurs. L’activité de la coopérative s’étend à tout le pays. La Trafipro a été décrite comme un des expériments coopératifs les plus imaginatifs et fertiles de toute l’Afrique subsaharienne.
Depuis les débuts de l’entreprise, les liens étroits entre la Trafipro et les milieux politiques influents, surtout ceux de Gitarama, sont évidents. 1956, il faut le rappeler, fut l’année du « Manifeste des Bahutu » et la coopérative pouvait être considérée comme un élément faisant partie de ce mouvement général d’émancipation populaire. Le président Kayibanda, dans ses propres mots, se « trouve être l’un des initiateurs et animateurs de la toute première heure ». Fort soutenue par la mission de Kabgayi et par Mgr. Perraudin, la Trafipro fut donc dans une certaine mesure le bras économique des révolutionnaires de Gitarama. Un aperçu des premiers présidents du Conseil de gestion en est une illustration convaincante : Gr. Kayibanda de 1956 à 1960, C. Mulindahabi de 1960 à 1963, M. Niyonzima ensuite. Il s’agit des grands leaders du Parmehutu de Gitarama, tous signataires du « Manifeste des Bahutu ». Ce lien politique, peu ressenti les premières années, devint rapidement une hypothèque considérable. Si la société avait constitué une voie de communication et de mobilisation des masses hutu, elle devint également un moyen de formation de clientèle politique et de financement des activités politiques des intéressés. Pire encore, certains leaders dont Mulindahabi s’enrichirent de façon irrégulière, ce qui fit dire à l’humour populaire, très inventif au Rwanda, que « Trafipro Profitera » et que son sigle était l’abréviation de « Trafic, finances, profit« . Ces pratiques avaient mené la société au bord de la faillite en 1962 ; lors du débat parlementaire sur lequel nous reviendrons tout de suite, un député, W. Banzi, fit remarquer que « le passé de cette coopérative n’est pas (…) fort ‘glorieux’. Il se caractérise par des faillites innombrables, dont les causes ont été toujours soigneusement cachées aux sociétaires. Les dividendes n’ont jamais été distribués. Les ristournes n’ont pas été payées depuis la création de la coopérative ». Il semble que ce n’est que grâce à un accord de coopération technique, signé avec la Suisse en août 1963, que la Trafipro put être sauvée.
C’est à l’occasion du débat, les 26 et 29 octobre1964, sur un projet de loi portant organisation des sociétés coopératives que les critiques éclatèrent ouvertement à l’Assemblée nationale. Bien que le projet visait les sociétés coopératives en général, la discussion fut l’occasion pour les députés de s’en prendre à la Trafipro et au gouvernement. Ils reprochaient essentiellement quatre choses :
(i) Les dirigeants, sous-entendu les politiciens de Gitarama, s’enrichissent de façon irrégulière. A. Munyangaju fit ainsi remarquer qu’au lieu de profiter à leurs coopérateurs, elles (les sociétés coopératives) avantagent plutôt leurs directeurs, en ce sens que ceux-ci détournent impunément en tout ou partie le bénéfice et même le capital de ces coopératives ». A. Munyarugerero affirma de son côté ne plus voir l’utilité des coopératives : « Elles ne font qu’enrichir davantage des gens déjà riches.
(ii) Les activités de la Trafipro sont concentrées à Gitarama. L. Sezirahiga affirma qu’il ne voterait pas la loi « avant qu’on m’ait expliqué pourquoi les coopératives se retrouvent dans un seul coin du Rwanda » ; L. Nibaseke mettait en garde ses collègues contre l’imprudence » de voter une loi qui n’est profitable qu’à un coin du Rwanda » et A. Munyarugerero exhorta l’assemblée de ne pas « épouser les ambitions de l’élite de la préfecture de Gitarama ». Liée à cette opposition à la concentration des activités de la Trafipro dans la préfecture de Gitarama était la crainte de voir tous les efforts d’action coopérative concentrées en faveur de la Trafipro. Bon nombre de députés trouvait inadmissible que la convention avec la Suisse devait favoriser la Trafipro uniquement ; ils y voyaient une menace pour les autres coopératives. Le député E. Iyamuremye de Kibuye: « La Trafipro étouffe les autres coopératives rwandaises. N’a-t-elle pas mis fin aux activités commerciales d’une coopérative qui existait dans notre préfecture en 1962-63 et qui marchait rondement ? ». D’autres députés, surtout les commerçants du nord, craignaient en outre la concurrence de la Trafipro, avec ses avantages accordés par l’Etat, pour le commerce privé de détail.
(iii) Par l’intermédiaire de la Trafipro le gouvernement fait du commerce. L’avis de A. Munyampeta était formel : « Trafipro (…) s’avère commercer pour le gouvernement, puisque ses principaux membres sont de hautes personnalités de l’Etat. Raison pour laquelle Trafipro est à supprimer, parce que le gouvernement n’a pas le droit de commercer ». Cette opinion était largement répandue parmi les députés qui estimaient qu’en tant que régulateur et commerçant à la fois, le gouvernement se rendait coupable de concurrence déloyale.
(iv) Un dernier élément de critique, qui ne devait que soutenir les objections que nous venons d’évoquer, était d’un ordre strictement constitutionnel. Il eut trait à la convention par laquelle la Suisse prêtait 12.535.000 Frws, pour le financement des activités de la Trafipro. Selon certains orateurs, si ce prêt devait être remboursé et des intérêts payés, la convention comporterait des implications financières non prévues au budget. En vertu de l’art. 56, i Const. pareille convention n’est exécutoire qu’après ratification par l’Assemblée nationale.
En fin de compte, l’Assemblée refusa, à une faible majorité, de voter le projet de loi qui fut renvoyé en commission. Lorsque le texte revint en assemblée plénière le 26 janvier 1965, l’Assemblée décida d’ajourner son examen par 22 voix pour et neuf abstentions ; le texte fut retourné au gouvernement. Réintroduite à la fin de 1966, la loi sur les coopératives fut finalement adaptée après de longs débats. Le débat parlementaire sur la Trafipro et le projet de loi sur les sociétés coopératives comporte bon nombre de renseignements importants. On y trouve d’abord une confirmation, en 1964-65, de la volonté du parlement d’affirmer son indépendance et d’assumer pleinement son rôle de contrôle de l’action du pouvoir exécutif. C’est une constatation qui fut accueillie avec satisfaction par les députés. Pour I. Sebapolisi, « l’indépendance affichée par presque tous les orateurs vis-à-vis de la pression gouvernementale est (…) une nouvelle preuve de la maturité de l’Assemblée ». Ensuite, l’isolement politique de la préfecture de Gitarama et les tentatives des politiciens de cette préfecture de concentrer le pouvoir sont ressentis comme un problème aigu. La critique vient de tous les coins du pays et c’est presqu’un front uni qui s’oppose aux ambitions des « Gitaramistes »: M. Mpiranya, A. Munyarugerero et I. Sebapolisi de Ruhengeri, A. Munyangaju et L. Sezirahiga de Butare, W. Banzi de Gisenyi, L. Nibaseke de Byumba, E. Iyamuremye de Kibuye, Ch. Habimana de Kibungo et Ch. Byungura de Kigali. A part leur opposition à la concentration du pouvoir à Gitarama, les députés d’autres préfectures craignaient, d’un point de vue purement politique, les possibilités de formation de clientèle et d’établissement d’un pouvoir personnel que représentait le réseau de la Trafipro. On remarque également une résistance particulière des politiciens du nord. C’est fort compréhensible : nous verrons que ceux-ci avaient acquis une grande influence politique dans leur région notamment grâce au système d’ubukonde. C’étaient d’importants commerçants qui voyaient les activités commerciales de la Trafipro comme une concurrence dangereuse. Le député W. Banzi, grand commerçant de Gisenyi, avertit : « Si nous n’y prenions garde la Trafipro risque de ruiner le commerce national. En effet, grâce aux multiples avantages dont elle bénéficie sur le double plan fiscal et douanier, elle est en mesure d’exercer une concurrence déloyale vis-à-vis des commerçants indépendants ».
Arrêt d’interprétation authentique de 1967
La discussion, lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée nationale, des conséquences d’un arrêt d’interprétation authentique rendu par la Cour de cassation concernant la loi électorale fut pour les députés l’occasion de lancer de violentes attaques contre certains ministres, surtout G. Harelimana, ministre de l’Intérieur et des Affaires judiciaires, et contre le pouvoir exécutif en général. Les députés reprochaient au ministre Harelimana d’avoir provoqué un arrêt d’interprétation authentique contraire à la volonté du législateur. Le préambule d’une proposition de résolution, examinée le 8 septembre 1967, disait notamment :
« Considérant le comportement douteux du ministre de l’Intérieur et des Affaires judiciaires qui, contrairement au principe de la collaboration, n’a pas voulu s’adresser à l’Assemblée nationale pour se faire éclairer ni tenu compte de ses propres interventions lors de la discussion de la loi électorale…; Considérant que certaines autorités préfectorales, sous ses ordres, semblent être nommées pour semer et cultiver ce climat malsain de haine et de persécution contre certains premiers leaders;
Considérant d’autre part que le ministre Harelimana est inconscient de son rôle de ministre quand il déclare publiquement qu’il ne doit pas être victime du président de la République et qu’il ose inciter l’Assemblée nationale à donner motion de censure au président de la République sur lequel il se décharge. »
Si cette formulation semble déjà forte, surtout dans un régime à parti unique, le débat sur cette proposition de résolution ne le fut pas moins. Tout en estimant que la Cour suprême avait, elle aussi, « commis une faute grave », certains députés dont J.B. Rwasibo, A. Rugira et S. Gashirabake, exigèrent la démission du ministre Harelimana. La résolution finalement votée fut cependant moins revendicative : l’assemblée « constate et regrette amèrement l’incapacité notoire du ministre Harelimana d’assumer efficacement les charges qui lui sont confiées ; souhaite que ce ministère soit allégé en séparant l’Intérieur des Affaires judiciaires ».
Le débat fut en réalité un véritable procès du pouvoir exécutif dont le ministre Harelimana n’était que le bouc émissaire et l’arrêt d’interprétation authentique le prétexte. Ainsi, le ministre des Travaux publics, Ch. Kanyamahanga, fut, lui-aussi, violemment pris à partie pour fraudes électorales alléguées en préfecture de Kibungo et le président de l’assemblée, B. Bicamumpaka, finit par déclarer sans détours que « l’Exécutif est malade, nous le savons tous, à moins de n’être pas dans le pays ». Tout le pouvoir exécutif fut soumis à la critique et notamment les préfets, ce qui n’est pas étonnant vu les conflits permanents entre ceux-ci et les députés dans toutes les préfectures. A. Ubalijoro, par exemple, faisait ainsi le procès du préfet de Byumba : « La préfecture de Byumba est dirigée par un préfet et sa vache qui traîne derrière lui dans l’espoir de tout mettre dessus dessous dans notre préfecture comme à Kibungo; ils ignorent jusqu’au programme du Parti! ». Force est de constater cependant qu’après ces expressions verbales de grand mécontentement, les résultats des débats et de la résolution qui en fut le fruit restèrent limités. Les ministres Harelimana et Kanyamahanga conservèrent leur portefeuille lors du premier remaniement gouvernemental qui suivit ce débat, le 12 juin 1968, et le poste de l’Intérieur et des Affaires judiciaires resta indivis. Ce ne sera d’ailleurs que dans le premier gouvernement issu du coup d’Etat de 1973, formé le 1er août 1973, que les portefeuilles de l’Intérieur et de la Justice auront des titulaires différents.
Suspension du journal Kinyamateka
Dans son numéro de mai 1968, le journal Kinyamateka publia un article intitulé « Ibitekekezo mu magambo avunaguye. Aho uyu mugani ntiwatwigisha ? Umugani w’ubutegetsi bw’intare n’ingwe » (Les idées en raccourci. Est-ce que cette fable nous enseignerait quelque chose ? Un conte sur le gouvernement d’un lion et d’un léopard). Sous forme de fable l’auteur – le rédacteur Félicien Semusambi qui avait signé sous le pseudonyme Gacamigani – brossait une petite histoire politique du Rwanda moderne, qu’il présentait comme une forêt. Il décrivait la lutte entre l’antilope (Rwasibo) et le tigre (Mulindahabi) et les efforts de ce dernier de faire la cour au lion (Kayibanda). Allumées et attisées par le tigre et le chacal (Niyonzima) les haines s’accumulaient et se répandaient à travers la forêt. Il n’y eut plus de justice dans l’administration et ainsi « les petits animaux en étaient arrivés à se dire entre eux que les régimes sont tous pareils ; ils ne constataient aucune différence quant à la justice et la vérité entre le gouvernement des léopards déchus (monarchie) et celui des lions actuellement au pouvoir (république), et que somme toute l’injustice et la fourberie qui les écrasaient avaient battu les mêmes records dans les deux régimes ! ». L’article concluait : « En ces années donc, les haines parmi les animaux tout puissants n’ont pas permis de faire du bien pour les petits animaux. Les injustices se commettaient outre mesure ; la chose publique était dilapidée par certains animaux puissants. Et le lion était incapable de les contrôler à cause de la haine entre le tigre et l’antilope, haine qui s’était répandue à travers toute la forêt ». On retrouve en somme dans l’article de Kinyamateka grosso modo les mêmes constatations que dans le rapport de la commission d’enquête.
Fin mai 1968 le journal fut frappé d’une interdiction de paraître. Son éditeur, le père Enzo Maida, fut expulsé et son rédacteur F. Semusambi, auteur de l’article, arrêté. Il paraît que Mulindahabi, Niyonzima et Minani auraient convaincu le président Kayibanda, lui-même ancien rédacteur-en-chef du journal, de prendre ces mesures. Lors de la séance du 22 juin 1968 de l’Assemblée nationale, le député Kanyandekwe intervint pour demander les causes de l’arrêt de publication du journal et son collègue Byungura demanda l’étude de ce problème par priorité, estimant que la mesure d’interdiction était contraire à l’art. 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (liberté d’opinion et d’expression). Tout en admettant que « nous sommes tous peinés de voir suspendre l’unique journal privé de notre pays qui informait convenablement l’opinion publique de l’actualité nationale et internationale », le président de l’Assemblée refusa d’autoriser le débat sur un sujet qui ne se trouvait pas à l’ordre du jour ; mais il fit mieux, remettant aux députés la copie d’une lettre adressée par le père Maida au président de la République avant son départ du Rwanda.
Ce texte, qui constituait une mise en cause fondamentale du régime, fut donc publié dans les documents parlementaires. Il est intéressant d’en citer quelques passages : « Je ne pouvais rester insensible aux cris de déception, de souffrances, de malaise, de peur et de scandale qui nous parvenaient de tous les coins du Rwanda. Je ne pouvais non plus rester insensible devant certaines injustices, tracasseries, vols, abus, despotisme dont souvent le petit peuple était victime (…). Qu’on continue à tenir en prison notre rédacteur de Kinyamateka, Monsieur Semusambi, (…) est une injustice criante contre tout droit de l’homme et de la presse, contre toute justice, contre toute vraie démocratie. (…) (L’éditorial publié dans le n°15 de 1968 a été rédigé) en utilisant des nouvelles que tout le monde connaît, dont tout le monde parle en secret mais que personne n’ose dire à haute voix de peur de représailles éventuelles. »
Evoquant le rôle du président Kayibanda au sein du journal et l’action de celui-ci en faveur du mouvement hutu, le père Maida ajoute :
« Alors (pendant la deuxième moitié des années 1950) les mêmes insinuations, les mêmes critiques, les mêmes attaques, j’oserais dire… les mêmes calomnies qu’aujourd’hui étaient portées contre vous et contre Kinyamateka. Mais vous, vous avez eu de la chance, grâce au climat de liberté, de soutien, de compréhension, qu’alors le régime de tutelle vous accordait ; malheureusement, nous, nous n’avons pas la même chance sous votre régime démocratique ».
Il ne s’ensuivit pas de débat à l’assemblée, mais le simple fait qu’une accusation aussi grave ait pu paraître aux annales parlementaires est significatif et constituait sans aucun doute une censure réelle de l’action gouvernementale dans ce domaine. Cet incident a contribué à faire monter la tension qui était devenue considérable en 1968 ; nous avons vu que l’affaire du rapport de la commission d’enquête se situe dans le même contexte de perte de légitimité. Plus loin nous verrons que d’autres incidents, notamment un coup d’Etat manqué, faillirent provoquer la chute du régime.
Conclusions
On a dû constater partout en Afrique noire un rapide déclin du rôle et des pouvoirs des assemblées parlementaires. En Afrique francophone, ceci est dû notamment à des techniques juridiques de « rationalisation », imposant des limitations à l’activité législative et aux possibilités de contrôle du pouvoir exécutif ; la raison réelle en est cependant la concentration du pouvoir dans un seul parti et généralement même dans une seule personne. Pour l’Afrique anglophone, Martin constate que « the true situation is in that the executive controls the legislature ». Nous avons vu que, contrairement aux territoires anciennement français, la constitution rwandaise avait instauré un parlement théoriquement puissant et fort peu gêné par des techniques de rationalisation ; il était constitutionnellement bien équipé pour exercer ses compétences de législation et de contrôle. Comment s’est-il affirmé dans la pratique ? Il s’agit d’envisager avant tout les activités de contrôle de l’action gouvernementale ; déterminée dans une très large mesure par l’initiative du pouvoir exécutif, l’étendue de l’activité législative est moins informative. L’image globale est nette : exception faite de l’année 1966, on constate une activité relativement élevée jusqu’en 1968. Le parlement s’affirme et n’hésite pas à s’opposer, parfois avec une certaine véhémence, au gouvernement ; des amendements sont votés aux projets gouvernementaux et maintenus en seconde lecture ; face à la résistance de l’assemblée, le gouvernement est obligé de remettre et même d’abandonner certains projets ; des critiques fondamentales sont formulées dans les rapports des commissions d’enquête et à l’occasion d’autres débats. En septembre 1967, le président de l’Assemblée nationale constate que « l’Exécutif est malade, nous le savons tous ». Cette opinion est confirmée de façon spectaculaire par le rapport de la commission parlementaire d’enquête de 1968. Ce grand exercice de critique parlementaire fut également le dernier.
Suite à la publication de ce rapport et à la discussion parlementaire qui s’ensuivit, le régime mit fin à la contestation. Les « opposants », « ayant dévié de la ligne du parti », furent exclus de la vie publique. Sous le troisième parlement, issu des élections de 1969, il n’y eut plus de critique envers le gouvernement, plus aucun projet de loi rejeté ou amendé, et en conséquence plus aucune seconde lecture, en tout et pour tout un seul vote négatif et cinq abstentions lors des votes globaux des projets gouvernementaux. L’Assemblée rejoignit ainsi les autres parlements africains qui devinrent de simples « cachets de légitimité ». Le sort du parlement rwandais confirme l’opinion de Martin que « legislatures (…) were constitutionally equipped for the vigourous performance of the role assigned to them. Today it is equally clear that legislatures were not politically equipped for the performance of this role ». Le tournant se situe donc au Rwanda en 1968 ; le milieu gouvernant était devenu de moins en moins conscient de la nécessité de légitimité et de dialogue, et l’affaire de 1968 n’est que l’aboutissement d’un long processus dans ce sens, dont on aperçoit les débuts dès avant l’indépendance. La conséquence inévitable de pareille situation a été très bien décrite par un député nigérian. Son jugement s’applique mutatis mutandis au Rwanda : « During the past four years of its life (du parlement), members have been driven and whipped into conformity that an angry member had to describe it as a rubber stamp. With not one record of a serious and successful amendment of Government policy and not one Private Member’s Bill passed, this parliament will go down in history as a rubber stamp parliament. When Parliament is docile, the high-road to dictatorship is open ».
Même avant 1968, le rôle de l’Assemblée nationale comme véritable organe de prise de décision était réduit. C’est dû notamment au fait que les possibilités d’acquérir des informations précises étaient fort limitées. Nous avons vu que même les commissions d’enquête se virent refuser l’accès à d’importants renseignements. Pour un député individuel c’était bien plus difficile encore ; celui qui pose trop de questions devient rapidement un élément « subversif ». Il faut dire que l’Assemblée ne s’est pas vraiment battue pour son droit d’être informé : il lui aurait suffi de voter une loi en exécution de l’art. 96 Const. pour se procurer les instruments juridiques nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Les députés n’ont posé aucune question parlementaire, ce qu’ils auraient pu faire même en l’absence de législation. Si l’assemblée a pu critiquer le gouvernement, ce fut donc plus une soupape d’échappement qu’un véritable levier de changement ; aucune mesure préconisée dans les rapports des commissions d’enquête ou formulée lors de débats ne fut suivie d’exécution, et le parlement n’entreprit rien pour faire obtempérer le gouvernement. En fait, même si les députés rwandais ont parfois fait preuve d’un certain esprit de fronde, dans des situations extrêmes leurs choix étaient fort limités ; leurs sécurité et liberté personnelles étaient en cause et au moment des élections ils dépendaient pour leur désignation comme candidat des hautes instances du parti où le chef de l’Etat et son entourage immédiat avaient une influence prépondérante.
Pour des raisons de clarté de l’exposé et d’orthodoxie constitutionnelle, nous avons présenté cette évolution vers un régime autoritaire comme relevant des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ce qui est, en réalité, une présentation artificielle et trop formelle. Il s’agit, en effet, de conflits entre couches de l’élite politique, et plus précisément entre ce qu’on pourrait appeler l’élite et la sub-élite. L’élite se rétrécit de plus en plus dans la poursuite de ses propres intérêts ; elle coopte ses membres, en exclut d’autres, limite l’accès au groupe et contrôle le comportement de celui-ci. Ce qui fut étudié comme des conflits entre le parlement et le gouvernement n’en constitue qu’une partie et un exposant.
https://amateka.org/le-fonctionnement-des-institutions-de-la-premiere-republique/https://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20211227_105326.jpghttps://amateka.org/wp-content/uploads/2026/01/20211227_105326-150x150.jpgLes républiques Assemblée nationale Composition Jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale suite au coup d'Etat du 5 juillet 1973, le Rwanda connut trois parlements, élus respectivement en 1961, 1965 et 1969. Nous avons vu que les 44 sièges du premier parlement, issu des élections du 25 septembre 1961, étaient distribués...Kaburame Kaburamegrejose2001@yahoo.co.ukAdministratorAmateka y'u Rwanda
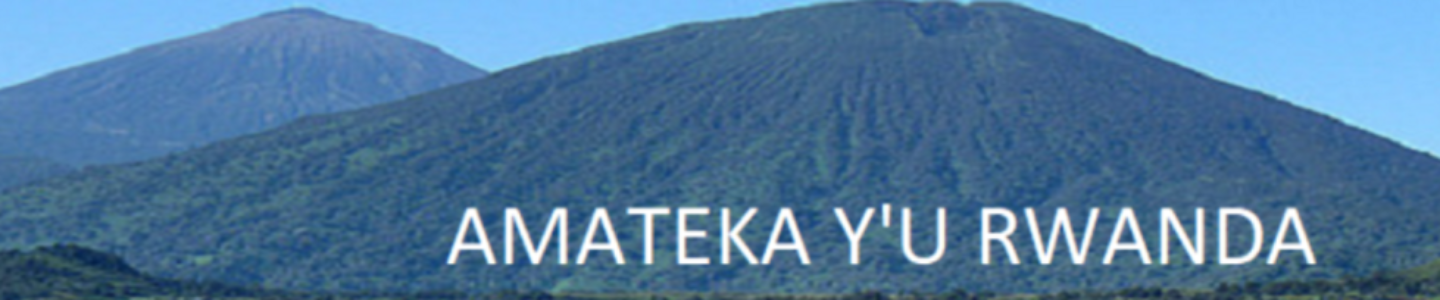



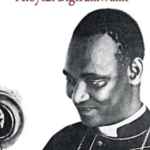






Laisser un commentaire